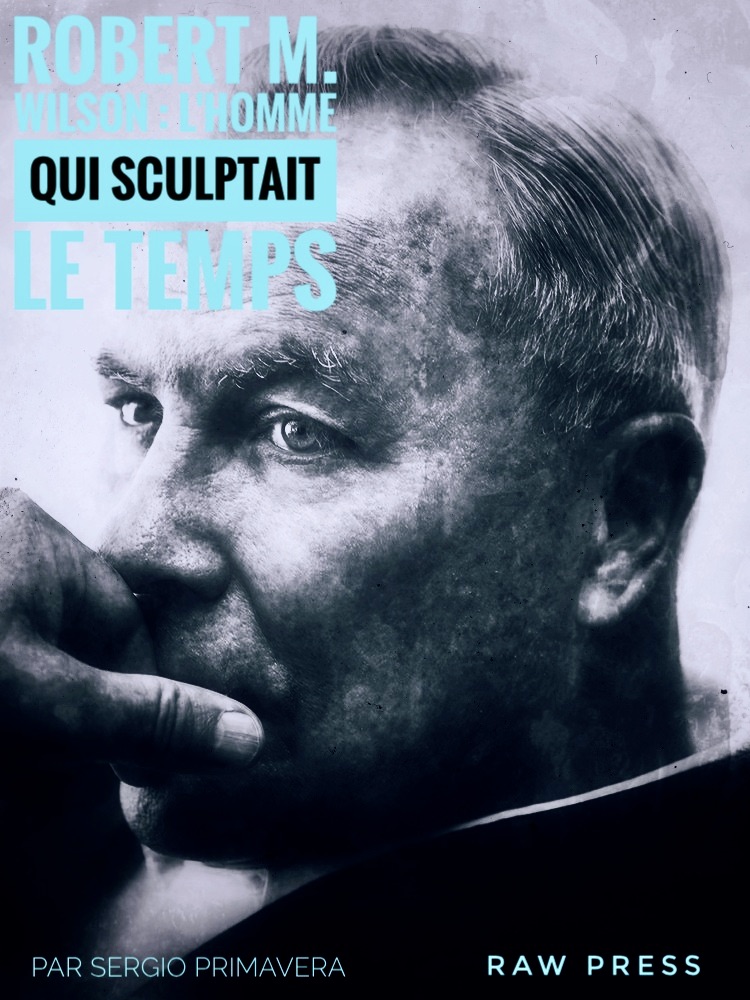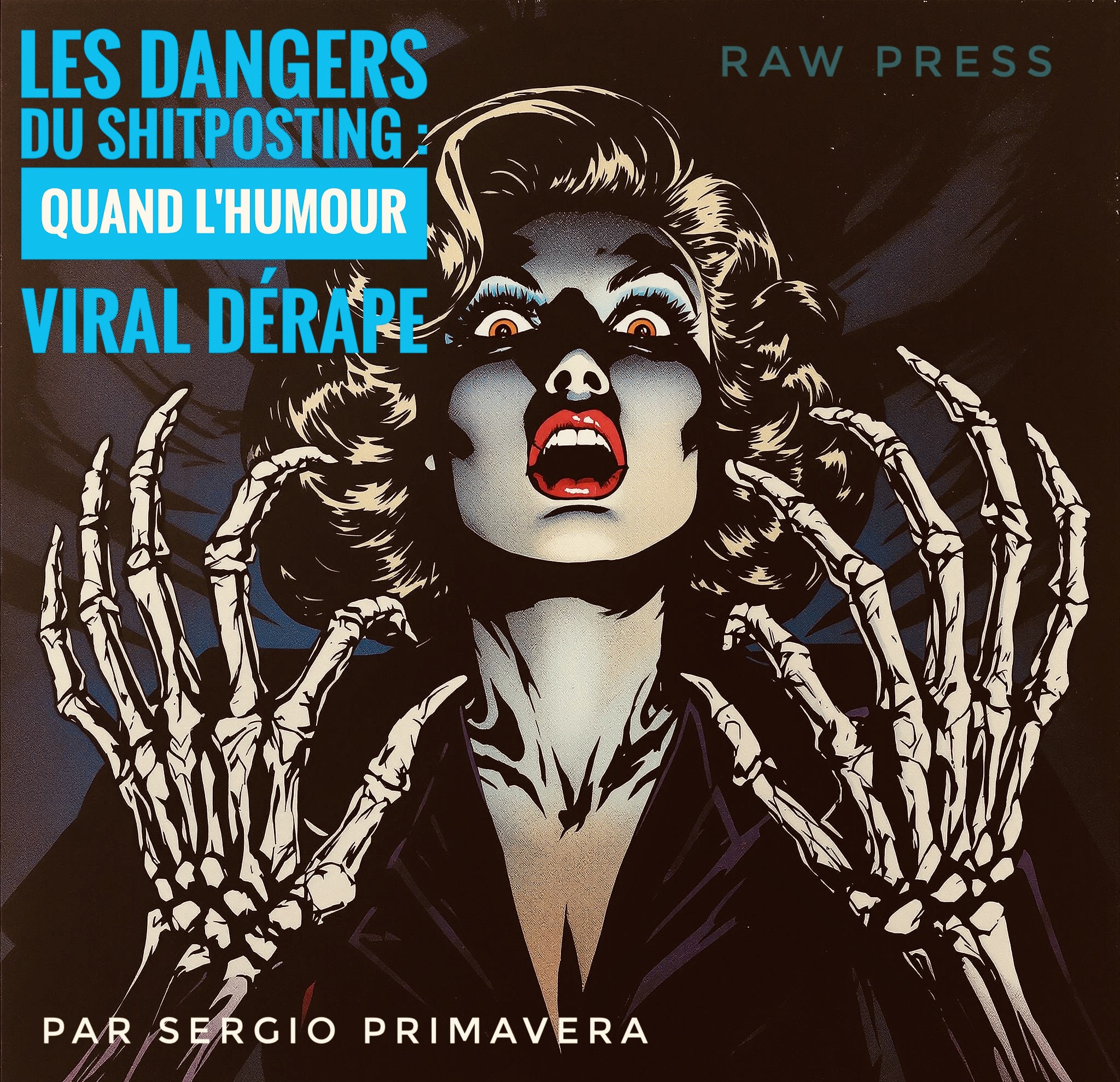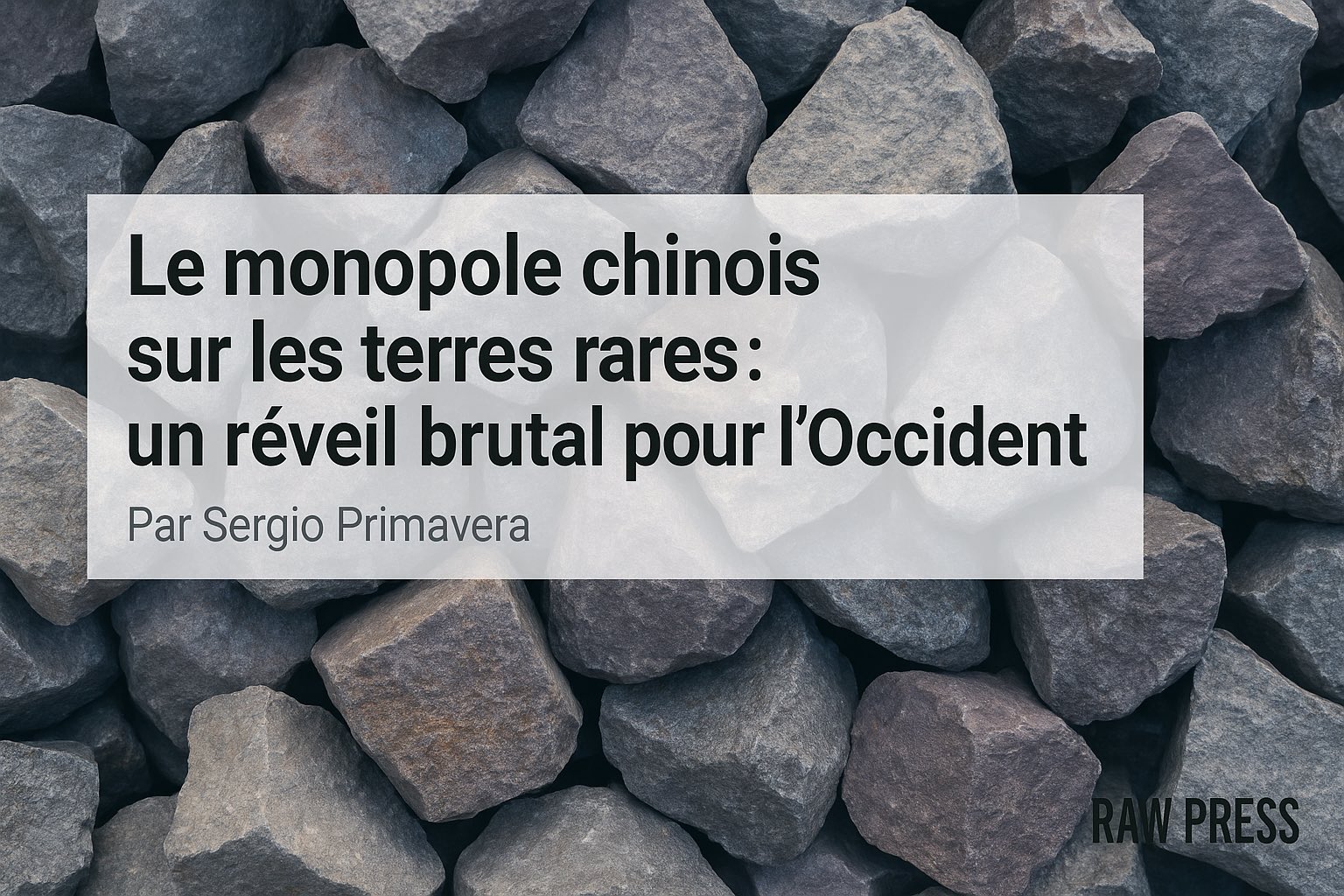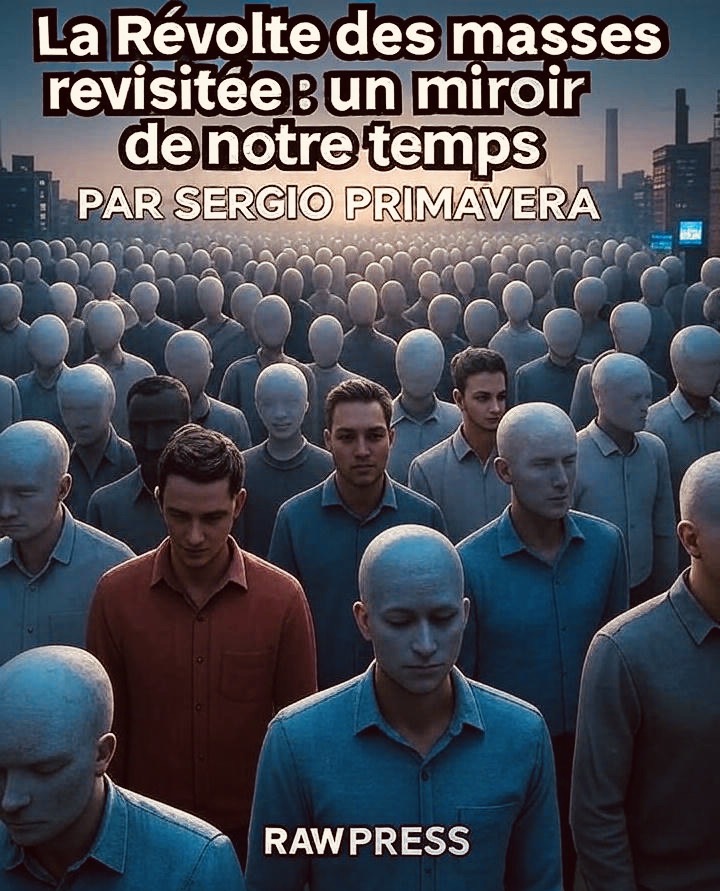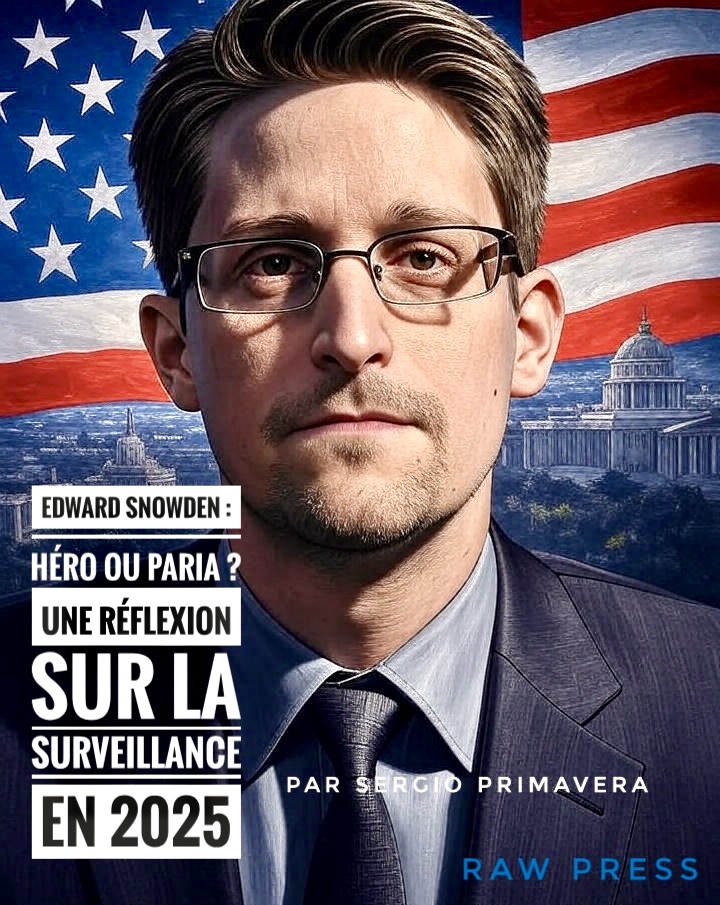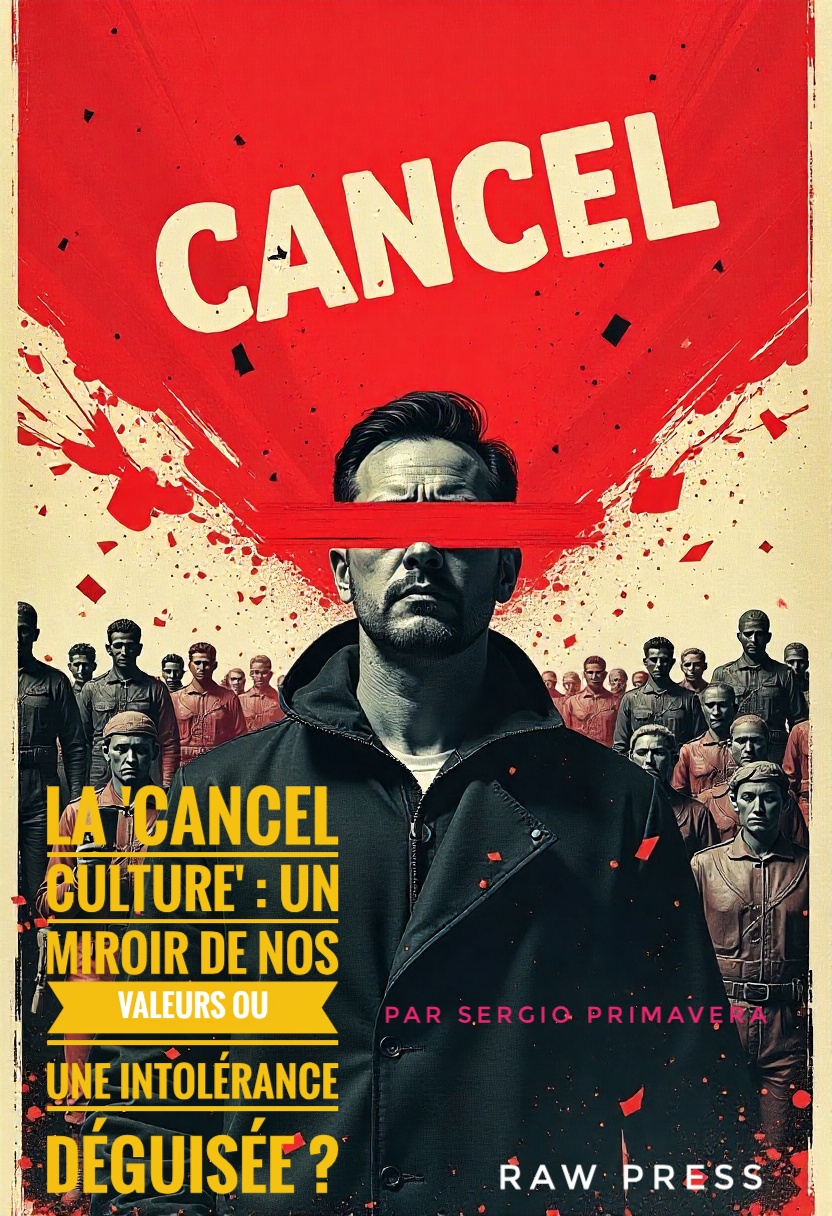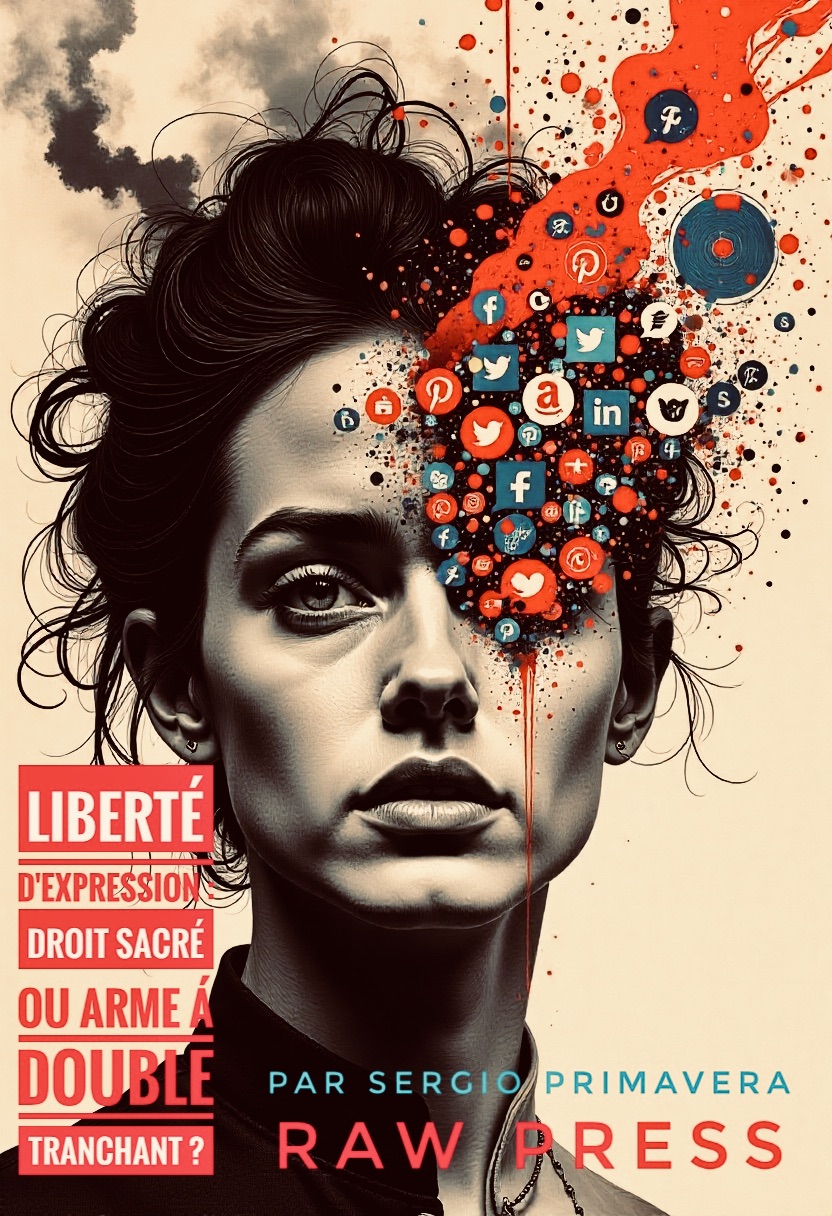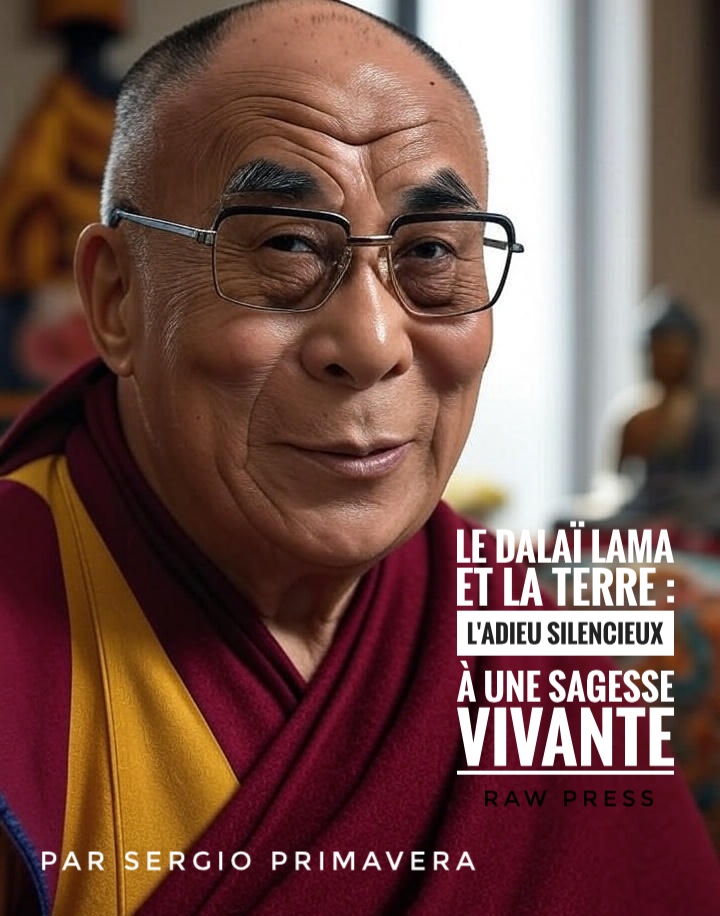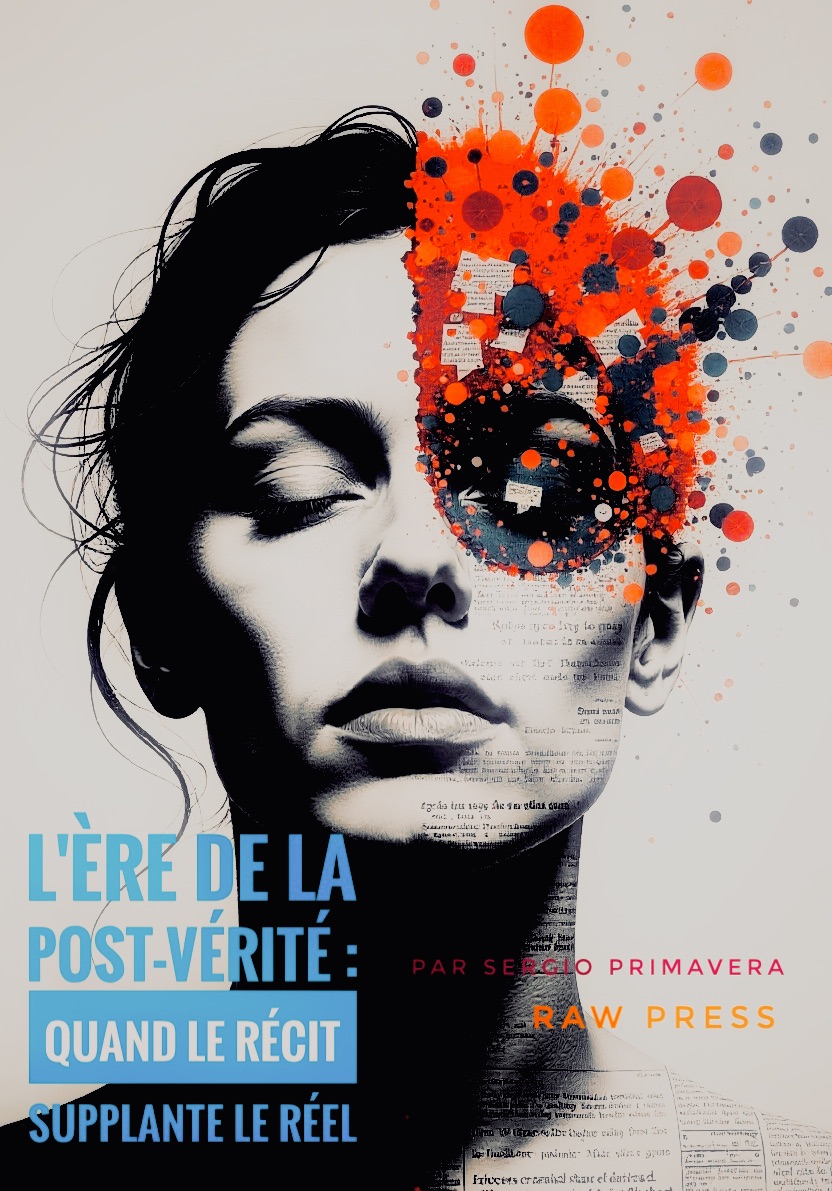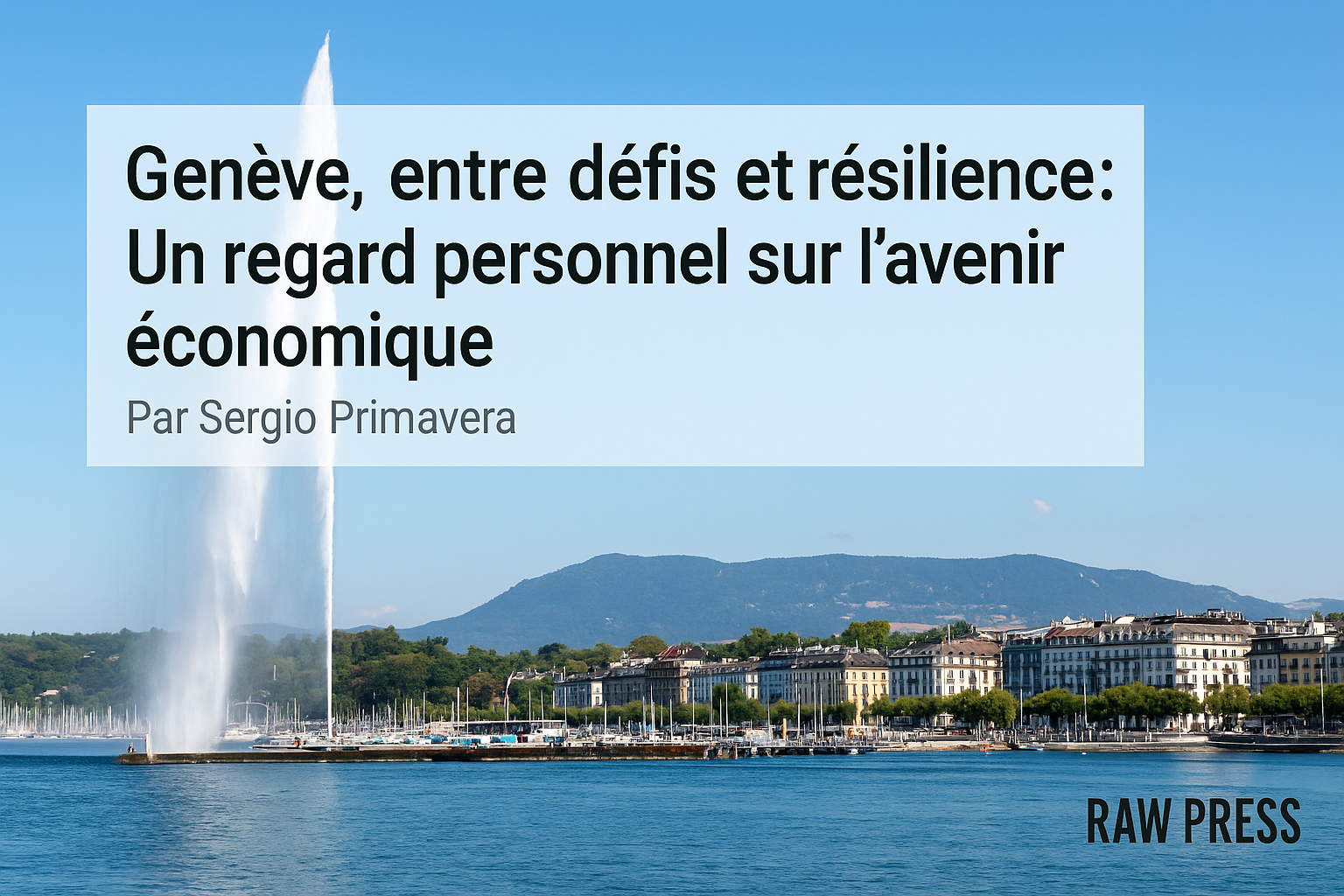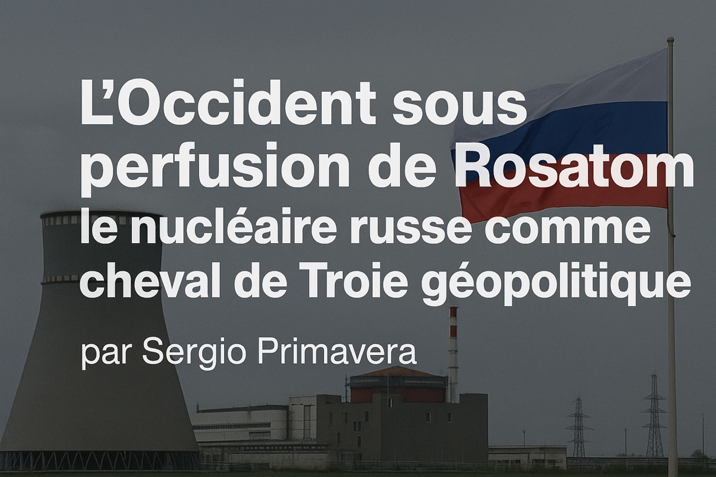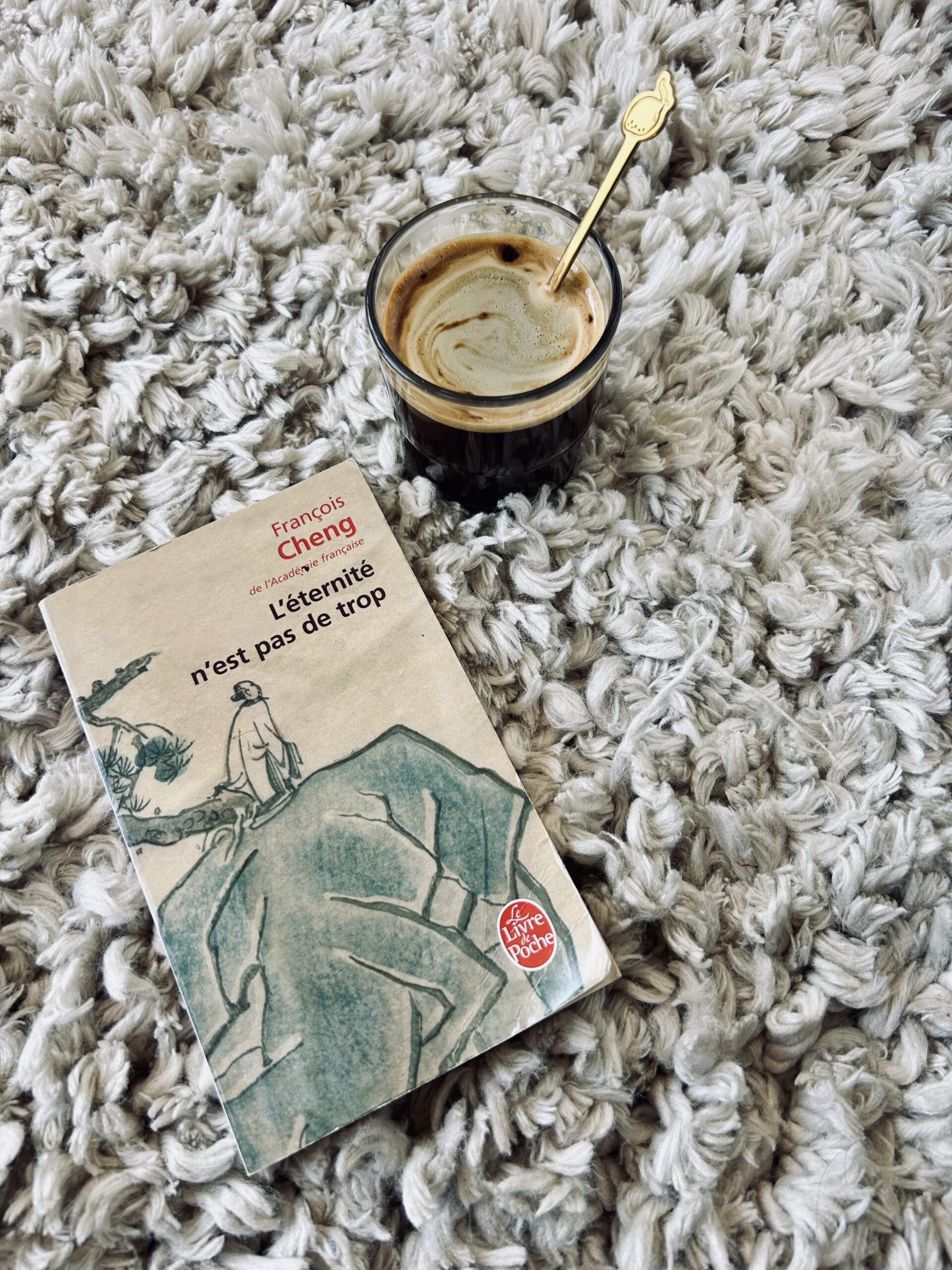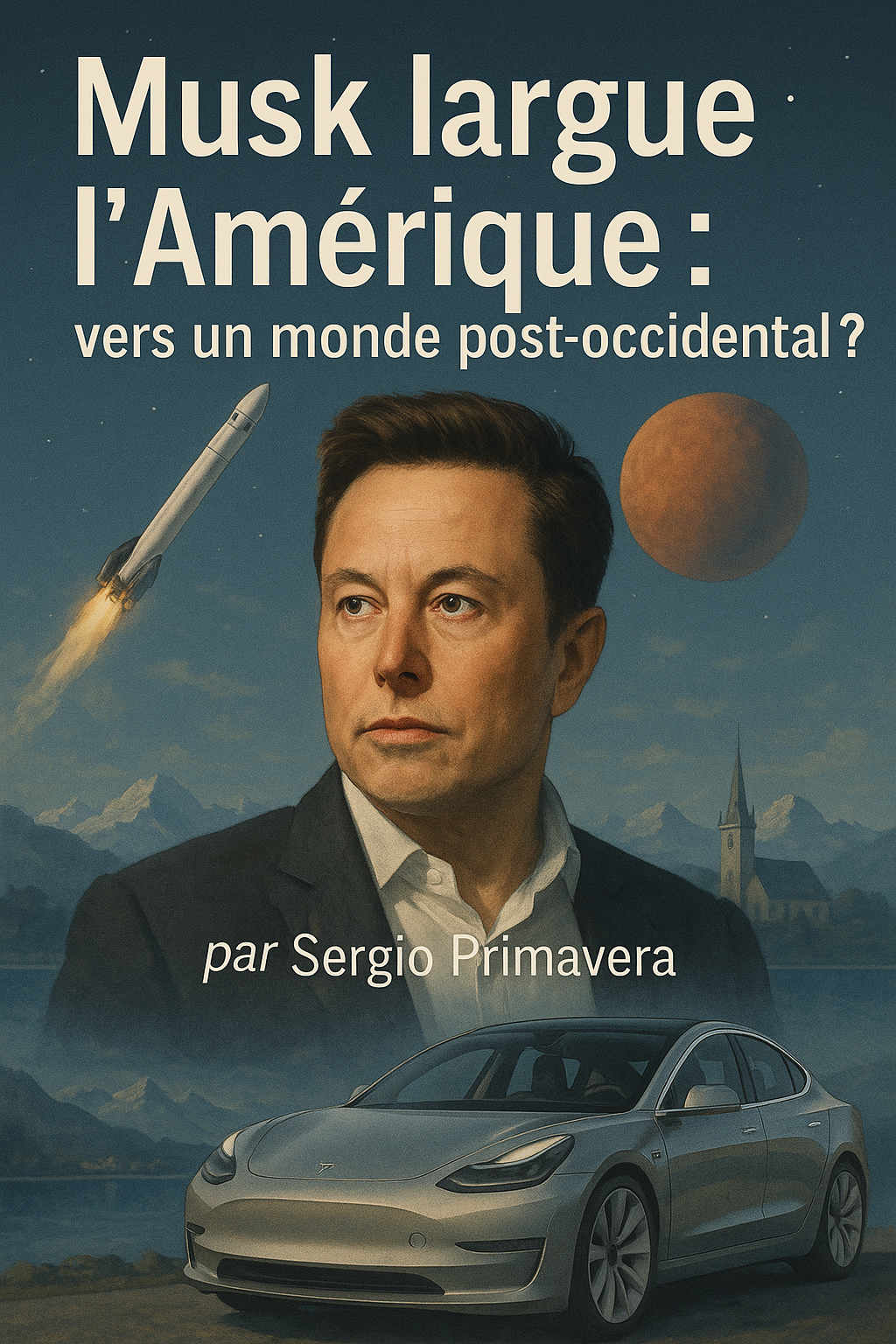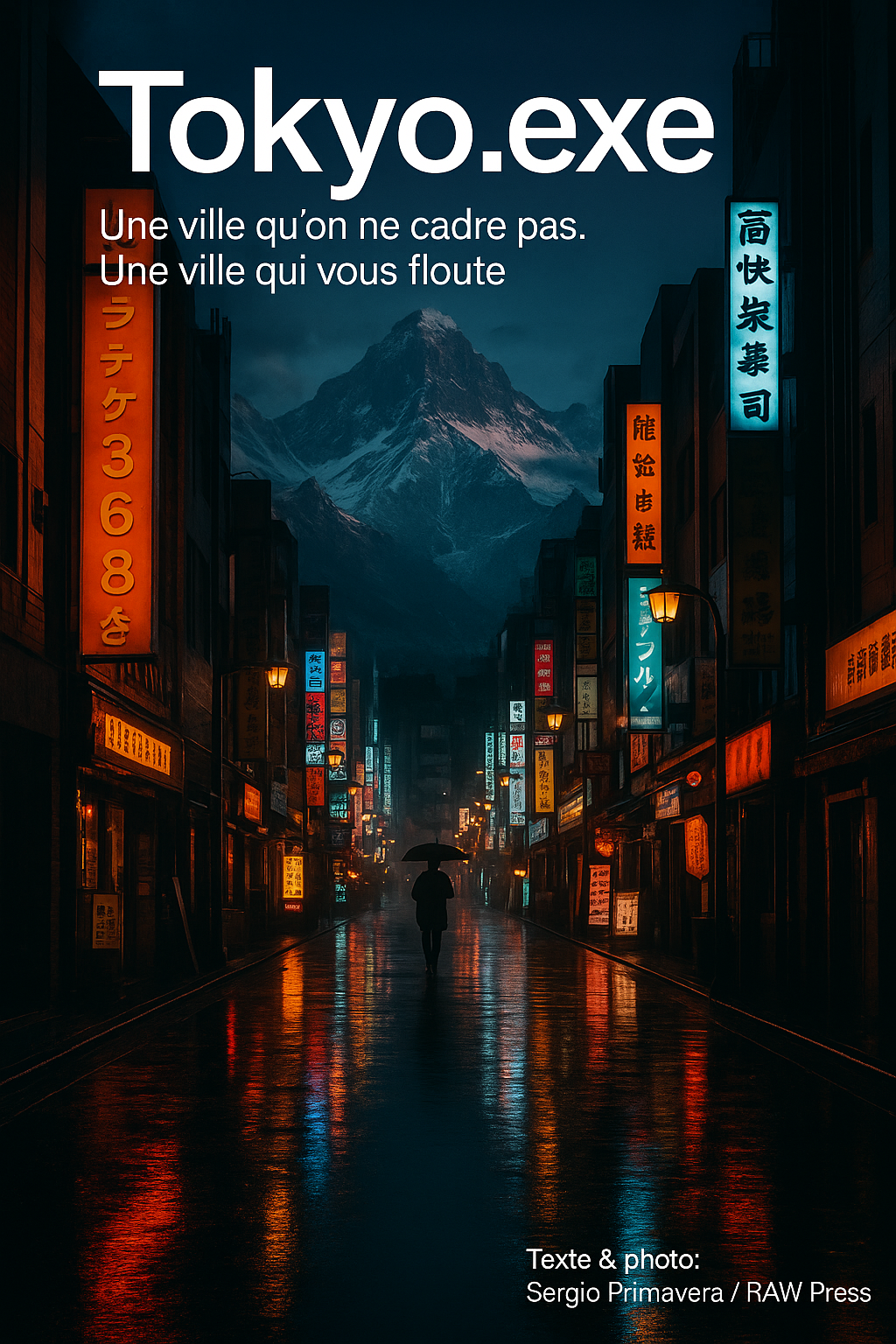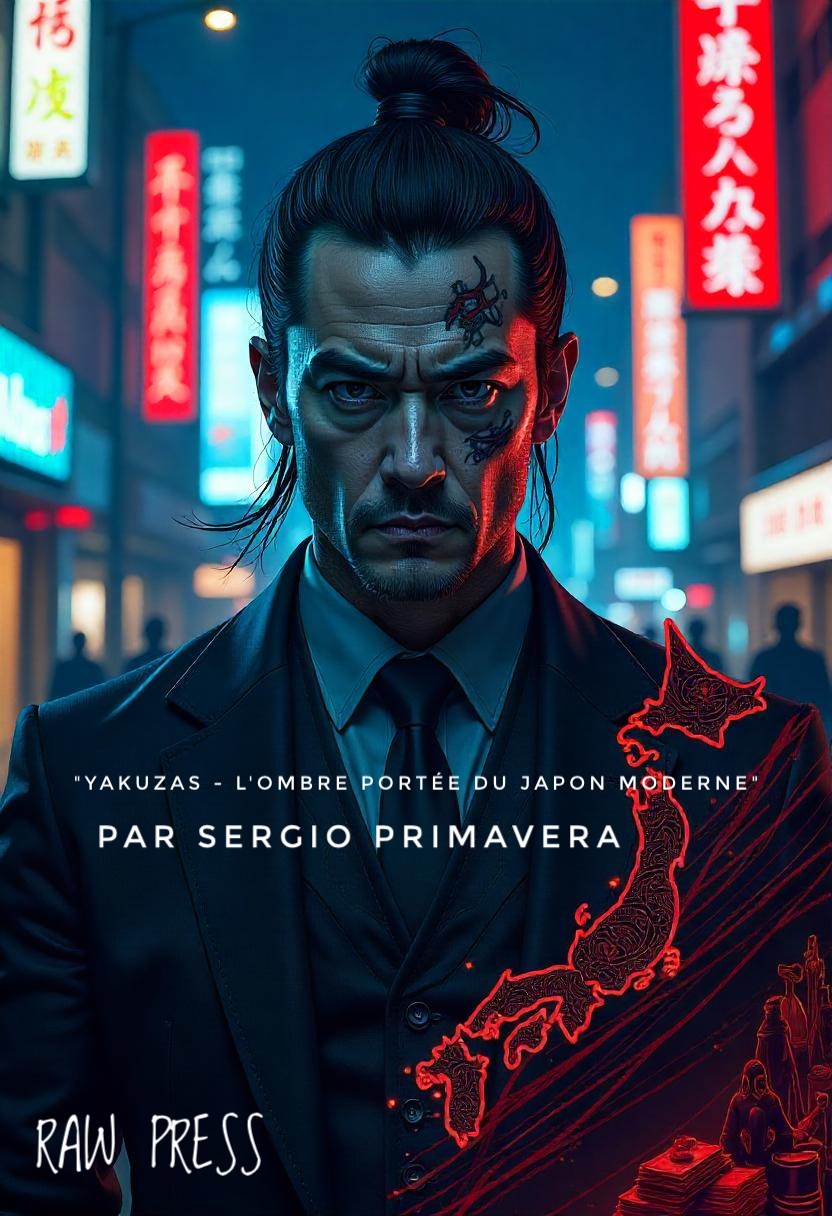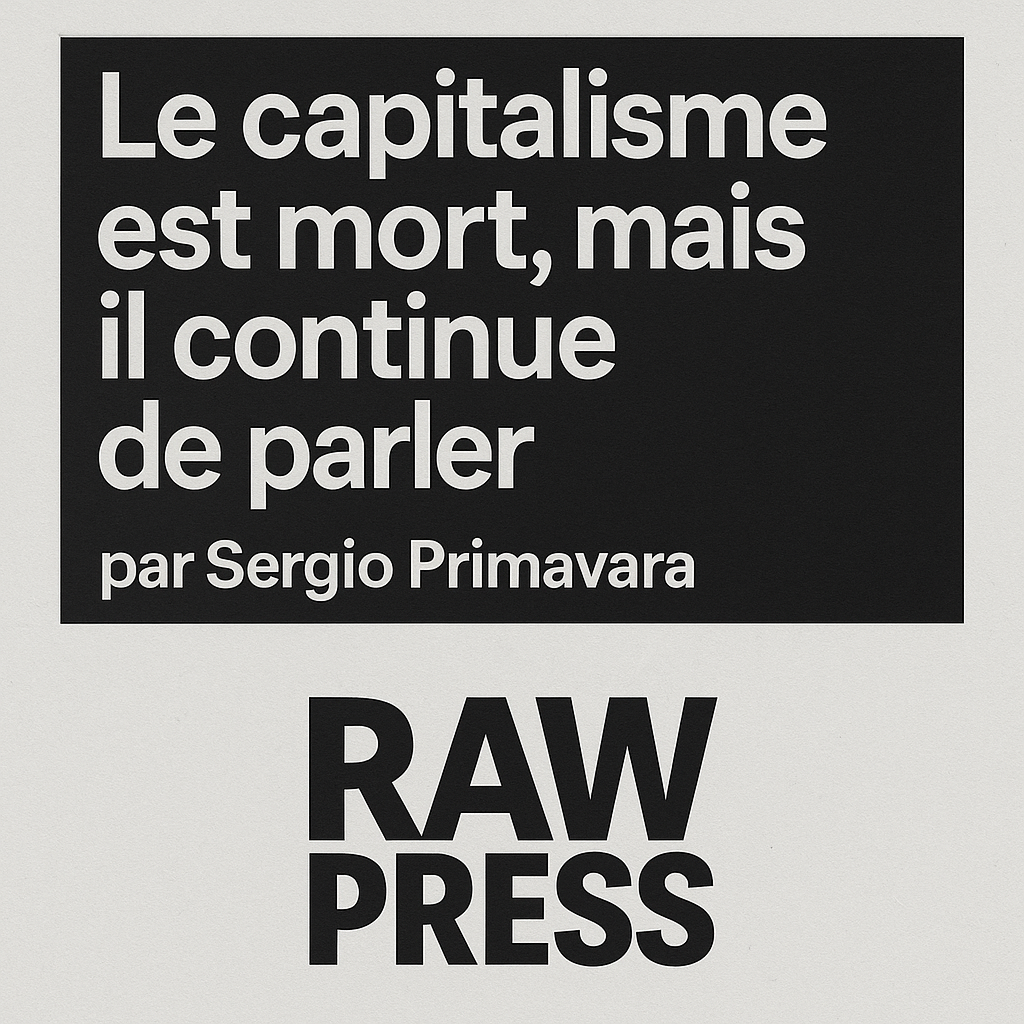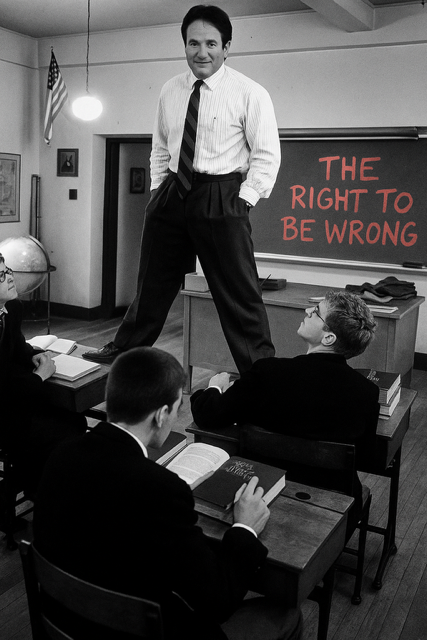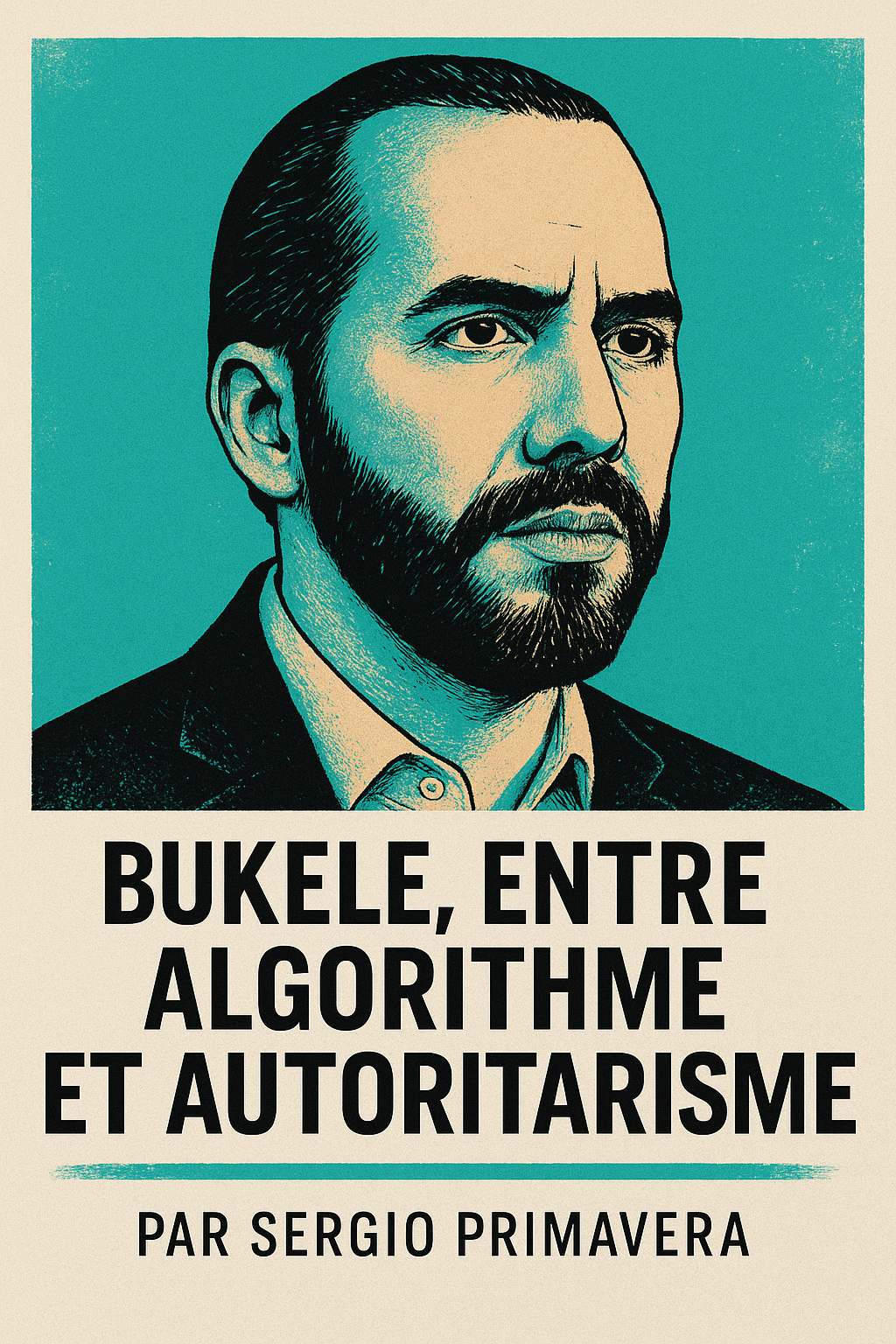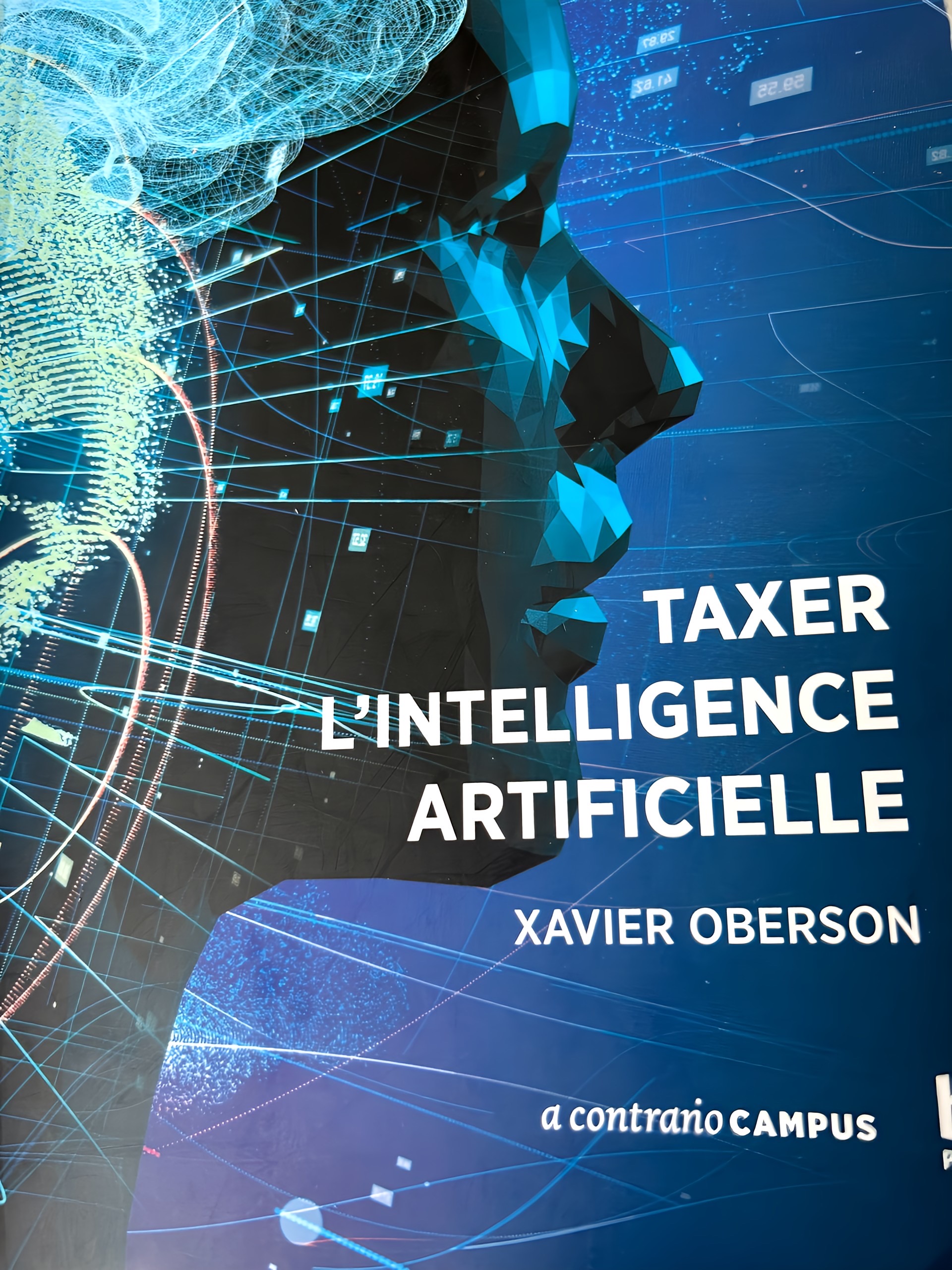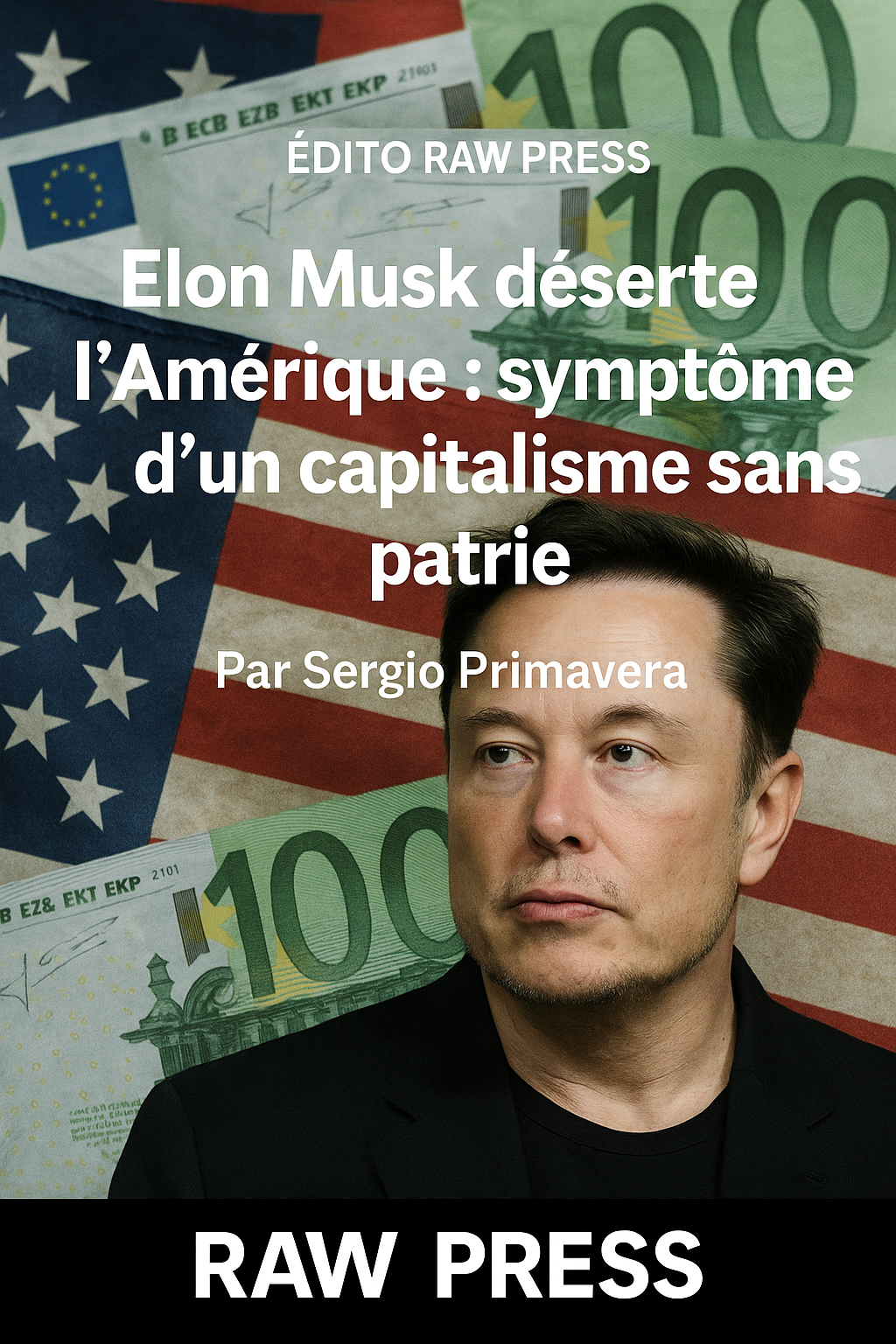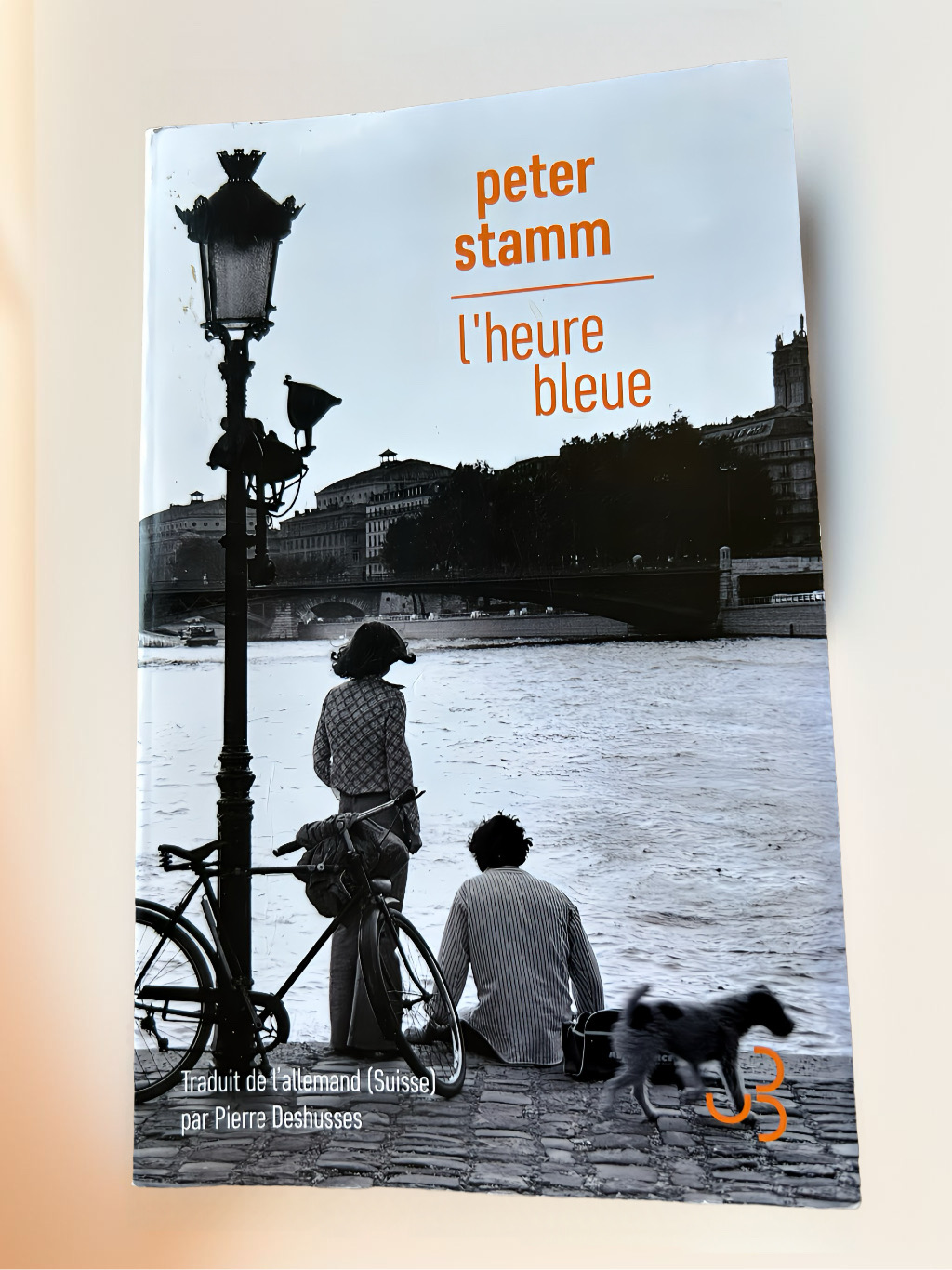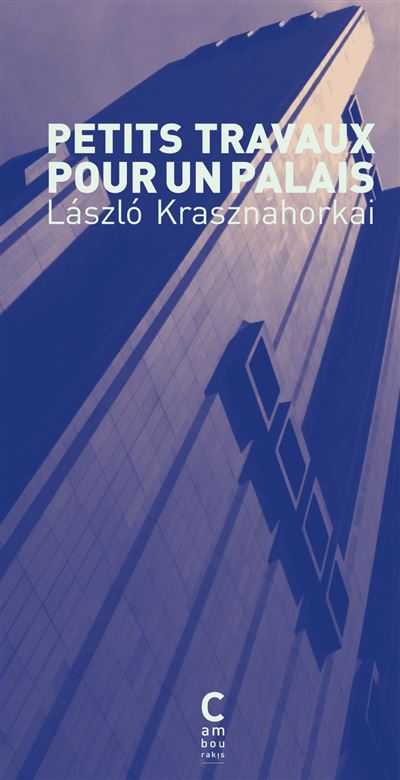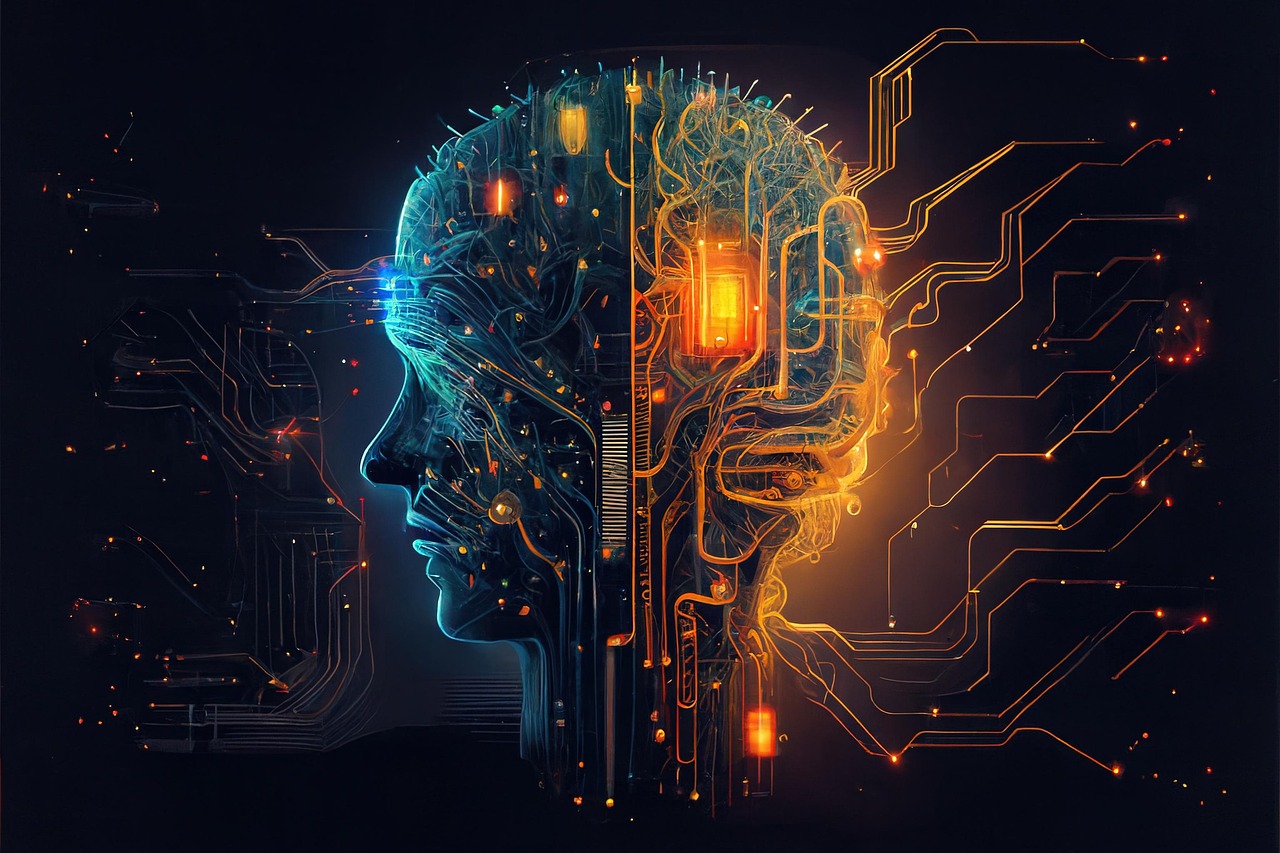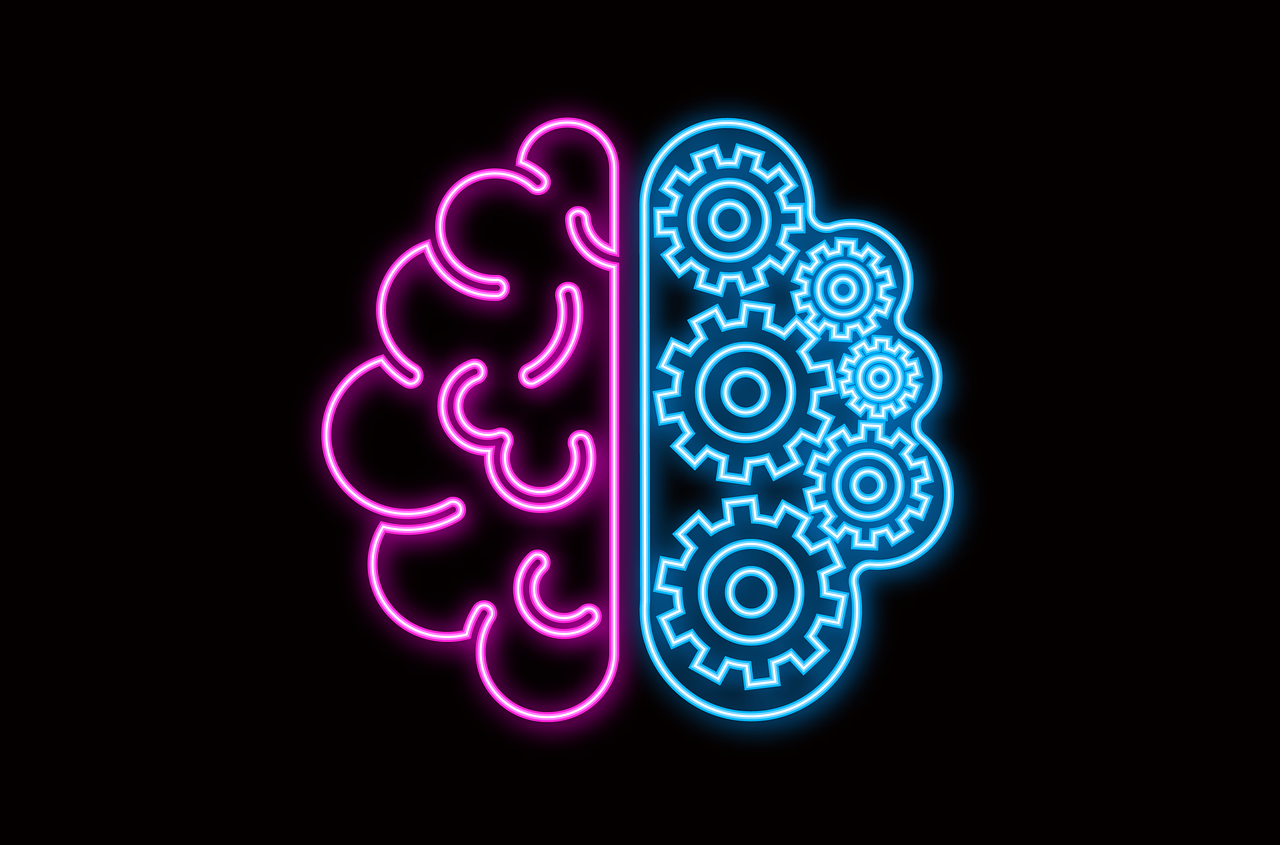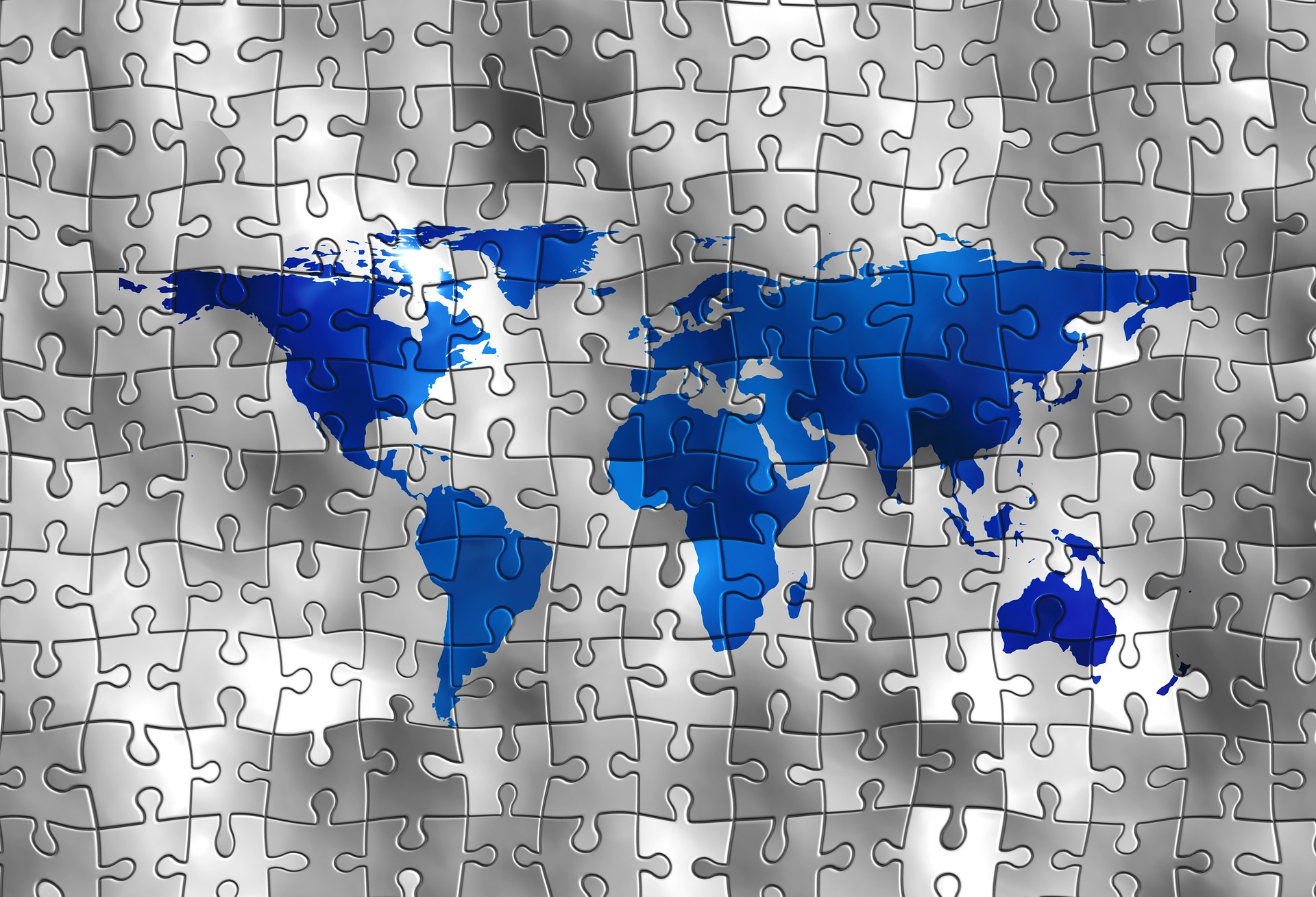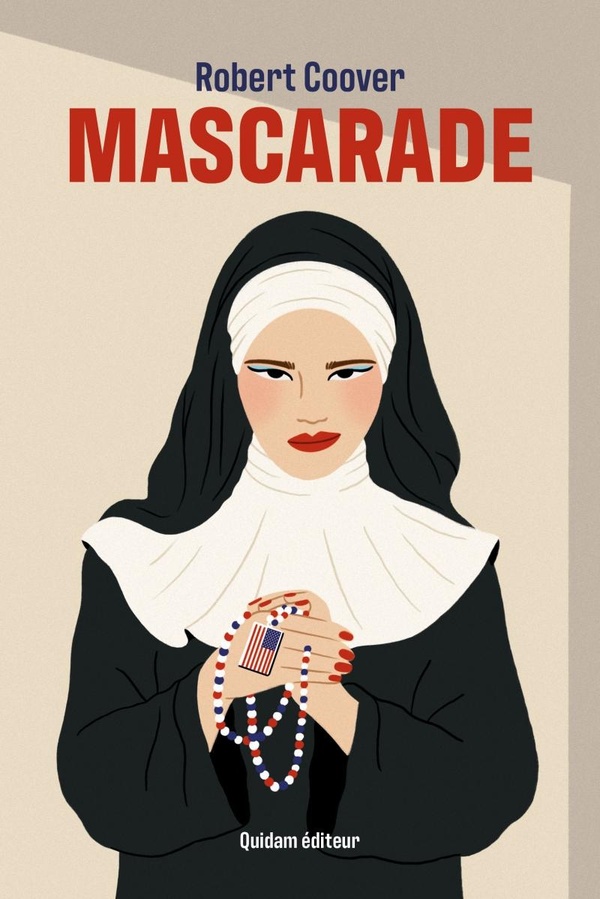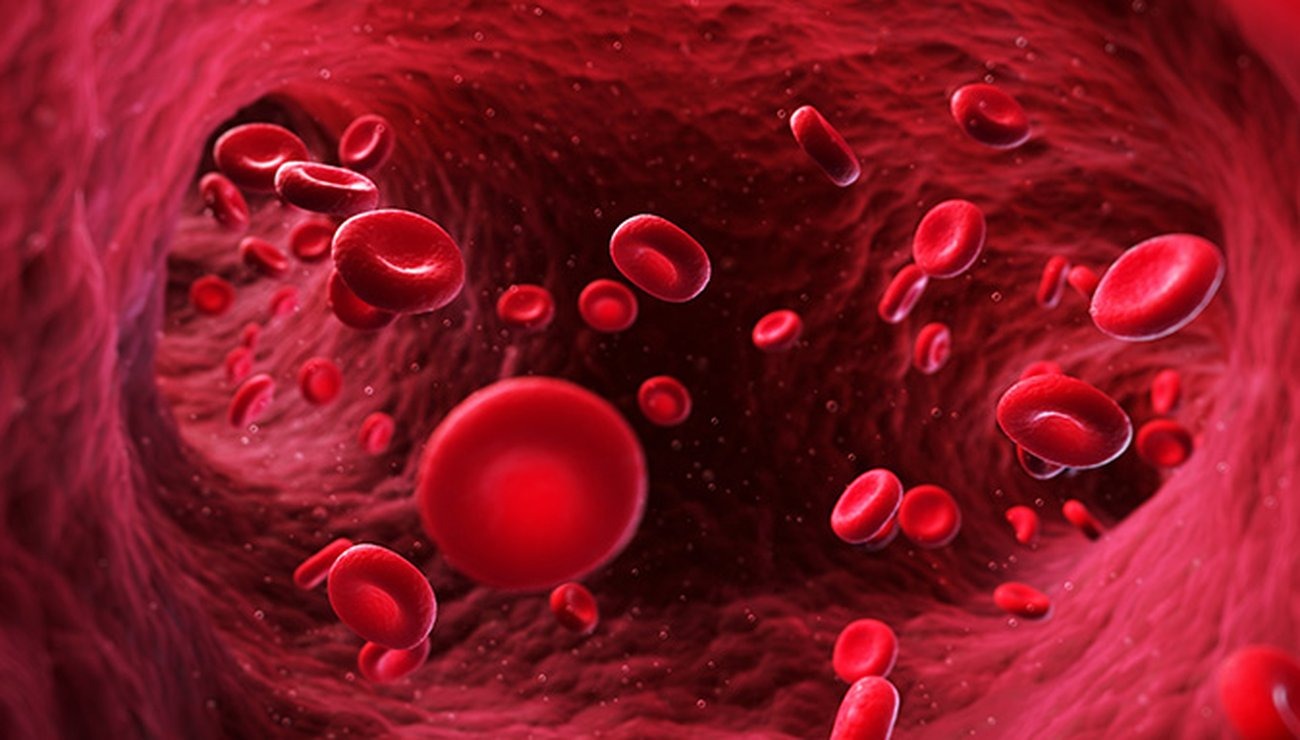Les IA peuvent-elles vraiment agir avec éthique et bienveillance ?

L’idée des « Machines de la grâce aimante », potentiellement attribuée à Dario Amodei, soulève une réflexion fascinante sur le futur de l’intelligence artificielle et sur la façon dont elle interagit avec les humains et le monde. Cet essai, s’il existe réellement sous cette forme, semble allier deux concepts qui, à première vue, paraissent incompatibles : la rigueur technologique froide des machines et la chaleur éthique et humaine que l’on attend d’une « grâce aimante ».
Ma réflexion personnelle : Peut-on créer des machines réellement éthiques ?
Quand on pense aux avancées récentes de l’intelligence artificielle, il est facile de s’émerveiller de ses prouesses : modèles de langage génératifs, IA capables de diagnostiquer des maladies, systèmes d’aide à la décision dans presque tous les domaines. Pourtant, ces technologies sont souvent dépourvues de la profondeur morale ou émotionnelle qui guide, ou du moins influence, les décisions humaines. D’où cette question cruciale : est-il possible de programmer la grâce ?
Le concept de machines « gracieuses » pourrait évoquer un avenir où les systèmes IA ne sont pas seulement des outils puissants mais aussi des entités capables de prendre en compte la complexité des émotions humaines et de prendre des décisions qui ne sont pas seulement optimisées pour l’efficacité, mais pour le bien-être global.
L’éthique, un défi pour l’IA
Les réflexions sur la sûreté de l’IA auxquelles Dario Amodei a contribué se concentrent sur cette notion. Une IA qui fonctionne bien n’est pas nécessairement une IA qui fait le bien. Le problème est que nos critères d’évaluation de la « bonne action » sont souvent subjectifs, dépendant du contexte culturel, social et personnel. Comment une machine peut-elle comprendre ces nuances ? Une IA pourrait être programmée pour agir avec bienveillance, mais cette bienveillance est-elle interprétée de manière universelle, ou reste-t-elle une interprétation biaisée par ceux qui la conçoivent ?
Vers une IA de confiance ?
Les efforts déployés pour la création d’IA « gracieuses » se concentrent sur la minimisation des risques tout en maximisant les bénéfices. Dario Amodei, par exemple, se concentre sur la question de savoir comment limiter les comportements nuisibles des IA sans limiter leur utilité. En cela, il suit une ligne de pensée où l’IA n’est pas simplement vue comme un outil à utiliser, mais comme un « partenaire » dans notre monde, avec un rôle éthique actif à jouer.
Mais, et c’est là un point de friction important, peut-on réellement faire confiance à ces machines pour qu’elles soient « aimantes » ou même éthiquement responsables ? Peut-on déléguer à une IA la gestion de conflits humains ? Ces questions sont cruciales pour l’avenir de l’IA et notre rapport à celle-ci.
Ma position de journaliste sur ce sujet complexe
En tant que journaliste, je ressens une fascination croissante pour cette intersection entre la technologie et l’éthique. Si l’IA est aujourd’hui capable de prouesses inimaginables il y a encore quelques années, son évolution soulève une série de questions existentielles pour nous, en tant qu’êtres humains. Comment veiller à ce que les systèmes que nous créons ne nous échappent pas, ne nous surclassent pas ou ne fassent pas des choix qui nous seraient préjudiciables ? Il faut continuer à dialoguer, débattre, et à poser les bases pour des IA à la fois puissantes et responsables.
L’humanité doit rester au centre de ce développement, en orientant ces technologies dans une direction qui ne perd pas de vue la grâce et l’humanité qu’elles sont censées servir. Dans un monde où les machines deviendront de plus en plus présentes, c’est peut-être à nous, les humains, de définir ce que signifie vraiment être « aimant » — pour ensuite l’insuffler dans nos créations.
Cet article n’a pas pour but d’apporter une réponse définitive, mais d’ouvrir la discussion sur ce que pourrait signifier cette grâce aimante et sur les défis moraux qui l’accompagnent. La promesse de machines capables de bienveillance, de compassion, et d’empathie pose inévitablement la question de leur conception, de leur contrôle, et de leur impact sur la société humaine. Quel rôle devons-nous laisser à l’IA dans notre quotidien, et surtout, jusqu’à quel point sommes-nous prêts à accepter qu’elle prenne des décisions, non plus basées sur des algorithmes froids et mathématiques, mais sur une imitation des émotions humaines ?
Ce dilemme, entre la quête de machines plus humaines et la crainte des dérives qu’elles peuvent entraîner, est au cœur du débat sur l’avenir de l’intelligence artificielle. Il est essentiel que cette réflexion ne soit pas seulement technique, mais qu’elle inclue des questions philosophiques et éthiques sur la place de l’humain face à la technologie. Car si ces machines peuvent exprimer une forme de « grâce aimante », qui leur assure que cette grâce sera alignée sur les valeurs fondamentales de l’humanité ?
En fin de compte, c’est peut-être moins la question de savoir si les machines peuvent être aimantes qui importe, que celle de savoir comment nous, humains, choisirons d’interagir avec elles et de guider leur évolution. Ce dialogue, entre éthique et technologie, est sans doute l’un des plus cruciaux de notre époque.
Retrouvez-nous
sur vos réseaux