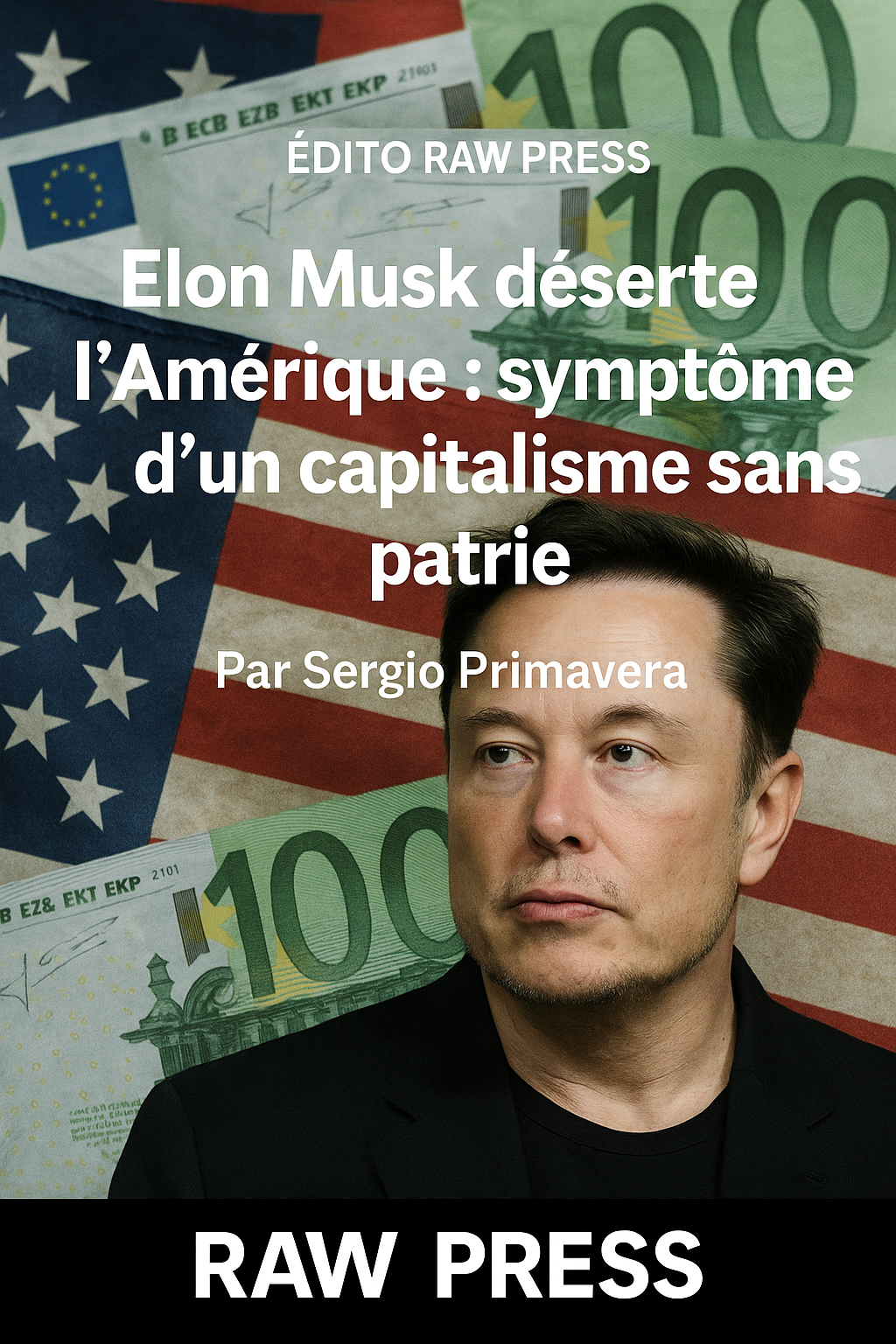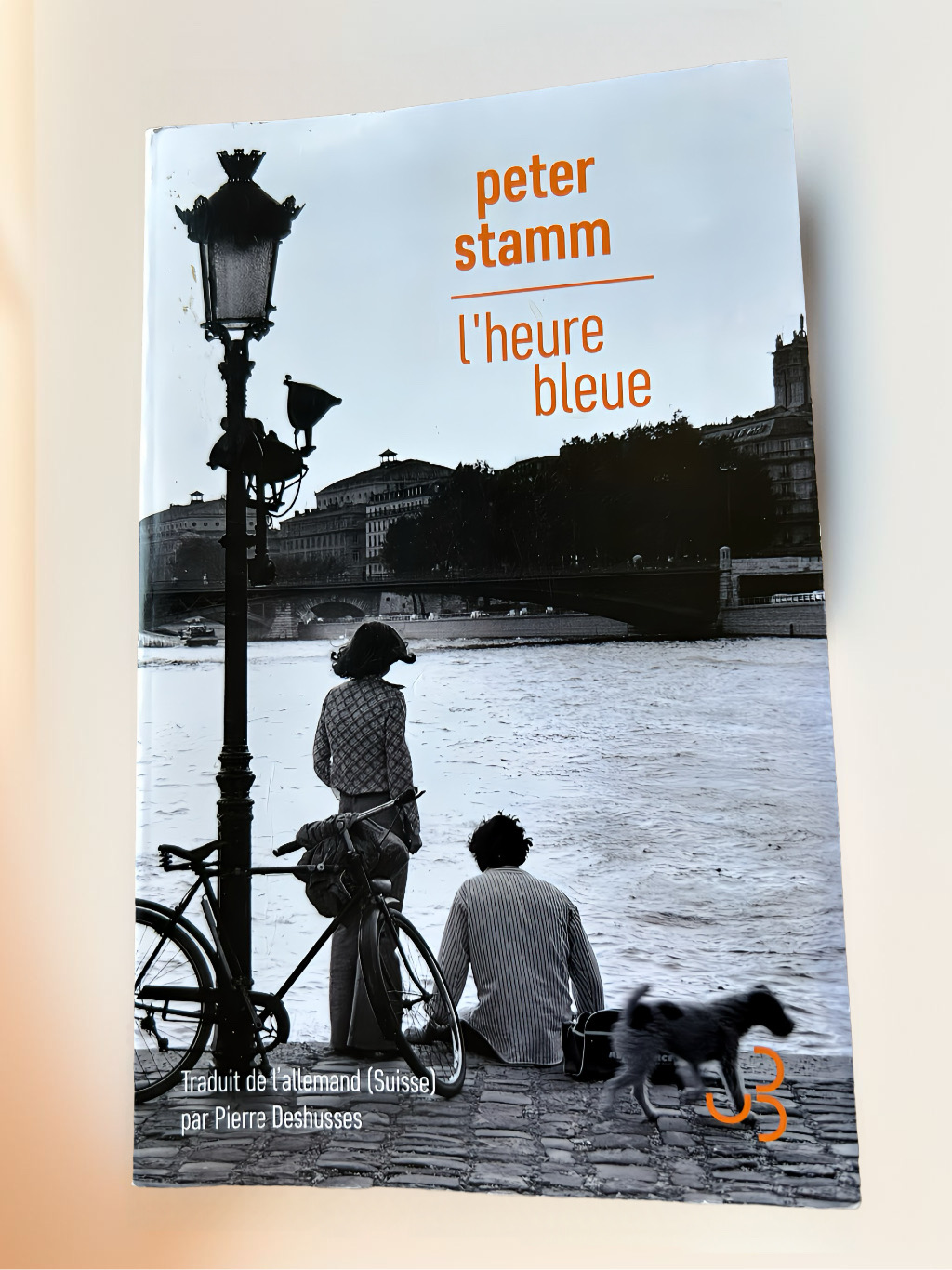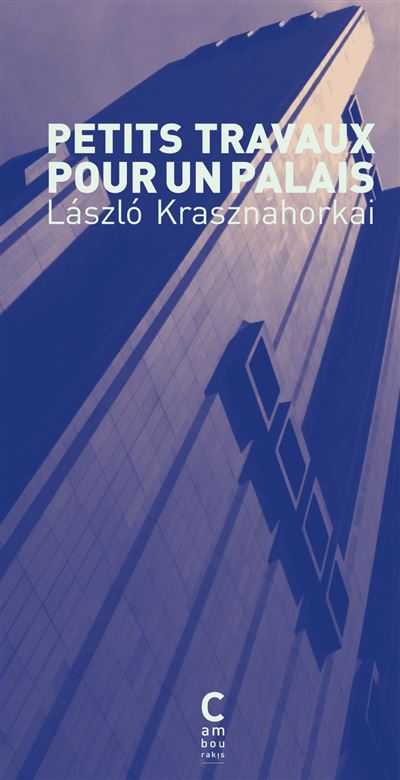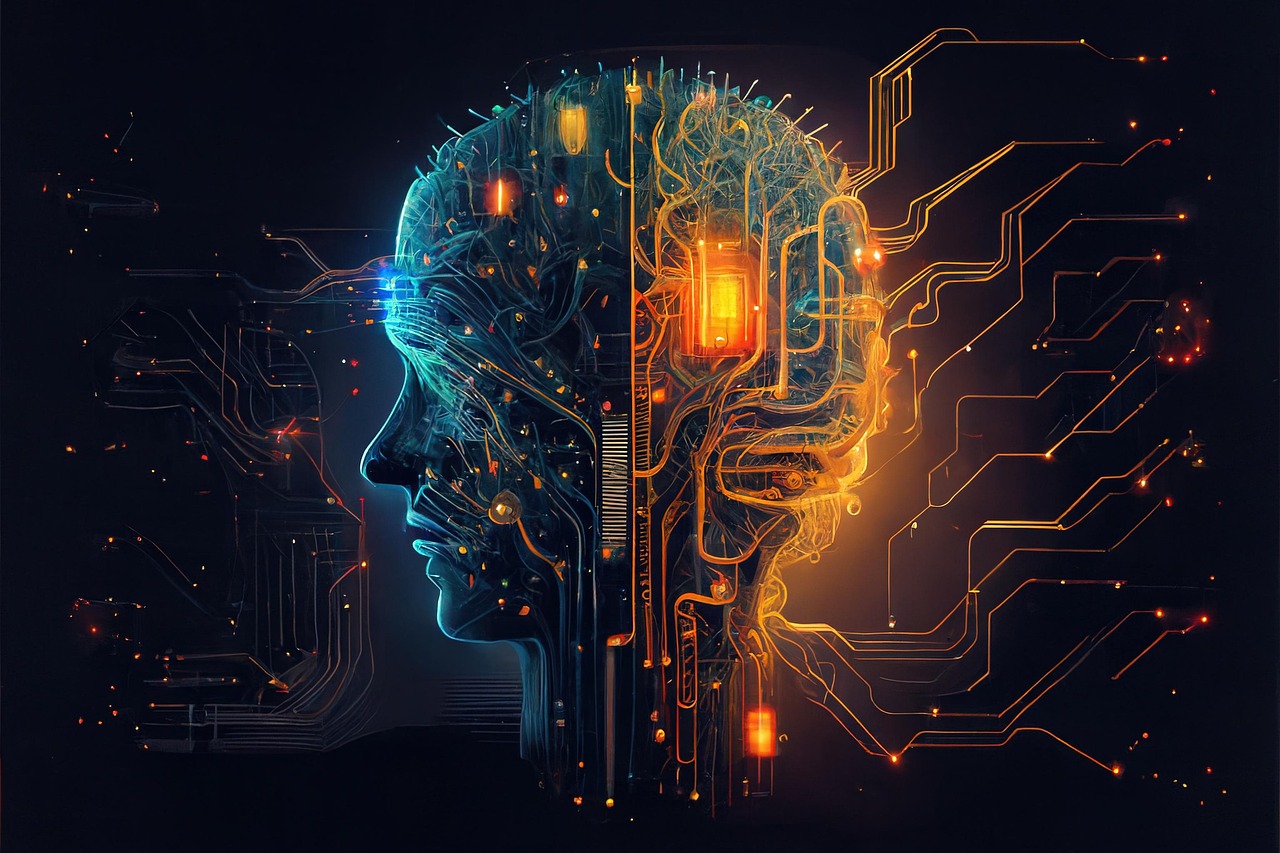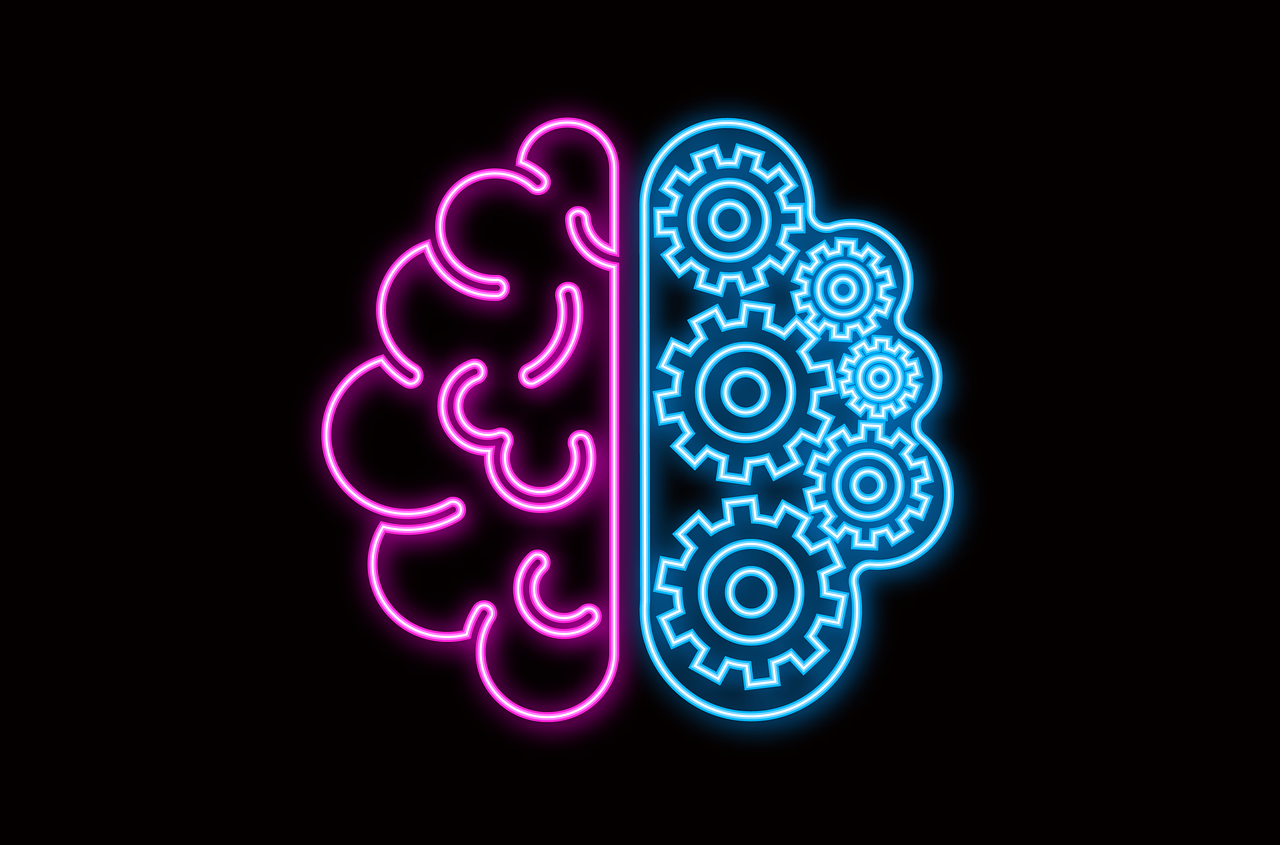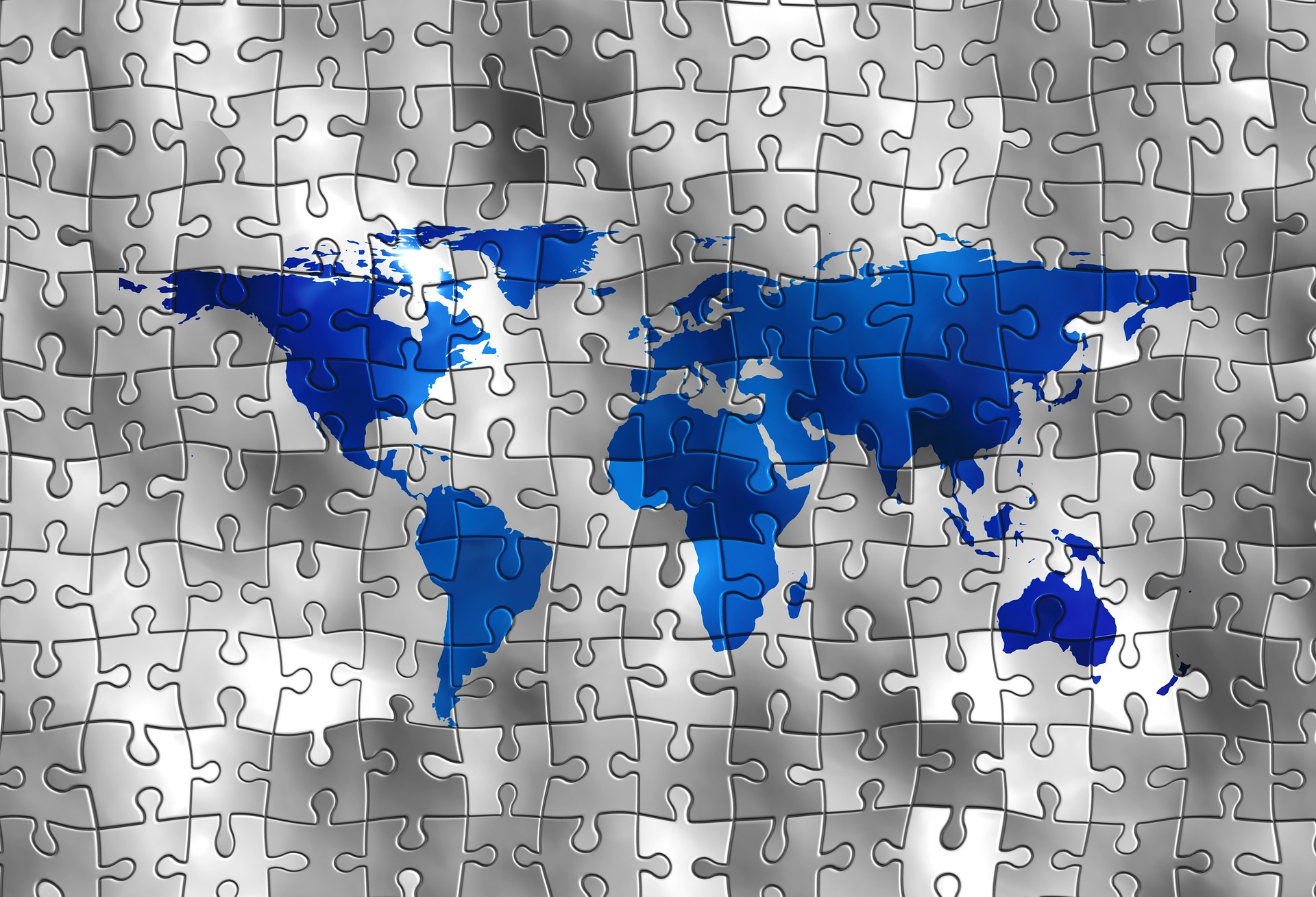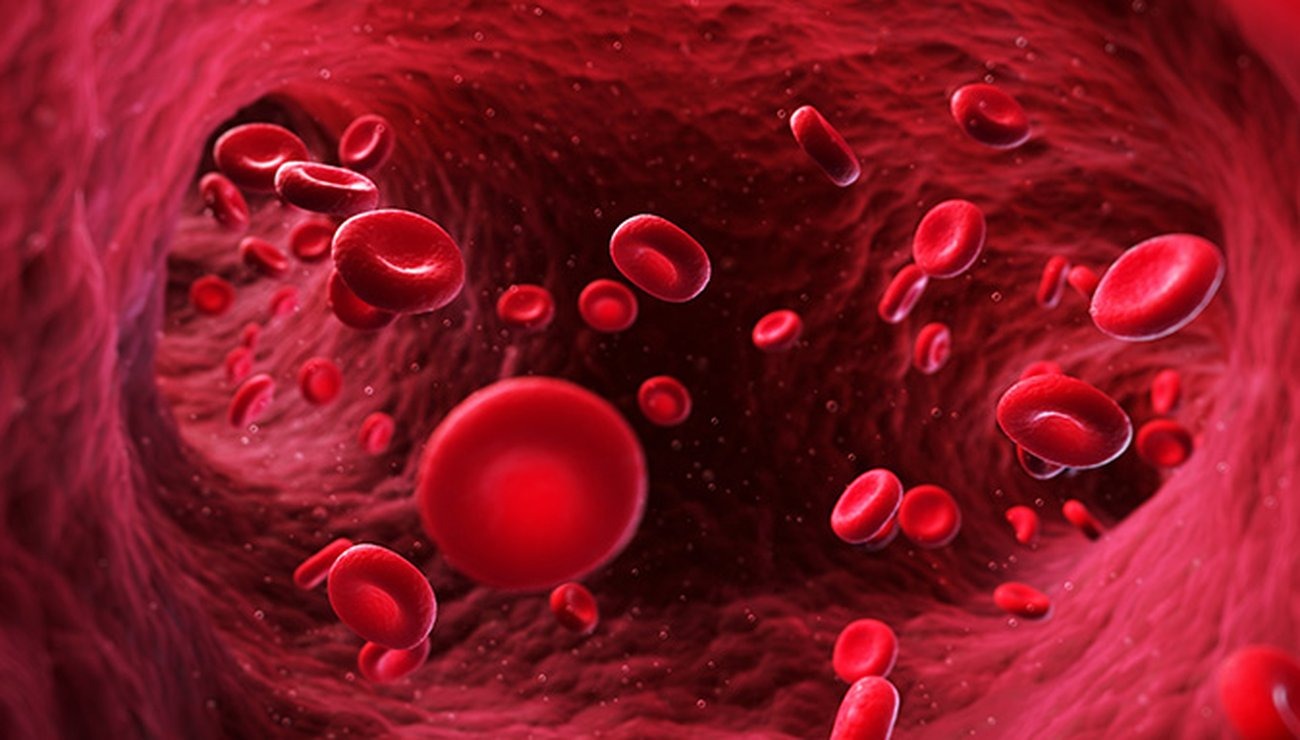Chrawnique littéraire : Du bal des ardents à la danse macabre
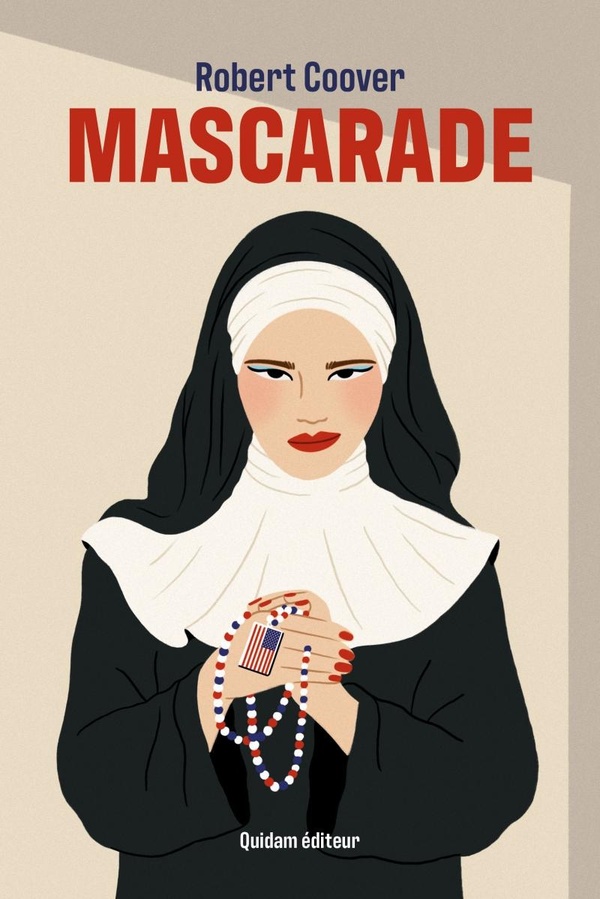
Robert Coover est mort à la fin de l’année 2024, à l’âge de quatre-vingt-douze ans, quelques semaines après avoir mis un point final à Mascarade, ce court roman que la structure originale rend fascinant. Auteur culte pour les uns, parfait inconnu pour les autres (en majorité), Coover aurait, de l’aveu de son traducteur, le romancier Stéphane Vanderhaeghe, manqué d’un succès commercial pour se hisser au niveau d’un Philip Roth, Don DeLillo ou Thomas Pynchon. La filiation est audacieuse. Et, à vrai dire, les premières pages de sa Mascarade rendent cette comparaison avec ces géants des lettres américaines hasardeuse.
Pourtant, on revoit très vite notre jugement. Car les premières pages, au cours desquelles nous suivons les pensées d’un barman vulgaire, caricature trop facile du « laissé-pour-compte » que l’on voit trop souvent dans la littérature américaine, laissent la place à une narration déroutante. Telle une puce, le lecteur saute d’une psyché à une autre. Nous laissons le barman à ses divagations pour entrer dans la tête d’un saxophoniste, que nous quittons cinq pages plus loin pour l’esprit d’une serveuse – et ainsi de suite pendant les cent soixante-cinq pages que dure le roman. Ces changements ne s’effectuent pas artificiellement par un retour à la ligne ou au commencement d’un nouveau paragraphe, non – et cela est habile ! – le changement peut parfois s’effectuer dans une même phrase, ou au cours d’un dialogue, poussant le lecteur à une gymnastique mentale passionnante pour ne pas perdre le fil.
Portraits de l’humanité
Plusieurs narrateurs, donc, sur un temps très court (à peine quelques pages à chaque fois), différentes voix donc différents niveaux de langue, différentes histoires, différents vécus, racontant, agglomérés tous ensemble, un seul moment, à savoir quelques heures d’une soirée d’apocalypse joyeuse, soirée privée se déroulant au dernier étage d’un penthouse de luxe. Tous les profils s’y retrouvent de façon improbable, brouillant d’un coup les catégories sociales, les milieux, les âges et les parcours. Toute l’humanité est là, sous nos yeux, et leurs pensées défilent : un professeur émérite, un compositeur réputé, des femmes d’affaire, des mafieux, des petits voyous perdus, des camés, tous se côtoient dans ce joyeux bal des ardents où la folie n’est pas exclue. Coover arrive en très peu de temps à donner corps à tous ces personnages, témoignant d’une maîtrise peu commune. Toutefois, quelque chose cloche et le doute s’instille au rythme des pages, épuisant l’insouciance, tandis que le lecteur ne se lasse jamais de passer d’un point de vue à un autre de façon totalement aléatoire ; comment ces gens se sont-ils retrouvés ici ? Personne ne sait comment il a eu vent d’une telle fête. Personne ne se souvient de qui l’a invité – d’ailleurs, personne ne connaît personne ici. Personne ne parvient à se souvenir comment il a pu atterrir là. Et, pire encore, personne ne sait comment sortir d’ici.
Un rendez-vous avec la Mort
Le joyeux bal des esprits indolents devient réflexion métaphysique. Car la question de l’existence se mêle à ce qui n’aurait dû rester qu’une réception comme une autre chez les riches de ce monde. Tout en haut de cet immeuble – si grand qu’en se penchant au- dessus du toit-terrasse, on ne voit plus le sol – dont le voisinage n’est plus que nuages et immensité du ciel assombri par la nuit, c’est autre chose que l’Humain qui préoccupe ceux qui dansent. Ne commencent-ils pas à se rendre compte que s’ils ont été conduits ici, c’est parce qu’ils avaient rendez-vous avec la Mort ?
Dans cet immeuble devenu royaume des cieux et tribunal du jugement dernier, les figures mystiques affluent : on croise un prêtre fat, une nonne étrange déambulant parmi les convives, jusqu’à ce qu’apparaisse la figure d’un barbu qui pourrait être une sorte d’incarnation christique. Tout devient fascinant. Le glissement d’une psyché à une autre anticipe le glissement vers une métaphysique qui nous échappe. Il ne reste plus qu’à capituler face à l’incompréhension. Il faut alors se délester de nos costumes pour faire apparaître qui nous sommes vraiment, à l’intérieur de nous-mêmes. Les pensées mises à nu de tous les invités par le procédé narratif laissent place à la mise à nu ultime, organique, triviale : la fin de la chair et le dévoilement du squelette. Place à la danse macabre, aussi ludique que celle de Camille Saint-Saens, aussi violente – et en colère ! que celle de Liszt. Les squelettes se mettent à danser – quel meilleur point final, pour Robert Coover, à une œuvre qu’il est urgent de découvrir.
Robert Coover – Mascarade – traduit de l’anglais par Stéphane Vanderhaeghe – éditions Quidam – 2025 – 165 pages
Retrouvez-nous
sur vos réseaux