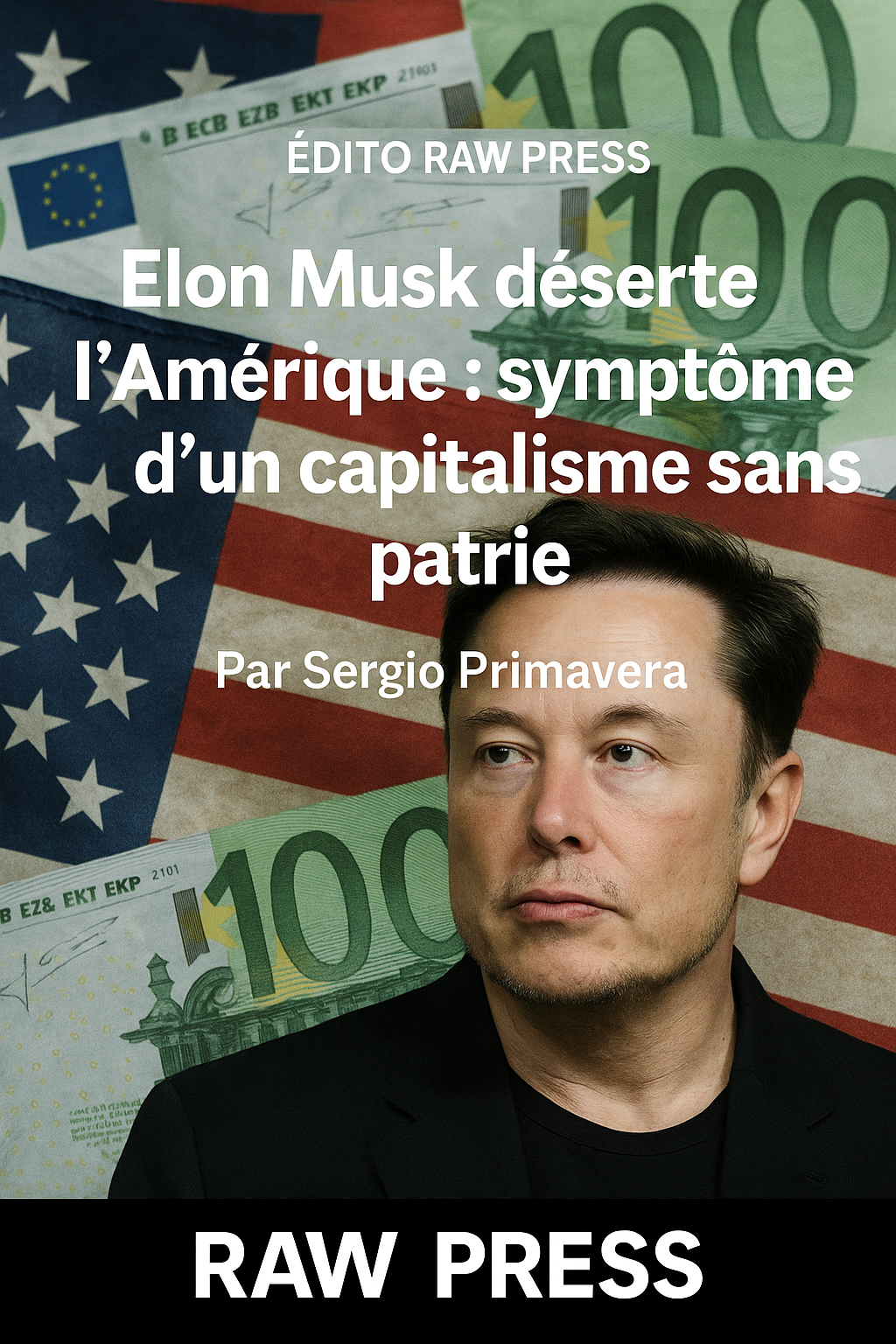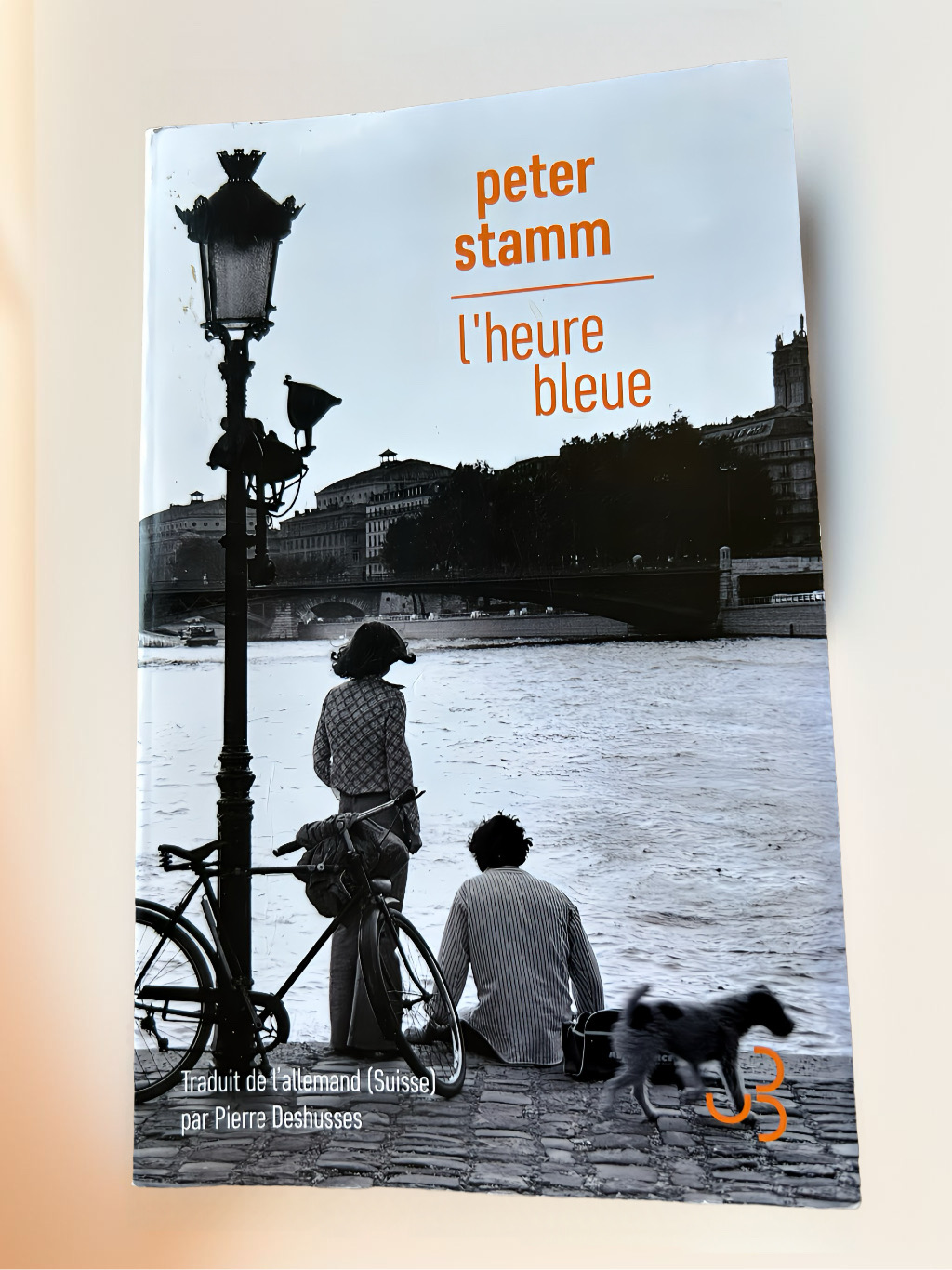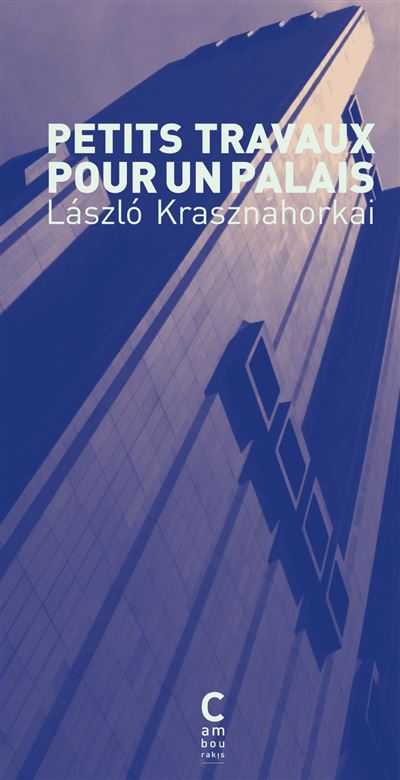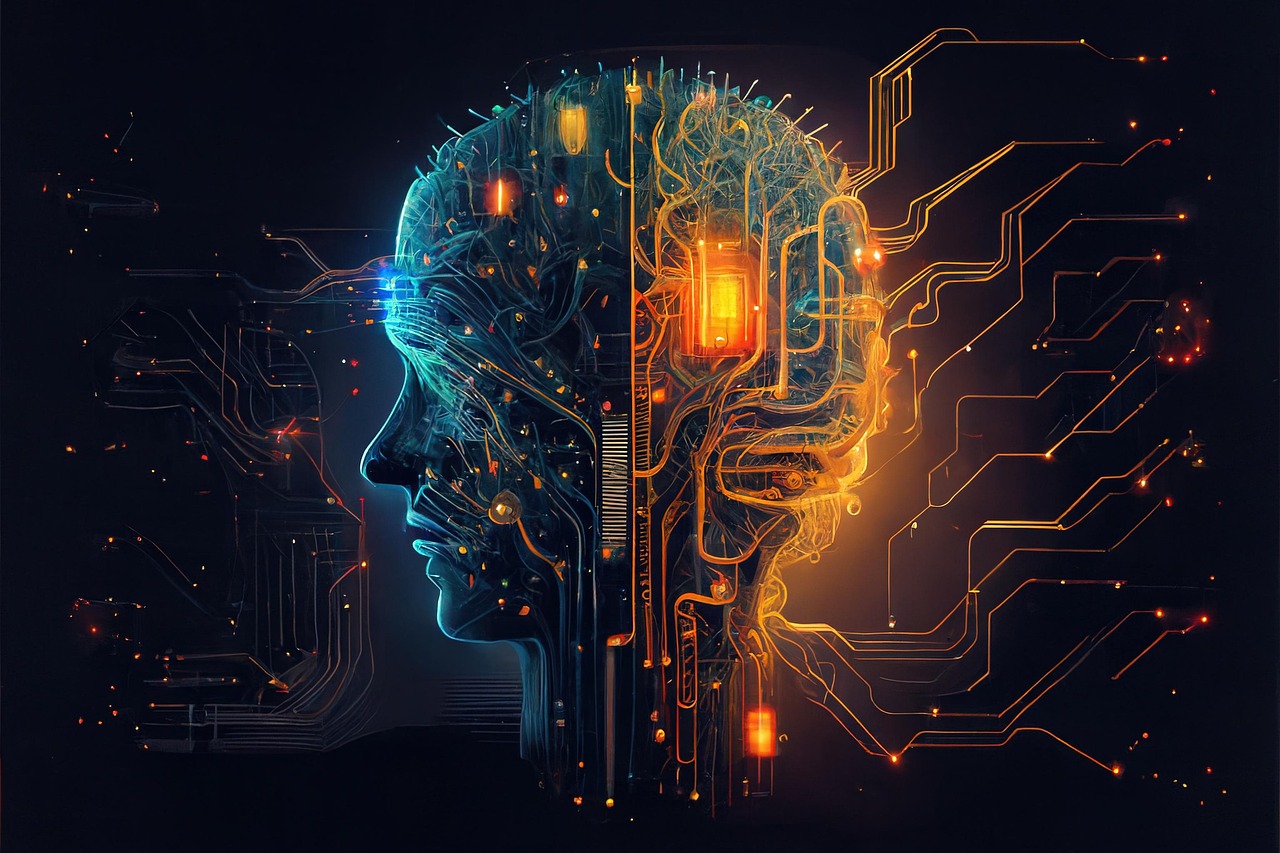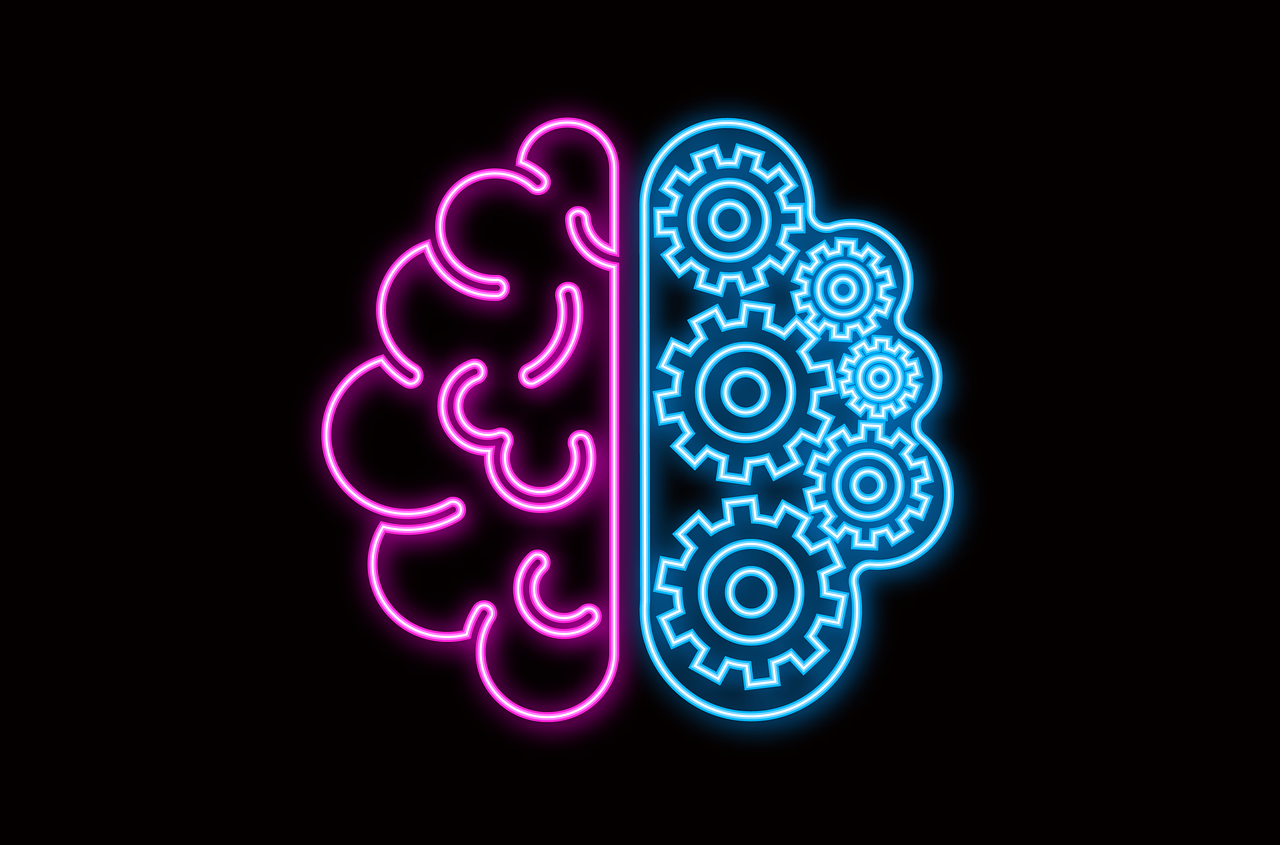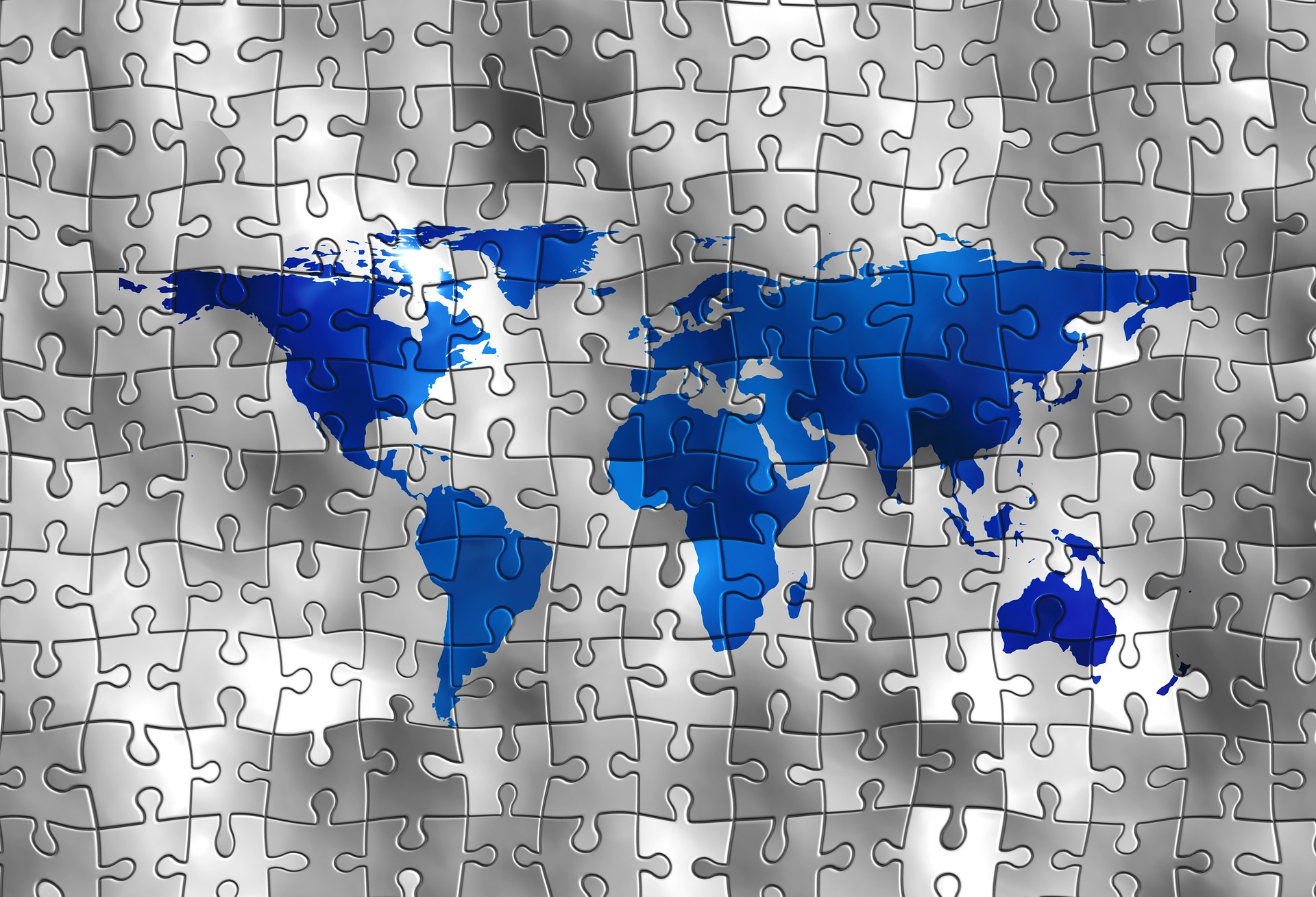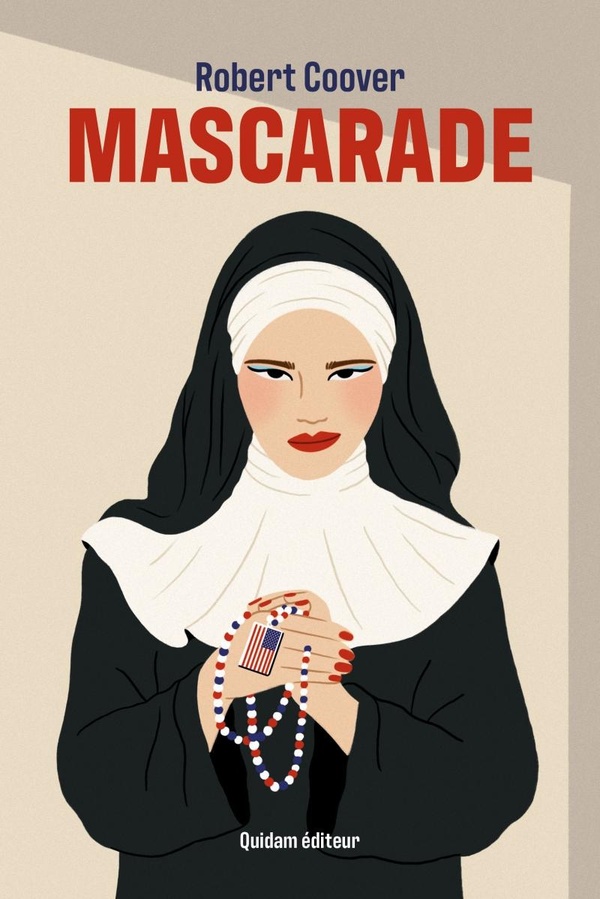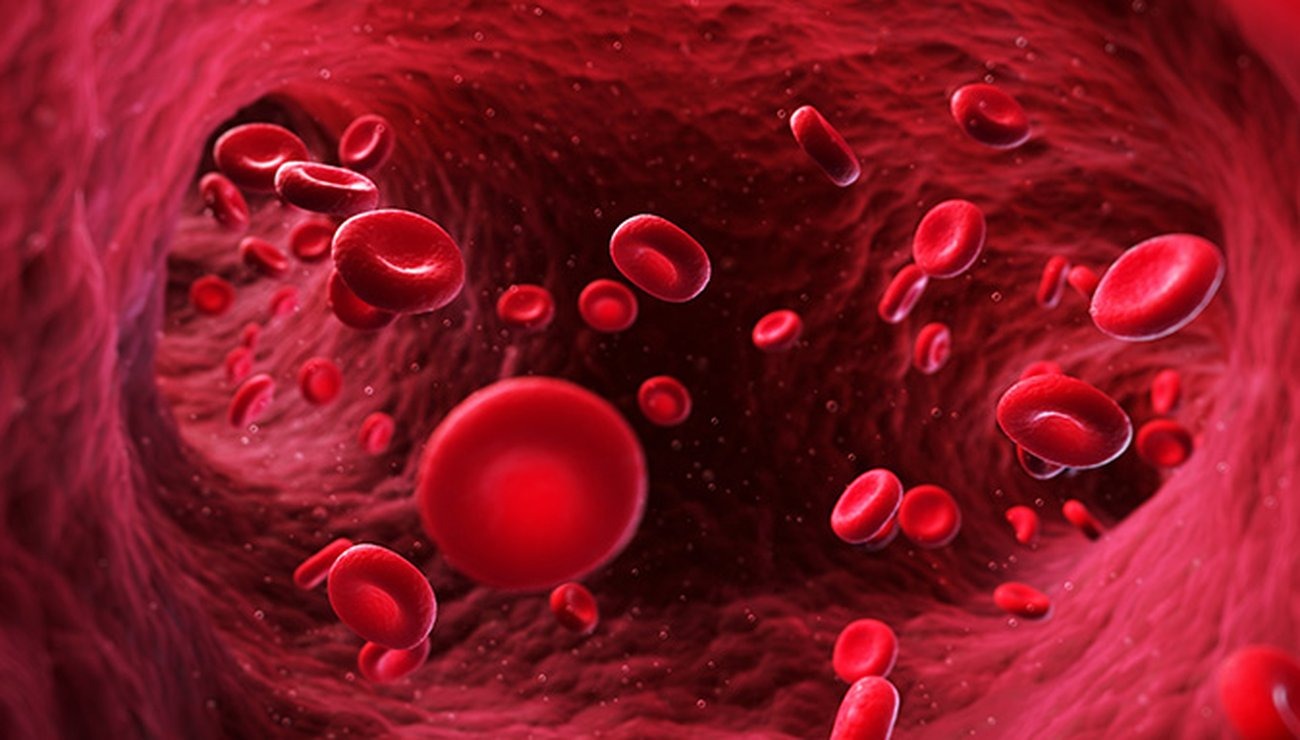Chrawnique littéraire : Portrait du fantôme contemporain

Une facétie de l’ère du temps – délicieusement ironique, formidablement mordante – offre à Patrice Jean dans son dernier roman La vie des spectres, le point de départ d’une réflexion profonde, passionnante et réjouissante sur le temps qui passe et la trace que chaque génération laisse – en bien comme en mal ! – à la marche de l’Humanité.
Découpé en deux parties, le roman laisse la parole à un « scélérat » qui deviendra « spectre ». Jean Dulac nous raconte son histoire, celle d’un homme disgracié. Pour quel motif a-t-il tout perdu ? Son incapacité à faire partie de ce monde qui loue à outrance le « Progrès » ? Sa trop grande lucidité qui lui permet de souligner tous les paradoxes de notre modernité « bienveillante » et « inclusive » ? Ou bien est-il la victime du temps qui passe et qui condamne tous ceux qui ont dépassé l’âge de comprendre les grandes questions qui animent la jeunesse – la seule catégorie de la population qui, si elle n’a pas toujours raison, a le droit de se tromper ?
Patrice Jean, dans le style mordant qui le caractérisait déjà dans ses excellents romans L’homme surnuméraire et Rééducation nationale (tous deux parus aux éditions Rue Fromentin), fait d’ironie et d’habileté narrative, décrit ce piège qui se referme sur son narrateur. Jean Dulac, la cinquantaine, journaliste culturel, voit son fils menacé d’être expulsé de son lycée après avoir diffusé, à la suite de son ami Moussa, une vidéo pornographique impliquant une surveillante. Mais la surveillante en question, Rachel, étant, selon les termes du fils, « une grosse facho », ledit fils ne voit pas où est le mal. Quelques jours plus tard, la pauvre victime, Rachel, deviendra l’affreux bourreau, lorsqu’elle sera soupçonnée – plus exactement désignée et aussitôt condamnée – d’être à l’origine du passage à tabac dont sera victime Moussa – qui fut, on s’en souvient, en diffusant largement la vidéo problématique, le bourreau de Rachel.
Or, dans l’opinion, sur l’échelle contemporaine de la morale, diffuser une vidéo de revange porn est moins inacceptable que d’être tabassé pour sa couleur de peau. Moussa devient donc la victime de sa propre victime, et par la même l’emblème de la lutte antiraciste, quand Rachel devient l’horrible diablesse rampante et nauséabonde méritant toutes les insultes.
Le destin de Jean Dulac basculera à l’instant où il apprendra que son propre fils a couvert le mensonge de Moussa, aucunement tabassé par des « fachos » à la demande de Rachel, mais pour un tout autre motif lié au trafic de drogue. Très vite, la vérité éclate au grand jour – dans l’indifférence générale, puisque les médias, si prompts à relayer le passage à tabac de Moussa, préfèrent rapidement parler d’autre chose que du mensonge du lycéen, préférant ignorer leur erreur que reconnaître s’être fait berner – et Jean est accusé par son fils, par sa femme, ainsi que par tous ses collaborateurs au journal d’être un horrible personnage sans moral, un traître ignoble incapable de défendre son fils, un triste représentant d’un monde qu’il est devenu urgent de renverser.
L’effacement involontaire au monde
Et c’est bien là le cœur du roman. Ce résumé ne s’intéresse qu’à la première partie du livre, celle au cours de laquelle le narrateur n’est encore qu’un « scélérat ». La seconde partie s’occupe du « spectre », et le roman prend alors une toute autre dimension. La satire de notre temps, si hilarante qu’elle soit, laisse place à une réflexion profonde et passionnante sur le monde qui change, sur les nouvelles interrogations qui traversent notre société, et le sentiment de dépossession, d’effacement, qui saisit ceux pour qui ces nouvelles questions sont, sinon incompréhensibles, du moins non essentielles. L’homme de cinquante ans devient alors, peu à peu, le fantôme de sa propre vie, à mesure qu’il se rend compte que les choses qui l’entourent lui échappent, que les cadres de sa pensée ont changé, que ce qui était acceptable avant ne l’est désormais plus, que les mots qu’il avait l’habitude d’utiliser, désormais, sont proscris.
Patrice Jean semble nous dire que la première disgrâce est celle du langage : « Nous vivons, ai-je pensé, l’ère du simulacre lexical, où les mots dissimilent plus qu’ils ne disent le réel. » Ainsi d’une gifle adressée à un professeur qui devient « un regrettable incident ». A cela s’ajoute l’idée que dire nous trahit. La parole est donc pervertie – elle ne sert plus à expliciter ce que nous pensons, mais davantage à le masquer, à l’opacifier. L’appauvrissement de la langue vient alors de ce renversement ; en un sens, nous nous protégeons, nous nous cachons derrière des formules creuses qui, si elles couvrent le silence, ne signifient plus rien.
Au-delà de cet aspect, Patrice Jean pose la question de l’homme qui s’efface, qui devient fantôme – le fameux spectre du titre, dont le roman fait le portrait. Jean Dulac fantôme dans sa famille (sa femme et son fils se sont détournés de lui, il a même été rapidement remplacé par un autre homme dans les bras de sa femme), ne frayant qu’avec des fantômes – dans l’appartement où il a trouvé refuge après que sa femme l’a chassé du domicile conjugal, apparaît chaque soir l’un de ses anciens amis de fac mort accidentellement, ou par suicide, à trente-et-un ans et qui a eu la chance, en un sens, de ne pas disparaître « de son vivant » – ou des gens en passe de le devenir – ainsi d’un autre ami perdu de vue qui prend contact avec lui pour lui annoncer sa mort prochaine, grignoté peu à peu par la maladie.
Le spectre comme un dédoublement
Mais la force de l’âge, contrairement à la jeunesse qui croit tout savoir malgré son inexpérience, est d’avoir suffisamment de recul pour comprendre que l’histoire se répète. « Nous sommes tous des répliques et des duplicatas errant à travers les siècles, dans l’ignorance de la répétition. » L’idée du double, du duplicata, est souvent reprise dans le roman, dans différentes variations et déclinaisons. Dulac a l’impression d’être un acteur devant choisir entre la tragédie et la comédie, imaginant ses doubles interagir en fonction de telle ou telle option (à ce titre, le théâtre a une grande importance dans le roman).
De plus, en tant que fantôme, il n’est plus un « prisonnier du présent ». A l’image de cet ami mourant que Dulac recroise et qui « ne sculptait pas seulement le présent et l’avenir, [mais] redessinait les contours de son passé », le fantôme a cette capacité à naviguer en arrière et d’occulter les moments honteux de son passé. Avant de plonger dans le néant, en se retirant du présent, il garde les souvenirs héroïques et peut se dédoubler – créer une vie rêvée, à la place de cette vie réelle dont il ne fait plus même partie.
Qu’est-ce qu’un fantôme, un spectre, sinon le double évanescent du vivant, sinon l’image projetée d’un individu ? Une image floue, qui s’efface, vouée à disparaître dans les limbes ?
« Nous oublions presque tout de nos vies, les inquiétudes jadis invincibles disparaissent une à une avec le temps. (…) Nos vies tombent dans l’oubli, non seulement aux yeux des autres, mais pour nous-mêmes. Les historiens tentent de conserver les hommes et les civilisations dans des livres : peine perdue. Il n’en reste que des ombres, des tombes, des tableaux ternis, des squelettes, des ruines, des murets éboulés. Les vies ont fui à travers un trou. »
Coupé du monde, le traversant sans pouvoir l’habiter, Jean Dulac est devenu notre fantôme contemporain. Il erre, sans la moindre prise avec son environnement. Son temps est passé, comme fut passé le temps de ses ancêtres avant lui. Une génération chasse l’autre, c’est l’ordre du monde, c’est le cercle de la vie. Patrice Jean ne craint pas de le dire : chaque fantôme est destiné à disparaître. Alors, avant de s’anéantir, pourquoi ne pas s’amuser avec les travers et les absurdités de notre monde devenu fou ?
La vie des spectres – Patrice Jean
Le Cherche midi – 2024
Alexandre Jordeczki
Retrouvez-nous
sur vos réseaux