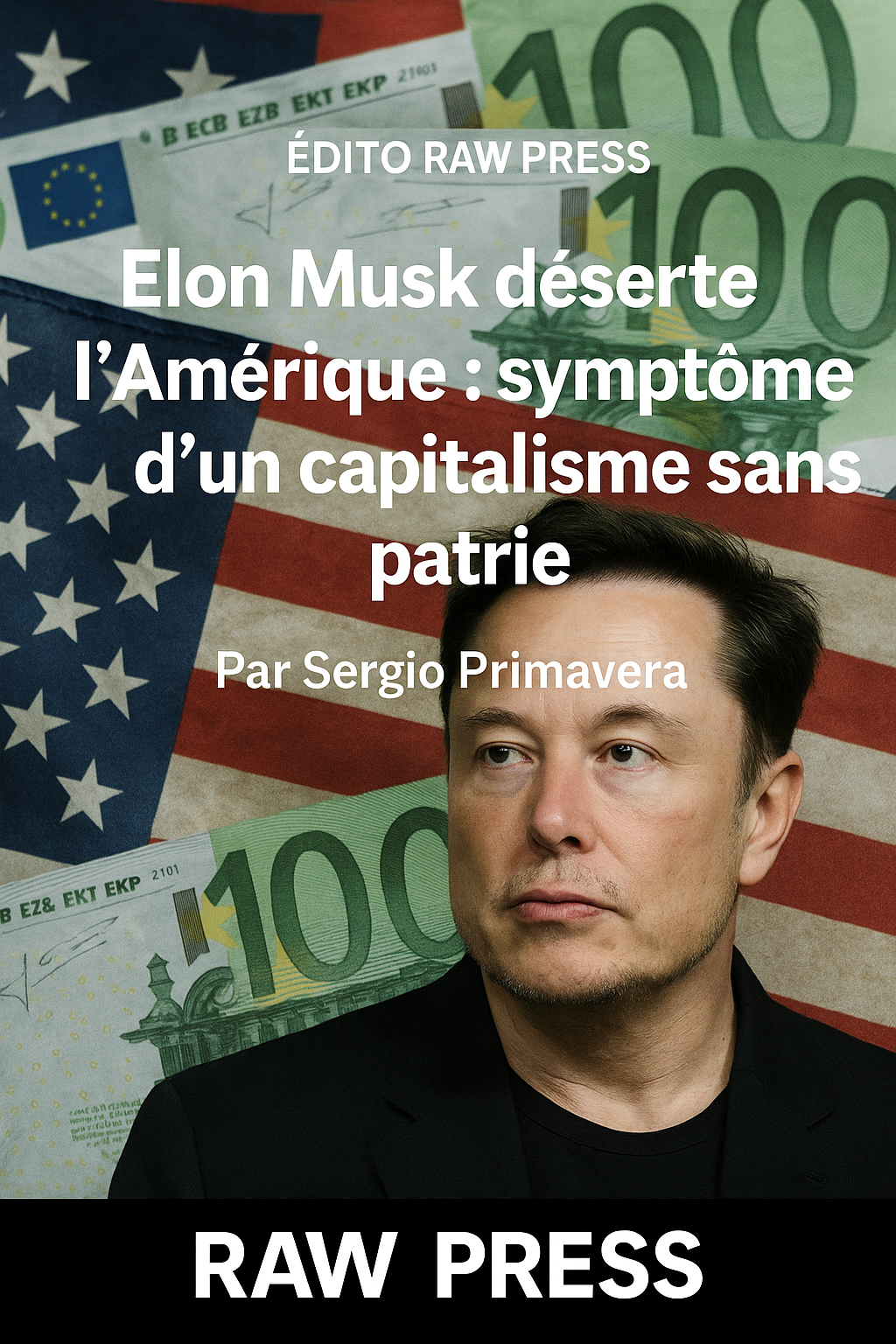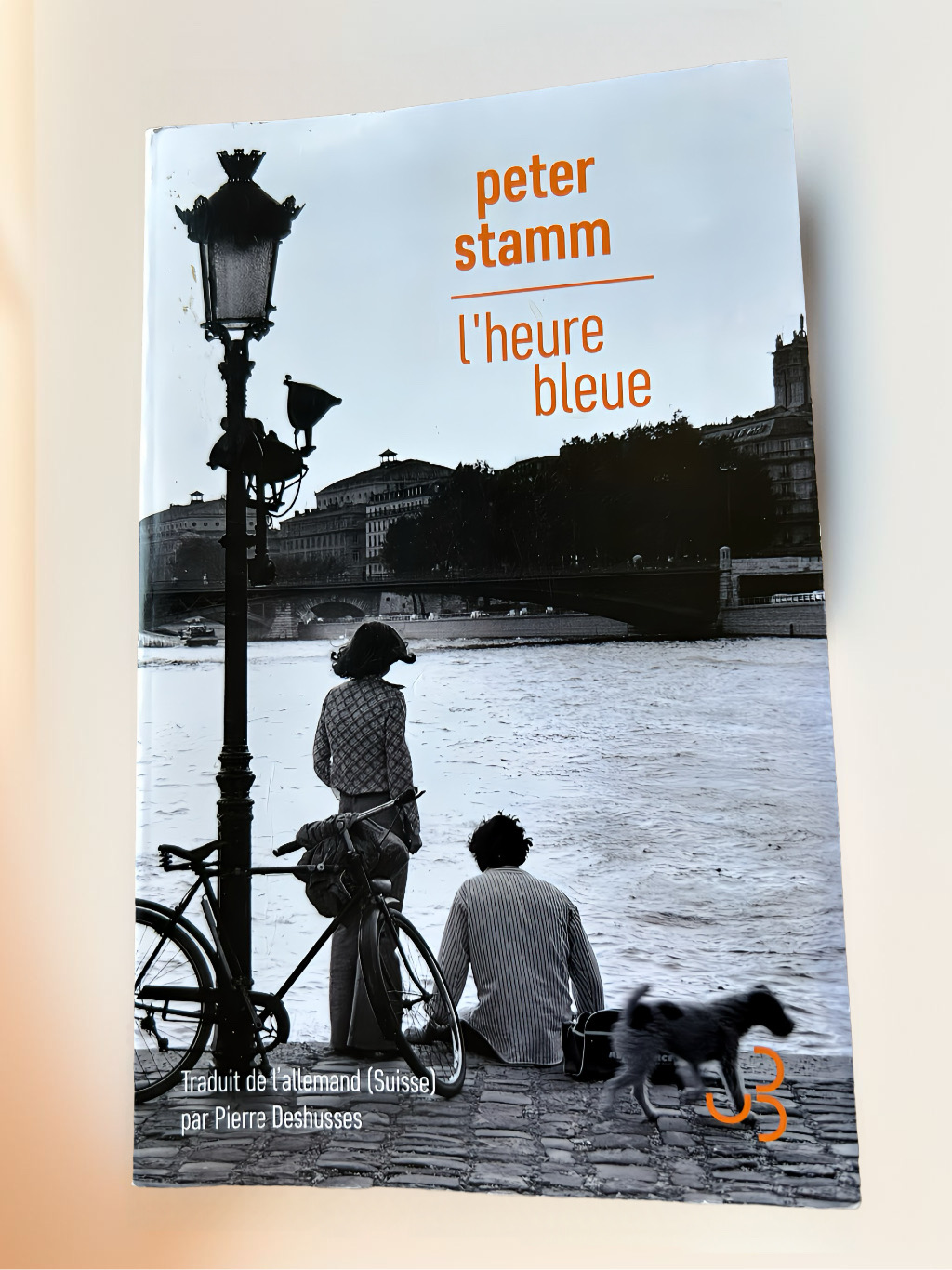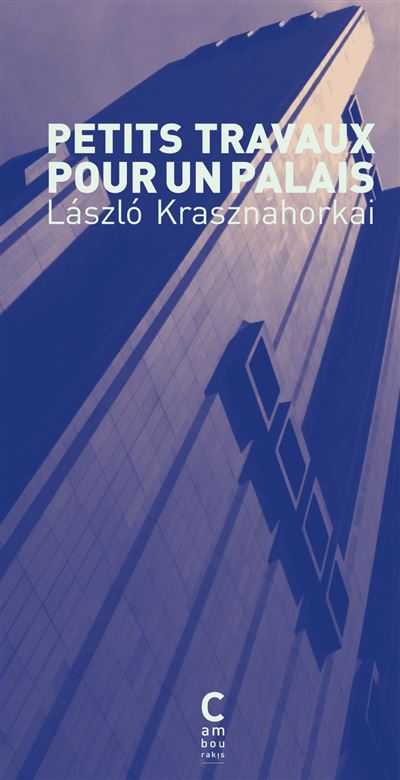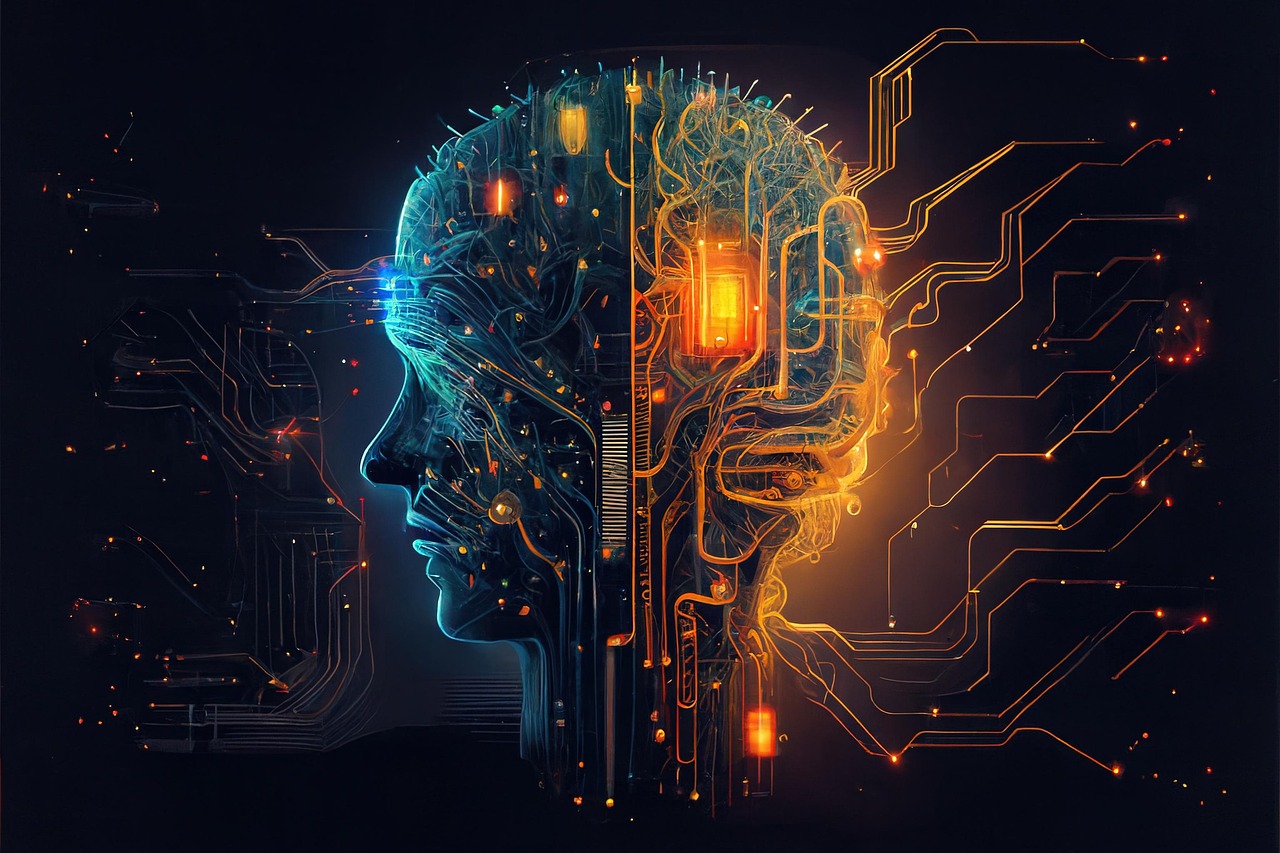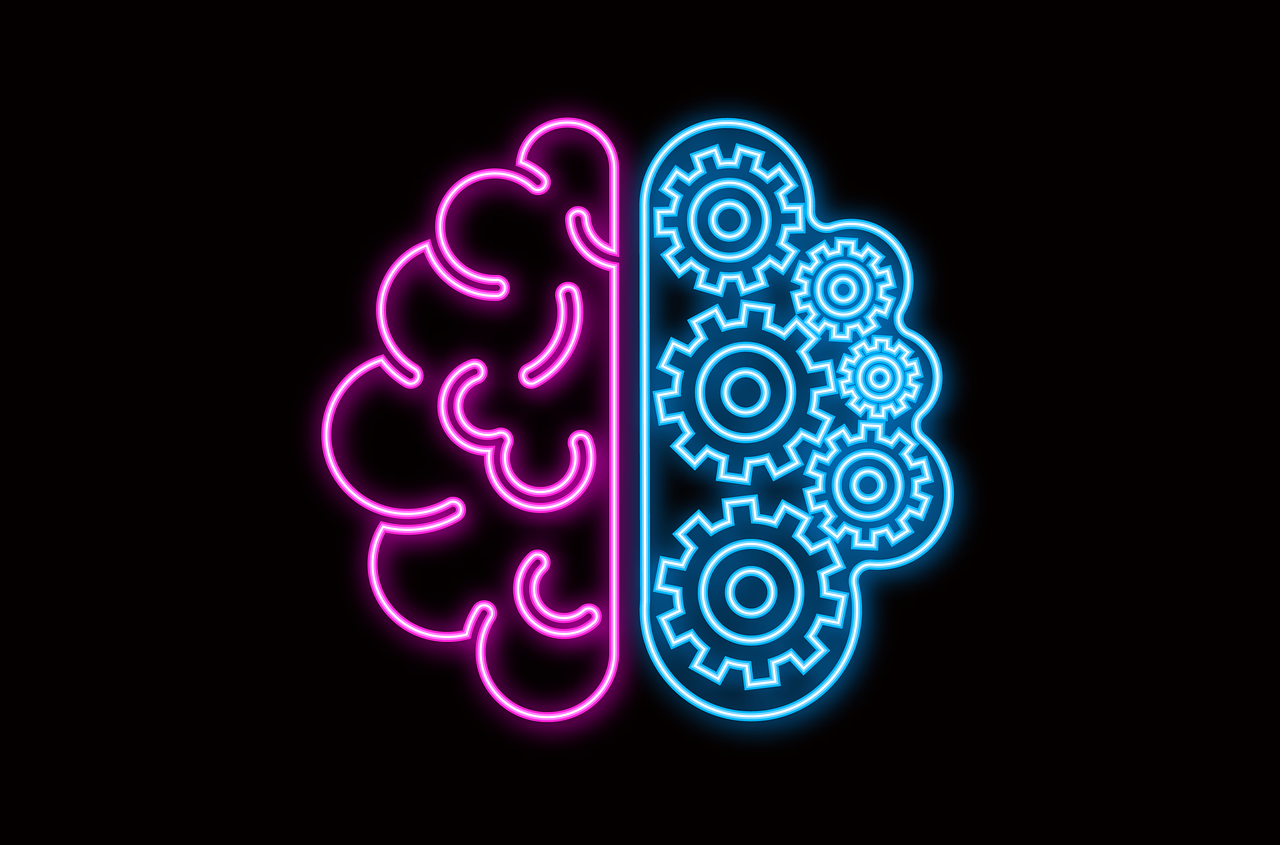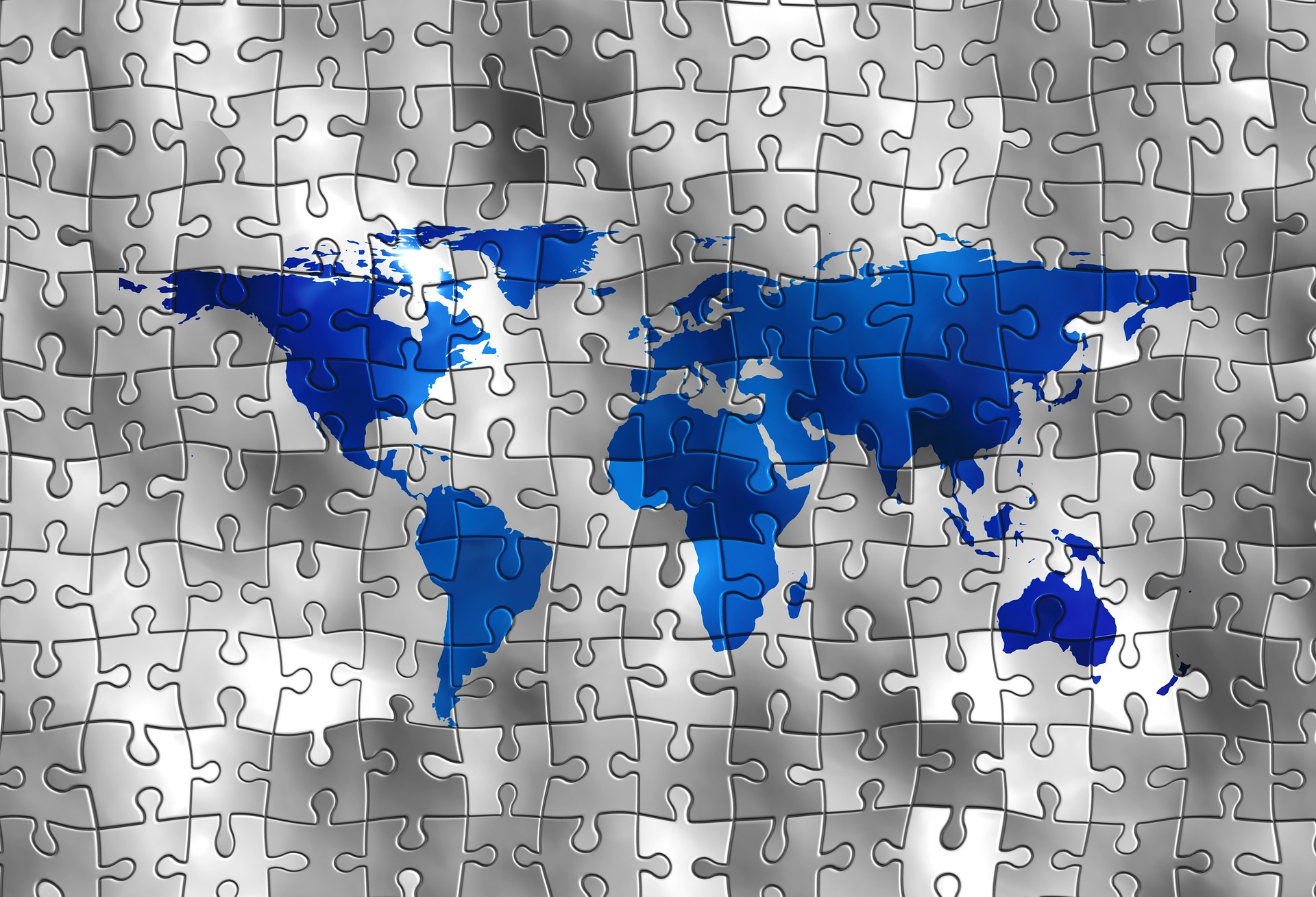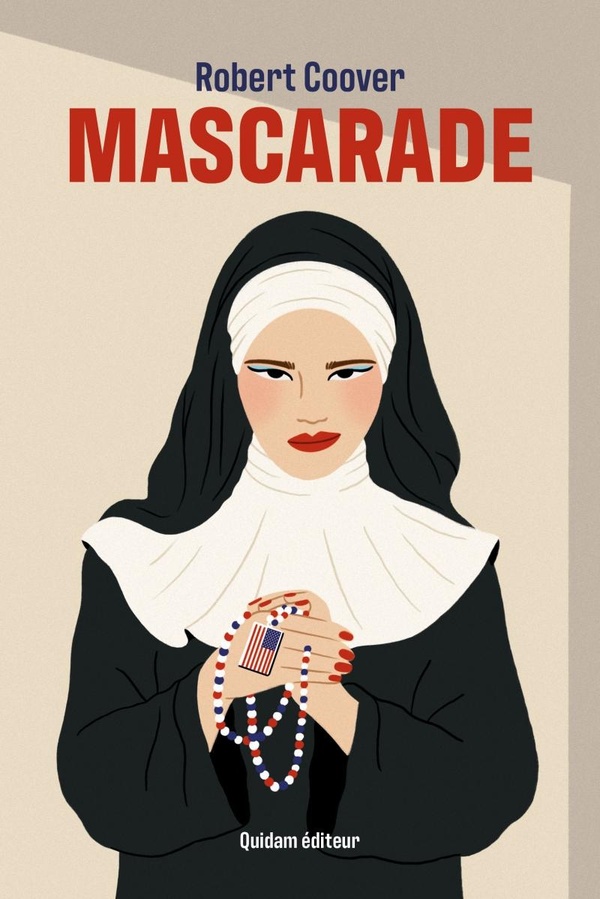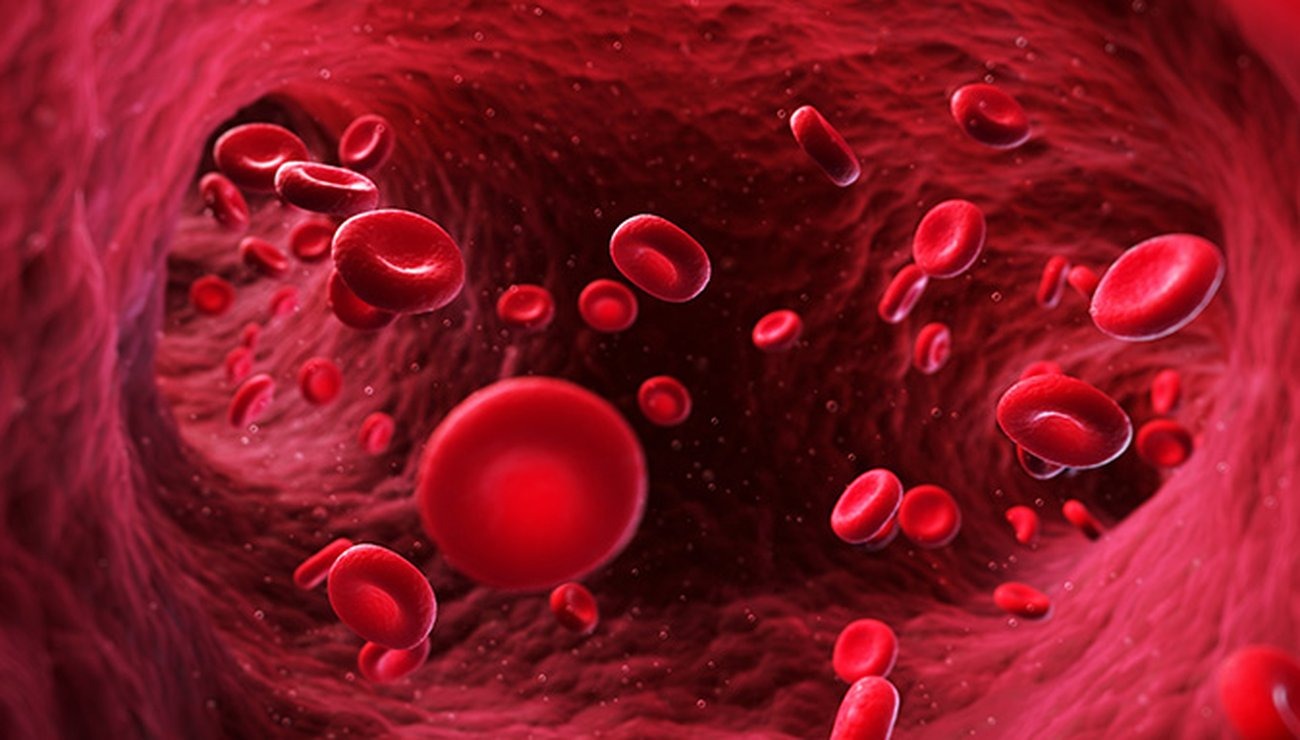Édito : « IA mondiale, mais à quel prix ? Les États-Unis et la bataille de l’inclusivité »

L’intelligence artificielle a beau être une technologie du futur, elle est déjà au cœur de nos vies et, plus encore, au centre des rapports de pouvoir entre les nations. Le lancement par les États-Unis et huit grandes entreprises d’un partenariat pour une inclusion mondiale en matière d’IA pourrait être vu comme une avancée décisive. Mais ce geste, à première vue altruiste, cache-t-il des ambitions plus stratégiques ? Alors que l’IA devient un levier essentiel de développement économique et d’influence politique, il est légitime de s’interroger : qui bénéficiera réellement de cette « inclusion » et à quel prix ?
Sur le papier, cette initiative semble prometteuse. Assurer une inclusion mondiale pourrait effectivement permettre à des millions de personnes dans les pays en développement de profiter des bénéfices de l’IA, que ce soit dans l’agriculture, la santé ou encore l’éducation. Mais en réalité, il reste à voir comment cette inclusion sera réalisée, et surtout, à quelles conditions. Car s’il s’agit d’implanter des solutions technologiques qui renforcent la dépendance à ces grandes entreprises américaines, peut-on encore parler d’inclusion ? Il est légitime de se demander si cet élan apparent vers l’universalisme n’est pas, au fond, une manière subtile de garantir une domination technologique, en réduisant l’autonomie des pays dits « bénéficiaires ».
Je vois ici une forme de cynisme déguisé. Ces entreprises, souvent critiquées pour leur monopole et leur emprise sur nos données, deviennent soudainement les promoteurs de l’inclusion et de l’équité ? Il serait naïf de croire que leur objectif est purement humanitaire. L’accès aux marchés émergents et la construction de réseaux d’infrastructures dépendent de partenariats comme celui-ci. En fin de compte, les bénéfices financiers et stratégiques sont évidents pour ces entreprises. Si elles parlent d’inclusion, c’est aussi pour ancrer leur présence dans des territoires où elles pourraient un jour asseoir une influence durable. Une forme de soft power économique qui pourrait, à terme, remplacer la traditionnelle diplomatie.
Ce projet est aussi un moyen pour les États-Unis d’imposer leurs standards et de devancer leurs rivaux, en particulier la Chine. Dans un contexte de tensions économiques et politiques croissantes entre ces deux puissances, l’IA devient le nouvel échiquier de la guerre d’influence. Cela semble être une stratégie délibérée pour définir les standards, influencer les régulations et consolider une position dominante dans le domaine technologique à l’échelle mondiale. Cette soi-disant inclusion mondiale pourrait bien être, en réalité, une extension des frontières américaines dans le domaine numérique.
On parle beaucoup d’éthique et de responsabilité dans ce partenariat. Or, la réalité est souvent plus crue. Pour les pays en développement, cette initiative est tentante, mais la question de la souveraineté est cruciale : les pays concernés seront-ils de simples récepteurs d’une technologie imposée ou pourront-ils en influencer les modalités ? Ici encore, l’équilibre est fragile. Une inclusion véritable supposerait un transfert de savoir-faire, une formation solide des compétences locales et un respect des besoins spécifiques de chaque région. Sinon, l’inclusion risque de rester un idéal lointain, au service d’intérêts bien plus immédiats.
Ce partenariat pour une IA inclusive soulève, pour moi, des interrogations plus profondes : sommes-nous face à un véritable effort de solidarité ou devant une stratégie habile pour imposer une nouvelle forme de domination technologique ? Si les États-Unis et leurs partenaires veulent vraiment œuvrer pour un monde plus juste, ils devront dépasser leurs intérêts propres et donner une place réelle aux pays qu’ils entendent « inclure ». Sans cela, cet idéal d’inclusion pourrait bien rester une belle promesse sur papier.
Retrouvez-nous
sur vos réseaux