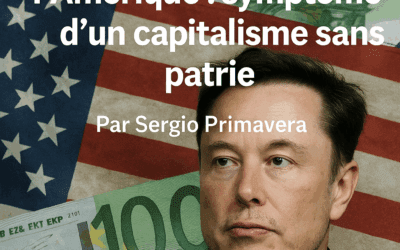Colonialisme et néocolonialisme en Afrique francophone : quelques repères chronologiques

La plupart des livres d’histoire et des sites internet évoquent comme premier repère l’année 1659, avec la fondation de Saint-Louis, au Sénégal, sur la Côte Atlantique. Je vais donc leur faire confiance. Toutefois, l’histoire de la colonisation française est jalonnée de changements de paradigmes, tant dans l’argumentation qui l’accompagne et tente de la justifier que dans le modus operandi des acteurs de ces événements sur le terrain. Ainsi, si les dates de la colonisation au XVIIe siècle semblent avérées, il faut comprendre qu’à l’époque, elle se contentait de créer des « comptoirs » sur la mer ; ce ne sera qu’une centaine d’années plus tard qu’auront lieu les véritables expéditions dans les terres, du moins en Afrique francophone qui constitue mon terrain d’analyses – le contexte en Cochinchine ou aux Antilles étant alors très différent. Cantonnés aux côtes donc – on peut citer Gorée à côté de Saint-Louis -, les Français étaient approvisionnés par les potentats locaux, ou par des intermédiaires de tout rang, en produits exotiques… et bien sûr en esclaves. On fait généralement remonter aux années 1850 le début des explorations. C’est au cours de cette même décennie que les Anglais avaient « donné l’exemple » en pénétrant profondément au Sud et à l’Est du continent. Côté Hexagone, c’est le colonel Louis Faidherbe qui suit, un peu plus timidement, ledit exemple de progression à travers les terres : avec une escorte très réduite et un petit bataillon indigène.
Je ne tiens pas particulièrement à revenir sur le débat passionnel et empoisonné qui tend à exonérer, ou du moins à édulcorer, la responsabilité des colons européens dans le domaine de l’esclavage, avec pour les partisans de cette thèse l’argument que les peuples africains eux-mêmes transformaient déjà les prisonniers des peuples vaincus lors de fréquentes batailles interethniques en esclaves, et que donc ces individus vendus aux Européens, tels ceux qui composaient le bataillon susmentionné, seraient en tous les cas demeurés dans ce même statut, qu’ils fussent aux mains du voisin africain vainqueur ou à celles du colon européen.
On peut hélas affirmer que ce point-là est avéré, ce qui par ailleurs à mon sens n’ôte pas un gramme ou un millimètre d’horreur au « commerce triangulaire » que les « négriers » avaient mis au point avec leurs possessions antillaises. En effet, on ne compare pas avec le pire pour se forger une armure de moralité. Certes, l’air du temps ne se compare pas au nôtre ; pourtant, quelques rares voix (cf Clémenceau ; j’y reviendrai) s’élevaient pour protester contre la manière dont les esclaves africains étaient traités. Pour info, et pour en terminer avec cette peu reluisante thématique, on dit qu’à l’époque, un homme sur quatre était déjà esclave sur sol africain.
J’en reviens à notre colonel Faidherbe. Celui-ci initia un mouvement timide de conquête du territoire, sous prétexte de « mise en valeur économique », à l’intérieur du Sénégal. Tout au long de son périple, il établit des protectorats et eut également à réprimer les premiers soulèvements, à l’image de celui des Peuls ou de la révolte des Toucouleurs.
Mais la vraie ruée vers l’intérieur ne débuta pour les Français que dans les années 1870, provoquée comme évoquée par la véritable course aux colonies qu’avaient lancée les Anglais et, dans une moindre mesure, les Allemands et les Espagnols. « Les Britanniques ne nourrissaient pas les mêmes scrupules, réels ou feints que leurs rivaux hexagonaux ; ils assumaient les motifs économiques et stratégiques de la conquête », nous dit l’historien Nicolas Bancel*. Et ils assumaient aussi une logique de prise de contrôle violente et ça sans états d’âme de la terre et de ses ressources.
Chronologiquement, la première contrée importante explorée – donc colonisée – est la Guinée en 1877 ; elle obtiendra en 1891 le statut de colonie à part entière. Trois ans plus tard, poussant toujours plus avant au coeur du continent, c’est l’explorateur Pierre Savorgnan de Brazza qui offre à son pays d’adoption un immense espace de milliers de kilomètres, parvenant, au prix d’une difficile remontée du fleuve Congo en compagnie de trois ou quatre compatriotes et, lui aussi, d’une petite escorte de protection composée de fantassins sénégalais, jusqu’à la frontière du Congo actuel avec la non moins actuelle RDC (République démocratique du Congo). Il y fonda, au bord du fleuve, un établissement français que les années transformèrent en Brazzaville, capitale du Congo français. Savorgnan résume toutes les contradictions et ambiguïtés de son époque. Humaniste, surnommé l’ami des Noirs, il n’en a pas moins recouru à la domination par la force là où la conquête l’exigeait. Il faut dire aussi que la doxa de la fin du XIXe siècle voulait que les peuples Noirs, dits primitifs, soient considérés comme « race inférieure », partant, les Blancs comme race supérieure. Même des intellectuels de l’envergure de Victor Hugo adhéraient à ce discours. Seule une poignée d’authentiques humanistes et les bancs à l’extrême gauche de l’Hémicycle s’indignaient du sort réservé à la population de couleur. Ainsi, à la suite du fameux discours de Jules Ferry en juillet 1885, Georges Clémenceau répondit par un non moins fameux « Races supérieures ? Races inférieures, c’est bientôt dit ! Pour ma part, j’en rabats singulièrement depuis que j’ai vu des savants allemands démontrer scientifiquement que la France devait être vaincue dans la guerre franco-allemande parce que le Français est d’une race inférieure à l’Allemand.»
C’est qu’il s’agissait également, justement à la suite de la déconvenue de la guerre de 1870 contre la Prusse, de redorer le blason du pays des Lumières, dont Jules Ferry, tout comme l’intégralité de ses successeurs au pouvoir jusqu’à la Seconde Guerre mondiale, vantaient la « mission civilisatrice » de la France auprès des populations. À l’appui de leurs dires, tout avait été présenté à l’Exposition universelle de1889 à Paris pour que la thèse ne soit pas mise en doute une seule seconde. On offrait au regard du public des villages africains reconstitués, on y exhibait comme des bêtes de foire plusieurs centaines d’indigènes du Sénégal, du Mali et du Gabon…
De facto, on l’a dit, l’enjeu réel était économique. En conséquence, les missions se révélaient souvent beaucoup plus sournoises que civilisatrices. Le magazine « Géo » nous apprend ainsi que le même sieur de Brazza évoqué ci-dessus avait conclu plus d’une centaine de « Traités de souveraineté et de protectorat » avec des chefs noirs (on en décompte 344 en tout entre 1820 et 1890, tous obtenus de gré ou de force par des colons-aventuriers). Ces traités étaient presque toujours au grand désavantage des populations indigènes, dont les dirigeants souvent ne savaient pas lire la langue dans laquelle étaient rédigés les traités qu’on leur faisait signer.
Pour en terminer avec la chronologie, deux dates me semblent importantes afin de clore le dossier colonial : l’accession de la Côte d’Ivoire au statut de colonie en 1893, puis celle de Madagascar l’année suivante. Les choses n’allaient plus beaucoup bouger par la suite, du moins jusqu’aux deux Guerres mondiales – desquelles je ne traiterai pas ici mais sur lesquelles je reviendrai dans un autre texte, anglé différemment que ce qui se lit dans les mainstreams d’habitude… encore que, la problématique de la compensation n’étant toujours pas réglée, quelques mots sur le sujet, même détaillé jusqu’à plus soif ces dernières années, pourraient s’imposer.
J’ai omis de préciser que l’esclavage avait été aboli officiellement (du moins dans les textes) en 1848. Pour être précis, il faudrait observer qu’il l’avait déjà été en 1798, mais Napoléon l’avait rétabli quelques années plus tard. Certains font coïncider cette date et ce concept d’abolition avec le passage du colonialisme au néo-colonialisme. Mais clairement, les expéditions des décennies 1870 et 1880 se lisent encore comme des actions de colonialisme pur et dur, et il me paraît plus pertinent d’attendre la fin des deux Guerres mondiales, voire les accords d’indépendance de 1960, pour parler de néo-colonialisme. Les fameux accords secrets de 1960 avec les 14 pays africains francophones subsahariens contiennent en réalité les éléments permettant à l’Hexagone de perpétuer sa domination et de maintenir sa zone d’influence, avec principalement la présence de bases militaires dans nombre de ces pays et l’usage imposé du franc CFA ainsi que le quasi-pillage des ressources minières. C’est cette période qui s’étend de 1960 à nos jours qui fera l’objet de mon prochain article.
Quelques dates à retenir pour la période précédant les deux Guerres mondiales:
1894 : Naissance du Ministère des colonies // Assassinat Carnot
1895 : Fondation de l ‘AOF (Afrique Occidentale française)
1910 : Fondation de l’AEF (Afrique Equatoriale française)
(Pendant toutes ces années la « course aux drapeaux » bat son plein)
1899 : Paroxysme des violences coloniales : la mission Voulet-Chanoine
* N. Bancel ; La fracture coloniale : la société française au prisme de l’héritage colonial , Ed. La Découverte, 2005.
Retrouvez-nous
sur vos réseaux