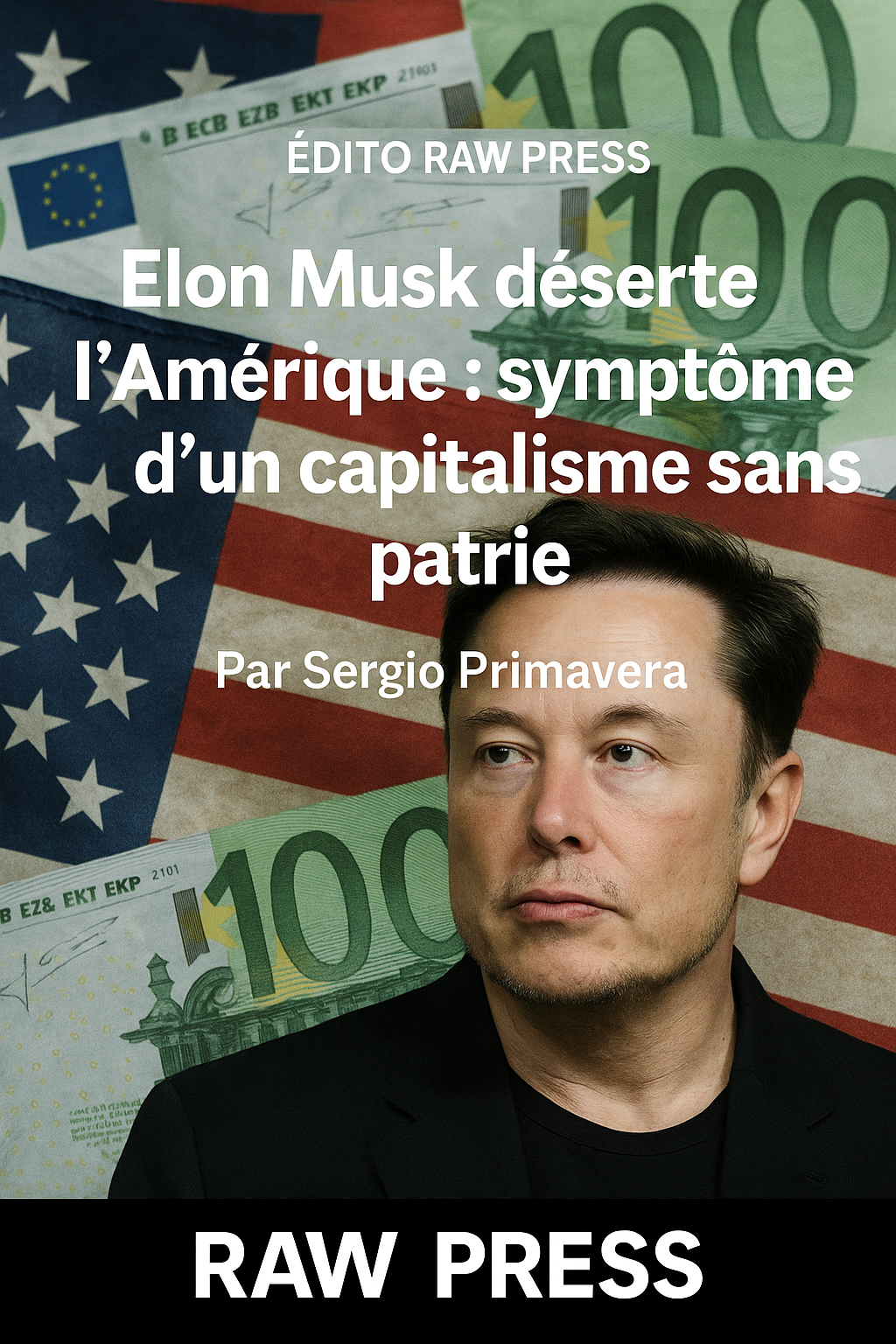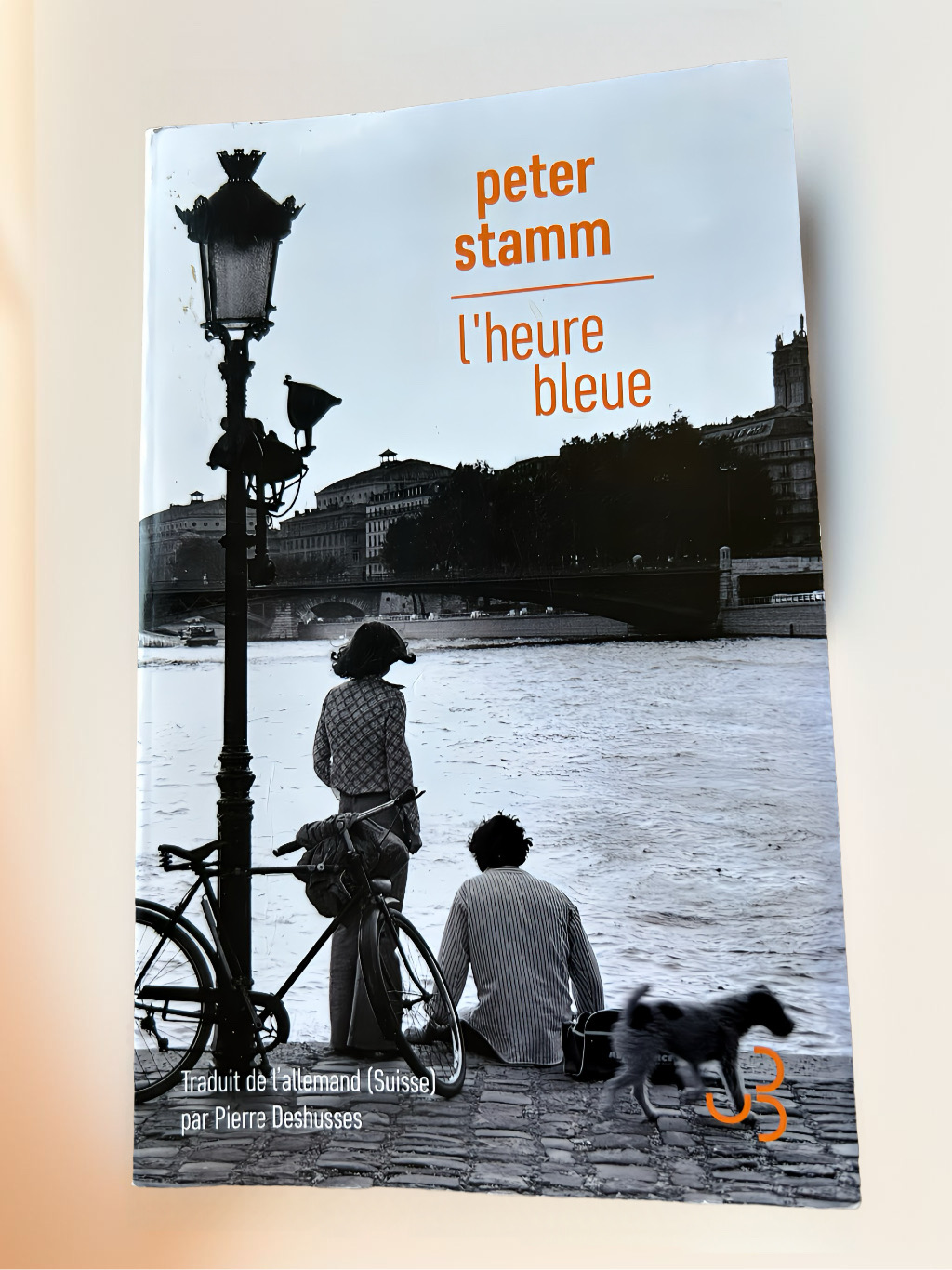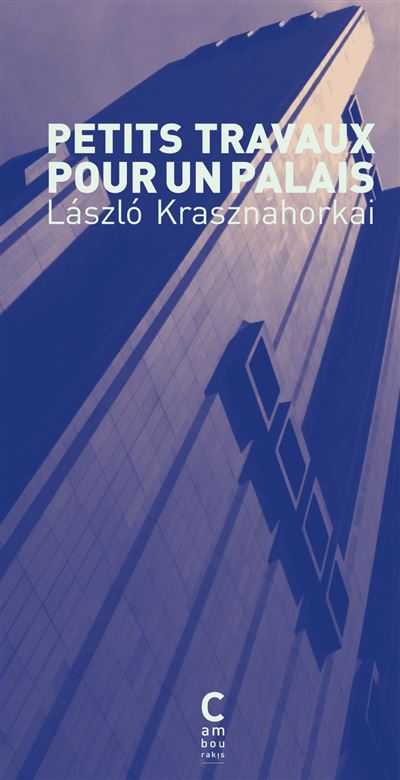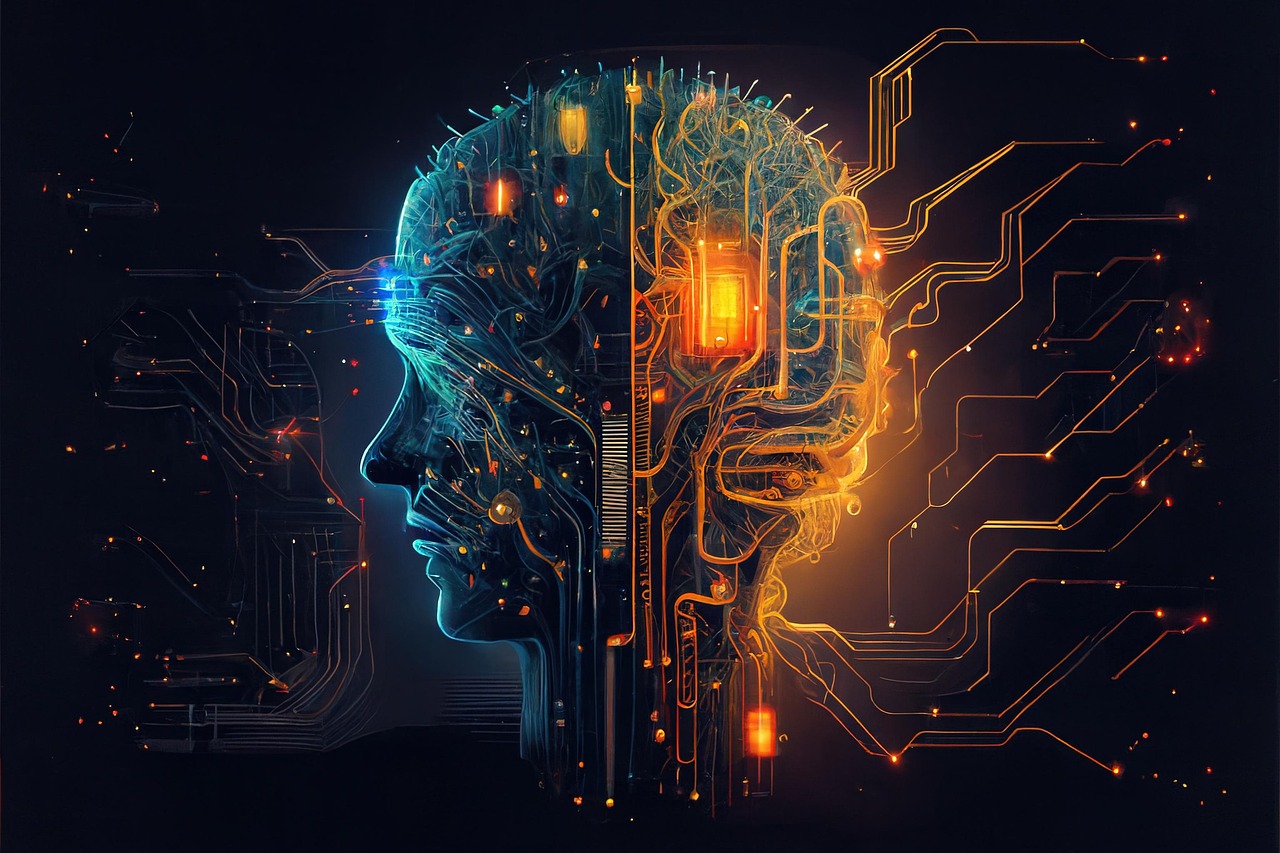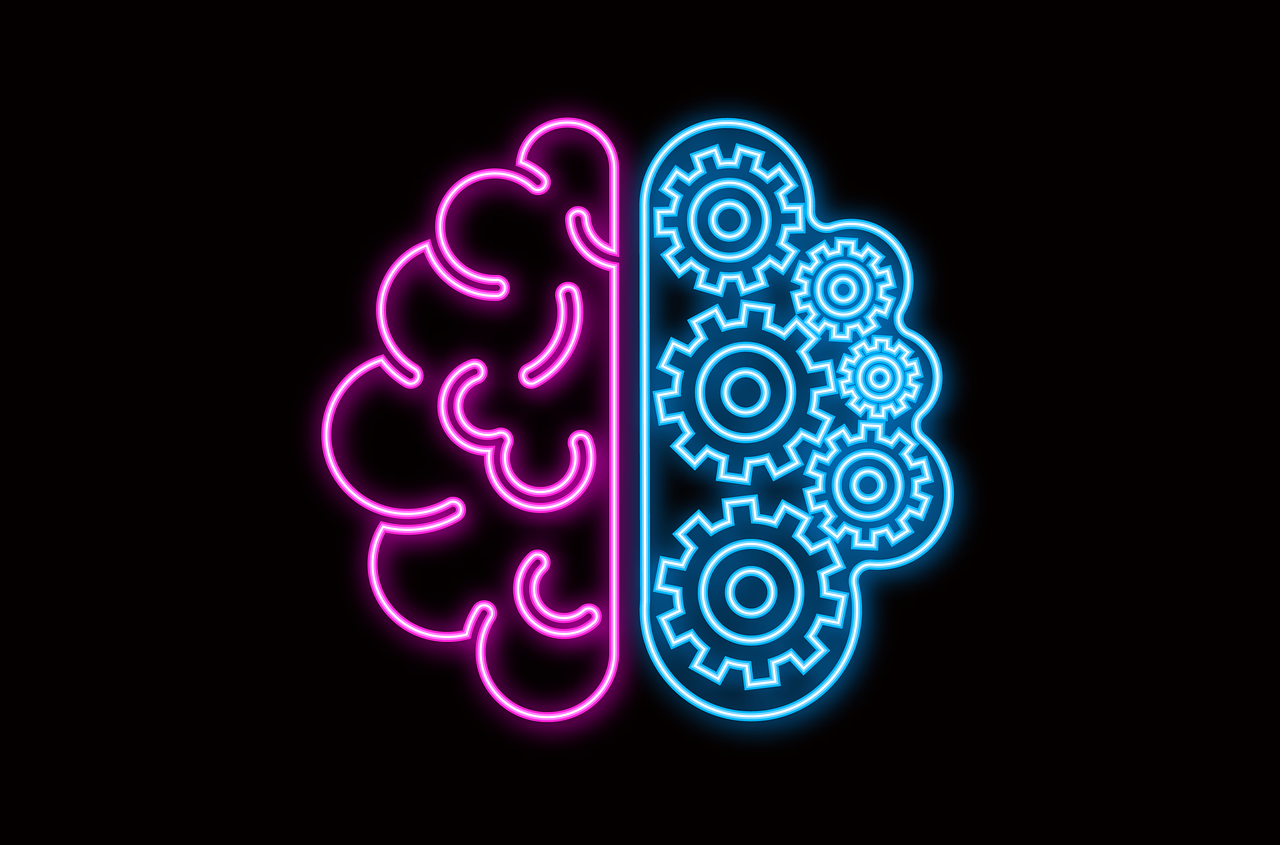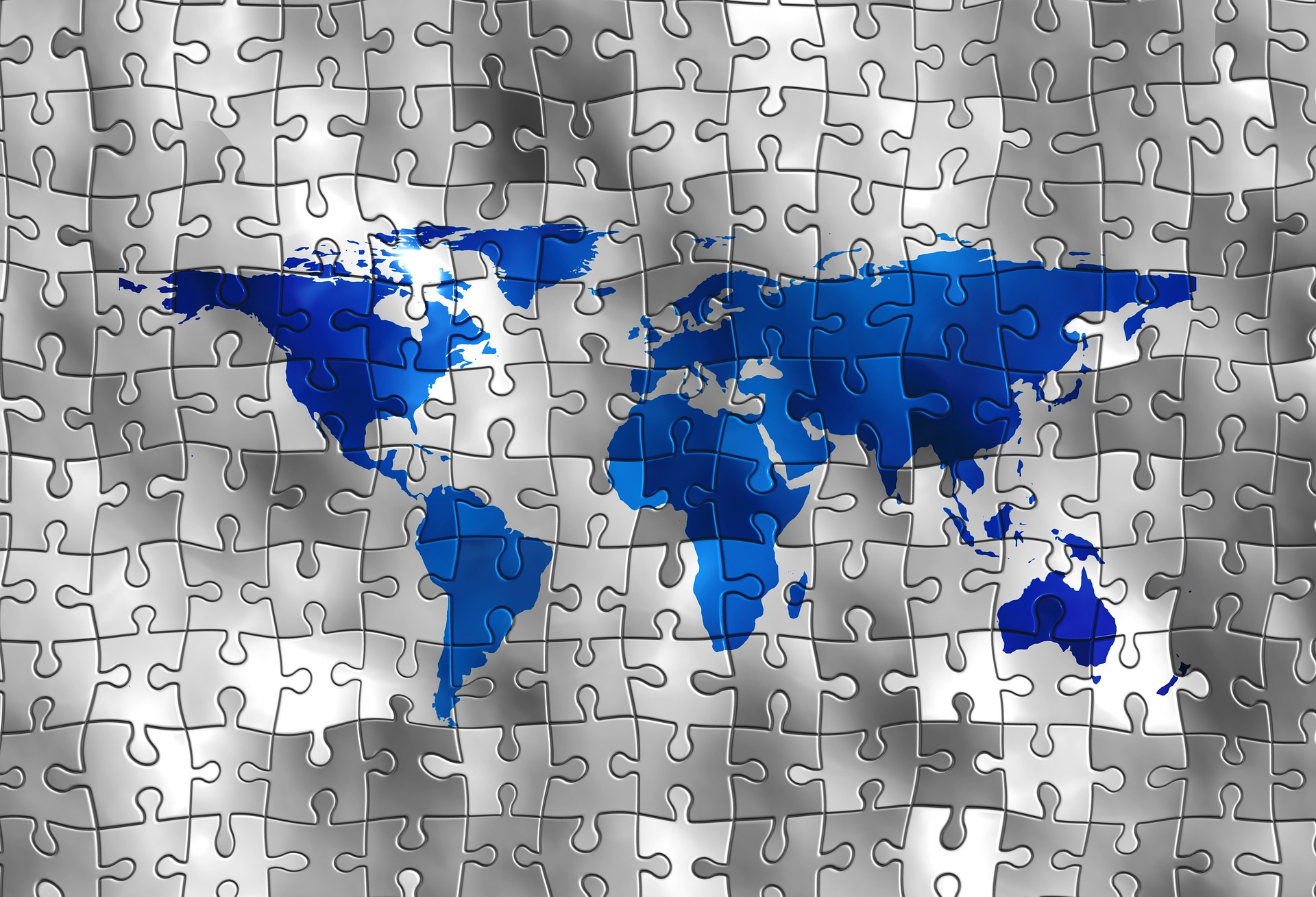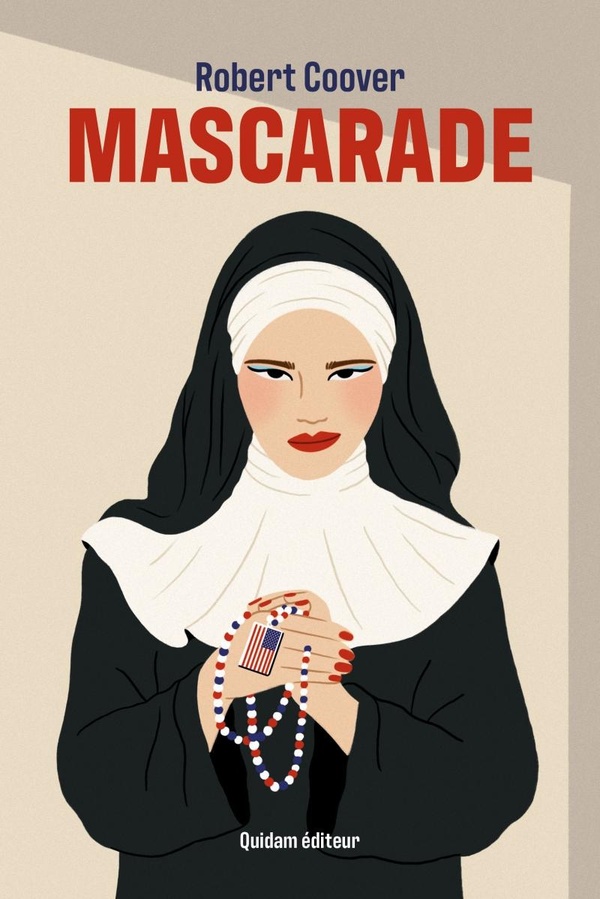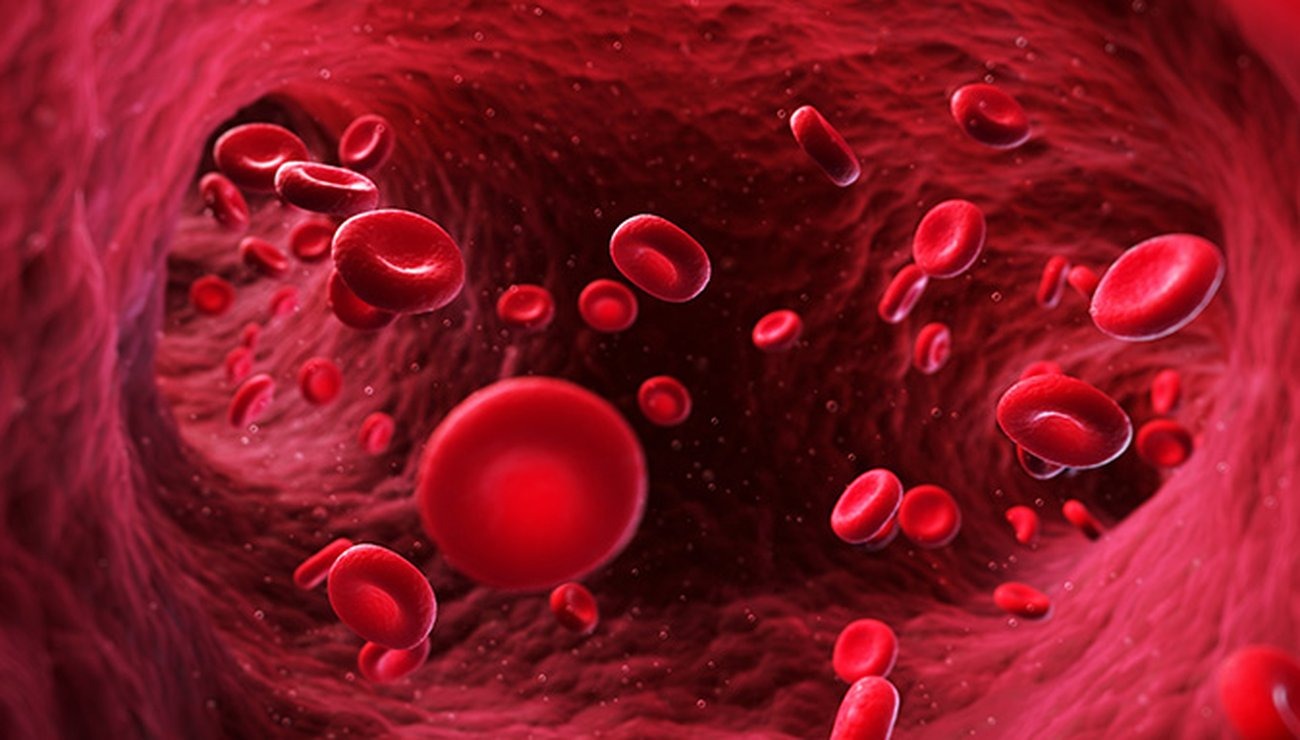Souvenirs des projets TTIP et TiSA : entre opacité et contestation

Entre 2013 et 2017, les projets de traités de libre-échange tels que le TTIP/TAFTA (Traité de libre-échange transatlantique) et le TiSA (Accord sur le commerce des services) ont suscité de vives discussions. Présentés comme des moteurs de croissance économique, ces accords ont soulevé de nombreuses inquiétudes liées à la démocratie, à la santé publique, à l’environnement et aux droits sociaux. Leur principale faille résidait dans leur opacité, qui a alimenté la méfiance et des débats publics animés.
Des négociations dans l’ombre
Les discussions autour de ces accords se sont déroulées dans une grande confidentialité, suscitant l’indignation des citoyens et des parlementaires. Les informations étaient soigneusement filtrées, limitant les débats démocratiques.
En 2016, Greenpeace publia 248 pages de documents confidentiels sur le TTIP, révélant les efforts des négociateurs américains pour affaiblir les normes européennes en matière de santé et d’environnement. Ces révélations accrurent les craintes que ces traités servent avant tout les multinationales au détriment des citoyens. Malgré cela, la Commission européenne continua de défendre ces accords, affirmant que la transparence était suffisante. Pourtant, cette prise de décisions à huis clos renforça l’idée que ces projets étaient davantage conçus pour les grandes entreprises que pour les populations.
Une menace pour la souveraineté nationale
Les accords introduisaient des mécanismes controversés, notamment le mécanisme d’arbitrage privé (ISDS). Celui-ci permettait aux entreprises de poursuivre des États devant des tribunaux privés si elles jugeaient que des lois nuisaient à leurs intérêts économiques. Ces procédures, sans possibilité de recours, représentaient une atteinte directe à la souveraineté des États.
Ainsi, des lois démocratiques, comme celles interdisant les OGM ou protégeant l’environnement, auraient pu être contestées. De plus, une fois un secteur libéralisé, il devenait quasi impossible de revenir en arrière, même en cas d’échec. Cette rigidité limitait la capacité des gouvernements à répondre aux besoins changeants de leurs citoyens.
La Suisse et les accords de libre-échange
La Suisse, bien que non impliquée dans le TTIP, a participé au projet TiSA. Cependant, certains souhaitaient qu’elle rejoigne le TTIP. Une telle décision aurait pu fragiliser son modèle démocratique basé sur la participation directe des citoyens. Ces accords menaçaient les services publics et l’autonomie législative suisse, remettant en question des lois votées par référendum si elles entraient en conflit avec les intérêts économiques des multinationales.
La fin des négociations… pour le moment
En 2016, face aux critiques, l’Allemagne et la France déclarèrent l’échec des négociations duTTIP. L’élection de Donald Trump, farouche opposant à ces accords, mit un terme aux discussions. Cependant, en 2019, la Commission européenne tenta de relancer un nouvel accord, plus limité, excluant les produits agricoles et les marchés publics. À ce jour, ces projets restent en suspens, mais ils pourraient ressurgir.
L’importance d’une vigilance citoyenne
Face à ces enjeux, la transparence est essentielle pour préserver la démocratie. Les citoyens doivent avoir accès à des informations claires pour comprendre les impacts de tels accords. Une opacité renforce le sentiment que ces traités ne servent que les élites économiques.
Pour garantir un équilibre entre croissance économique et respect des droits fondamentaux, les décisions doivent être prises dans un cadre démocratique. Une vigilance collective reste indispensable pour protéger les valeurs fondamentales face aux défis de la mondialisation.
Mais qui diable a osé négocier de tels projets de traités sans même faire l’objet de sanctions populaires ? Le Conseil européen, la Commission européenne et le gouvernement américain ?
Retrouvez-nous
sur vos réseaux