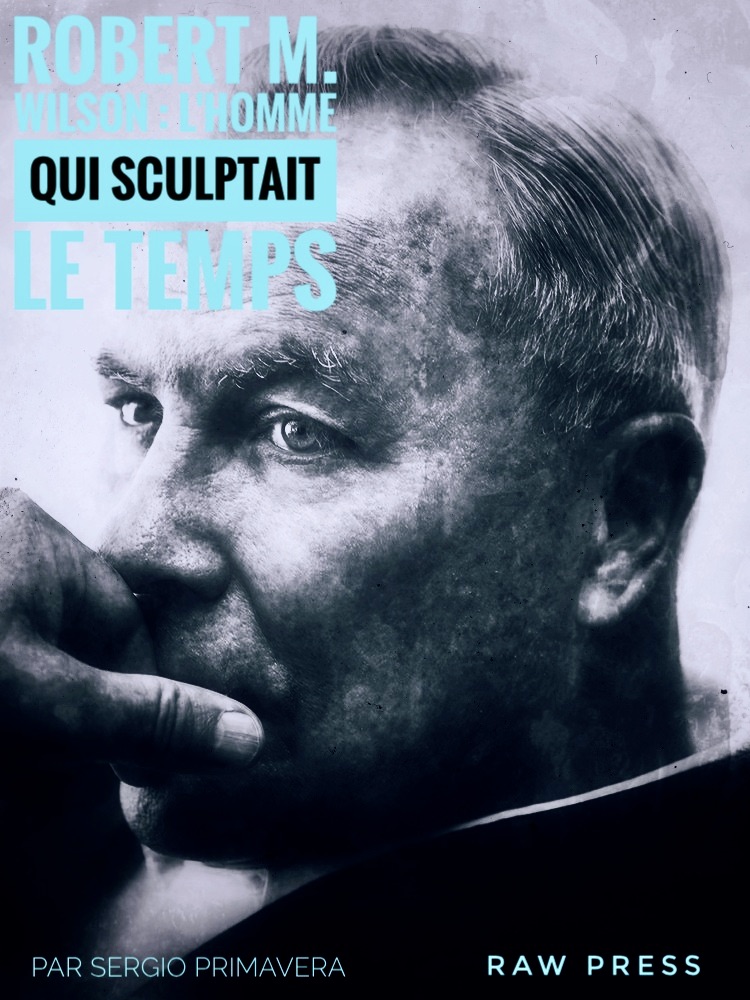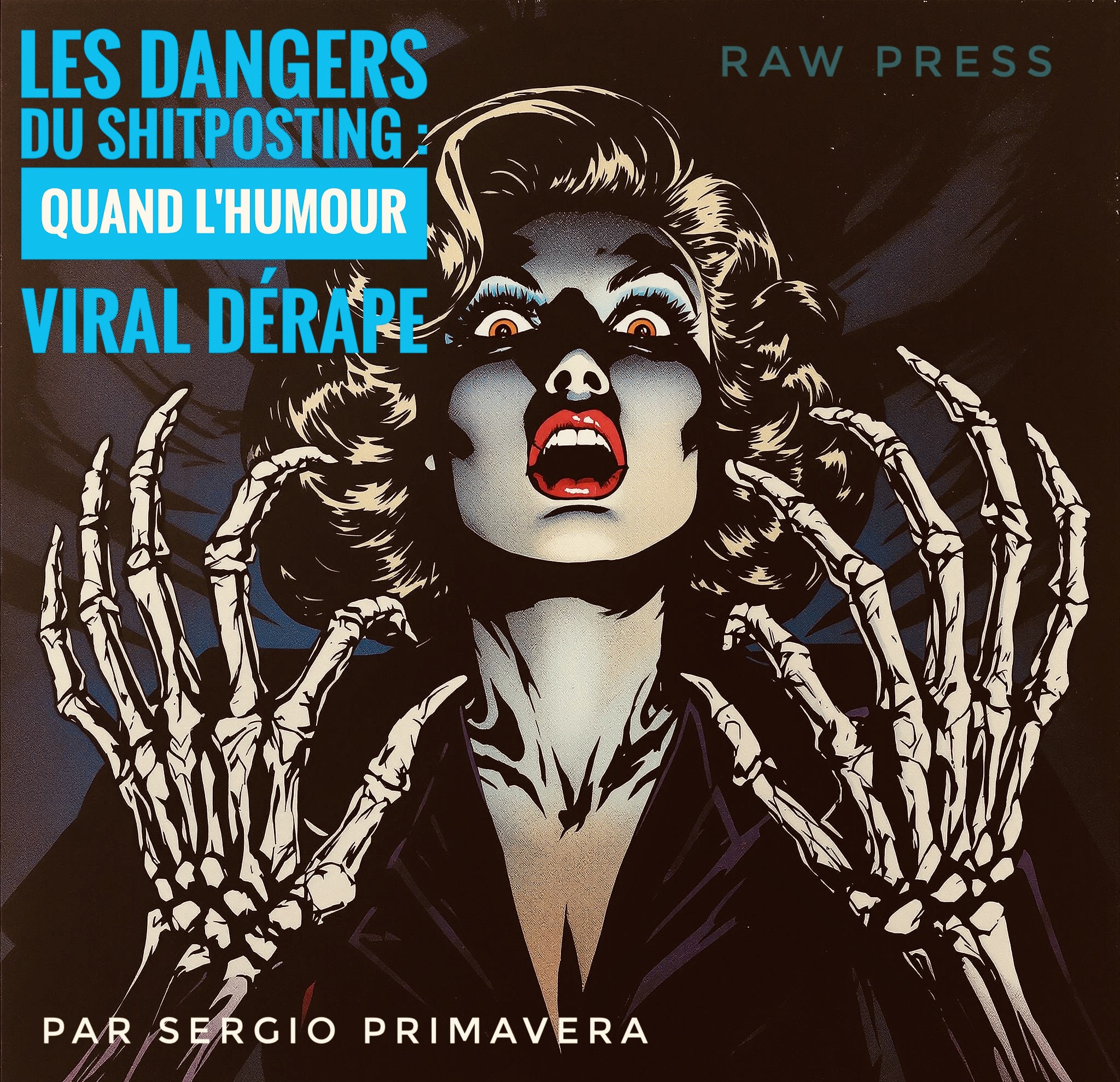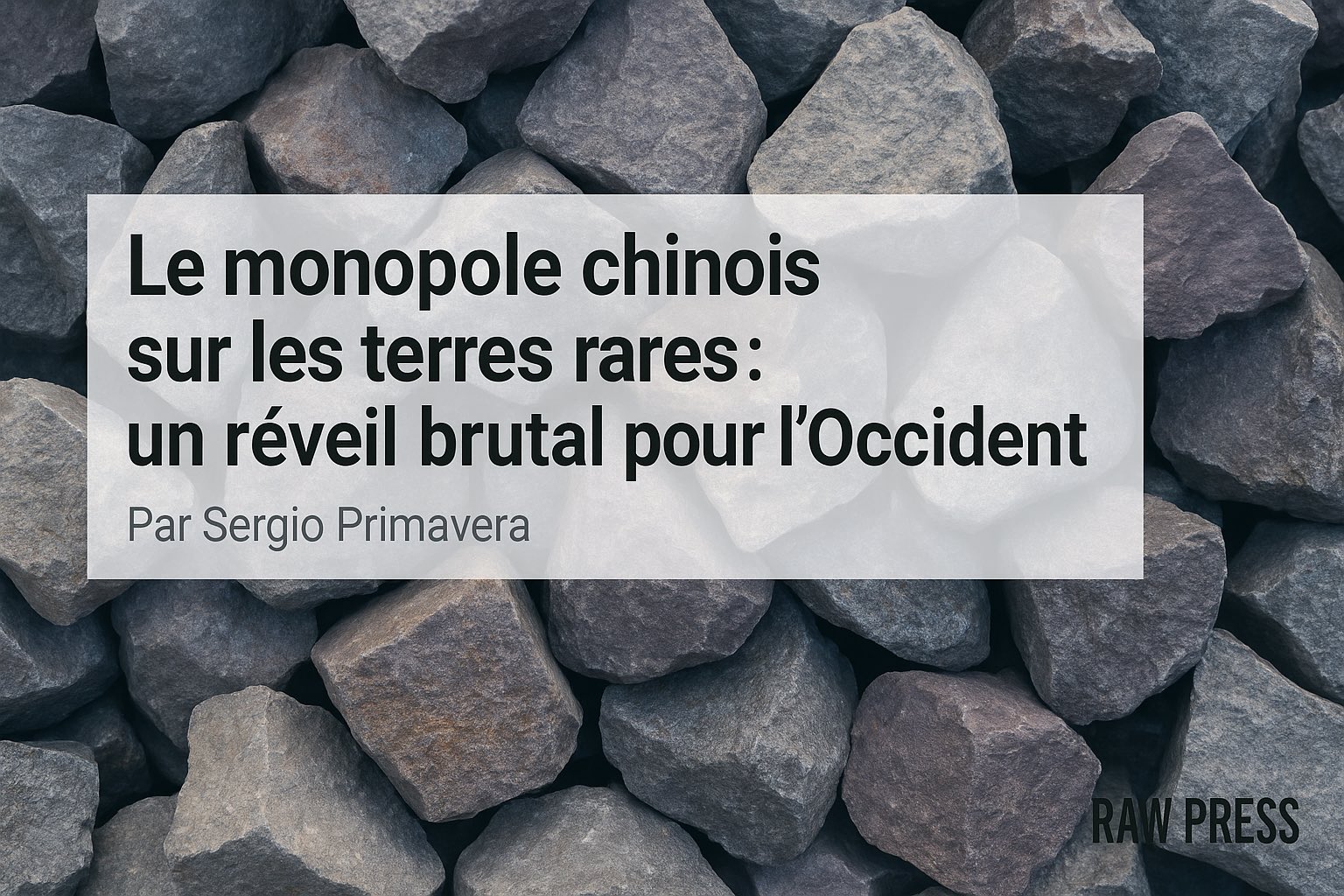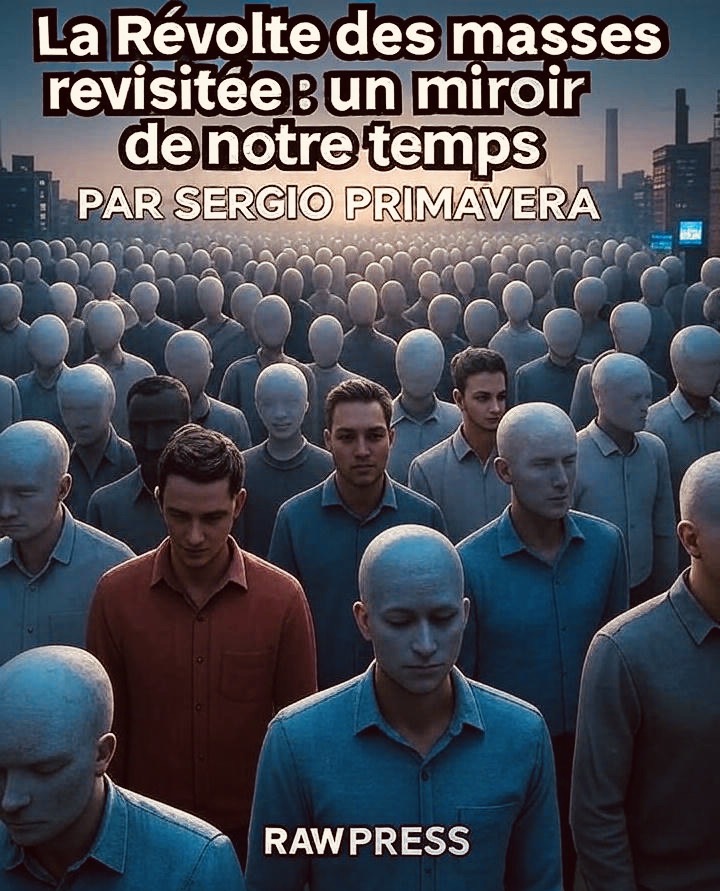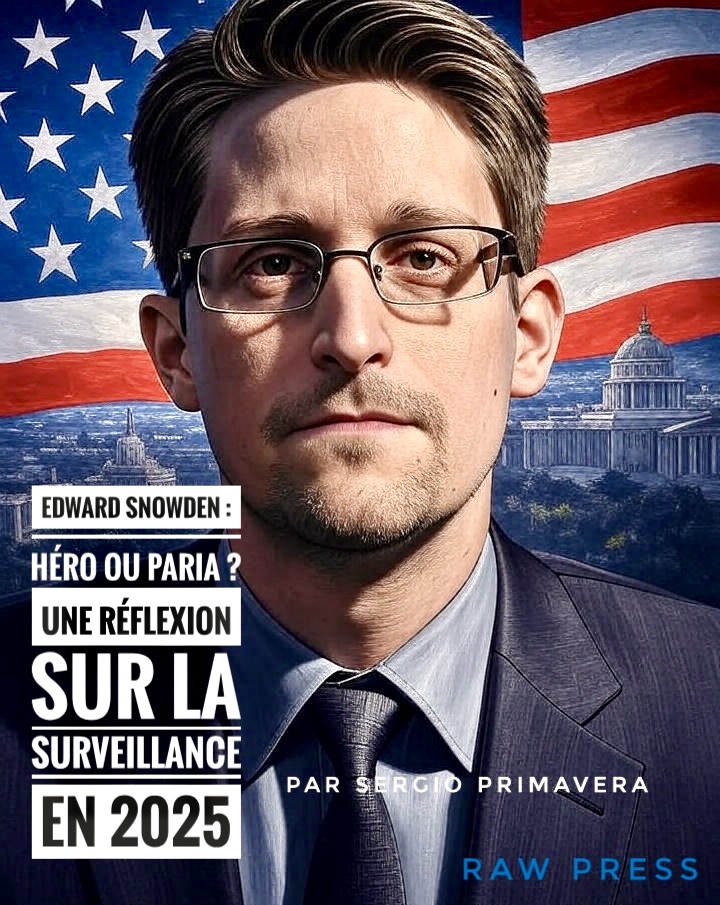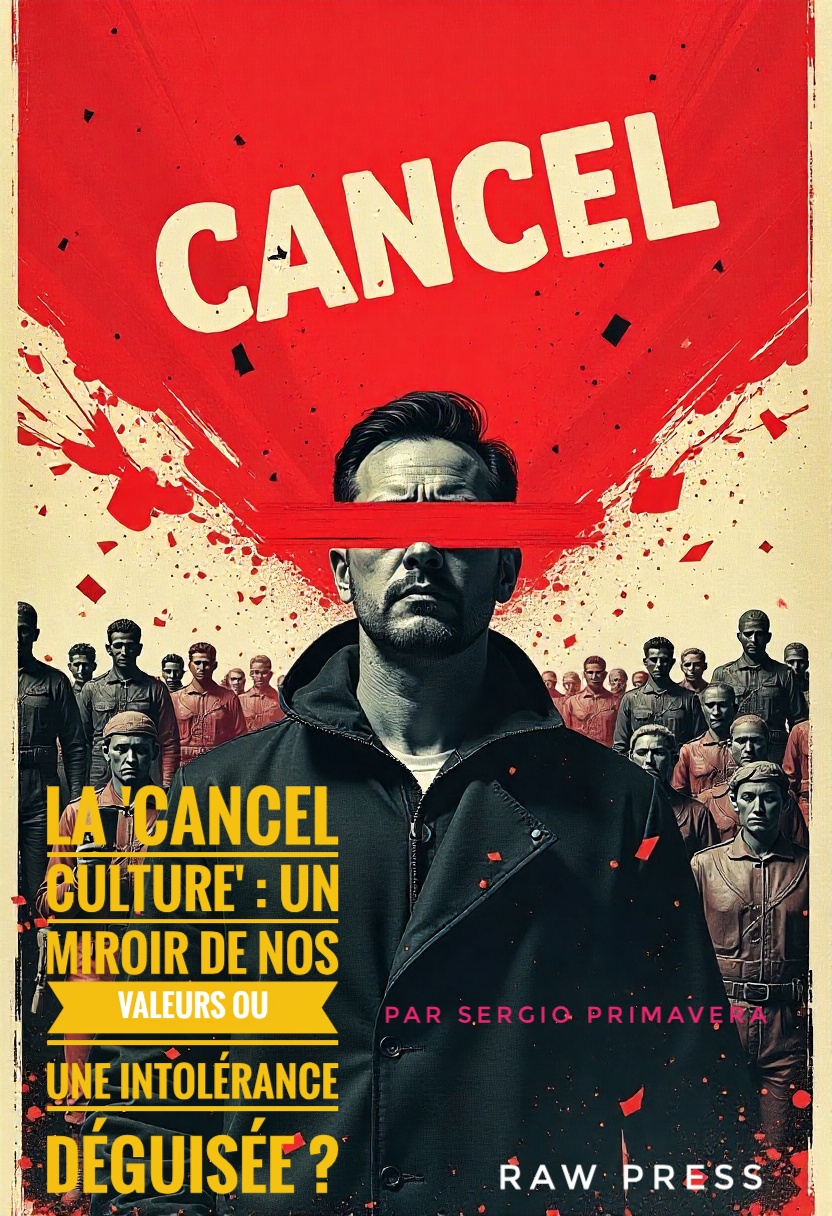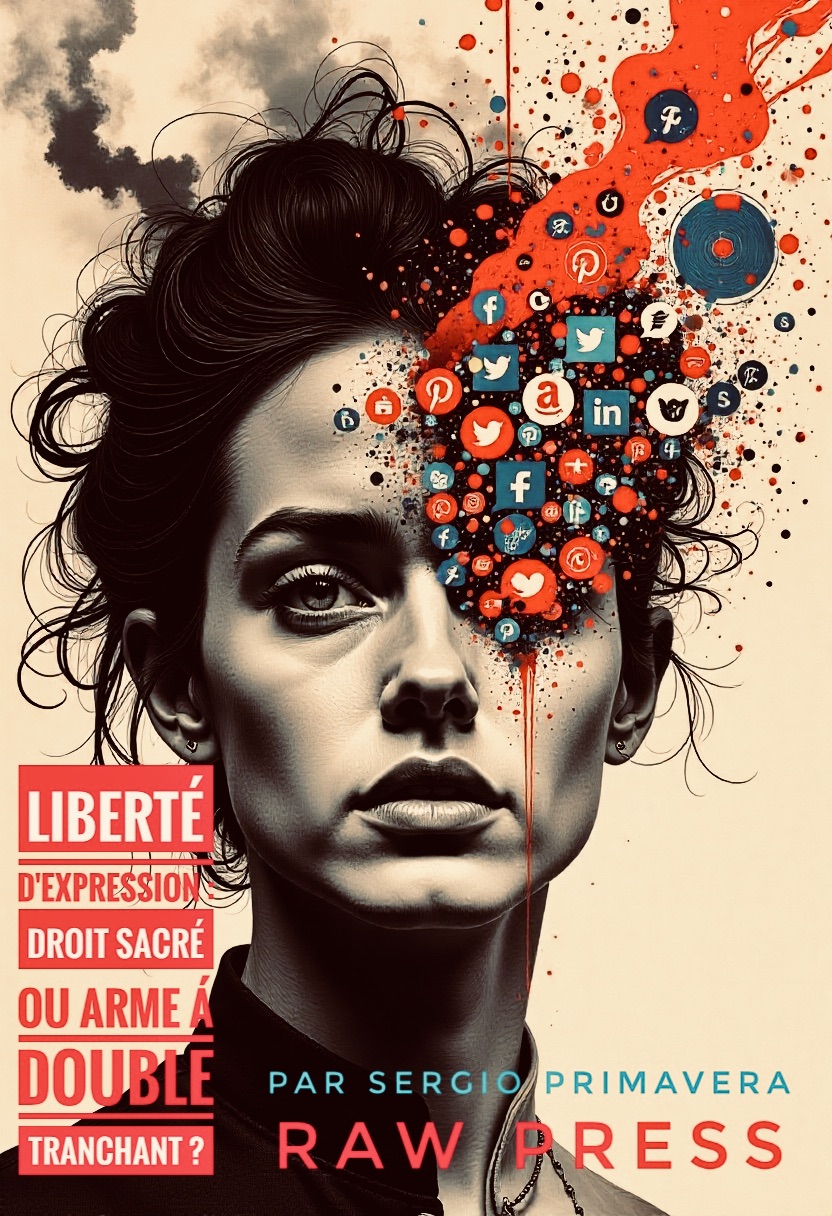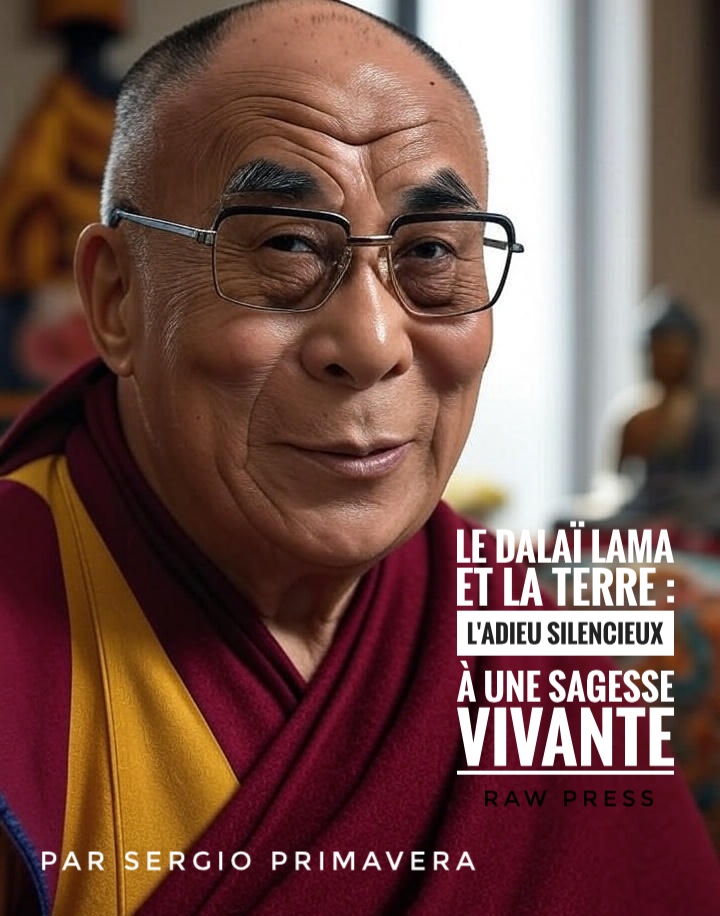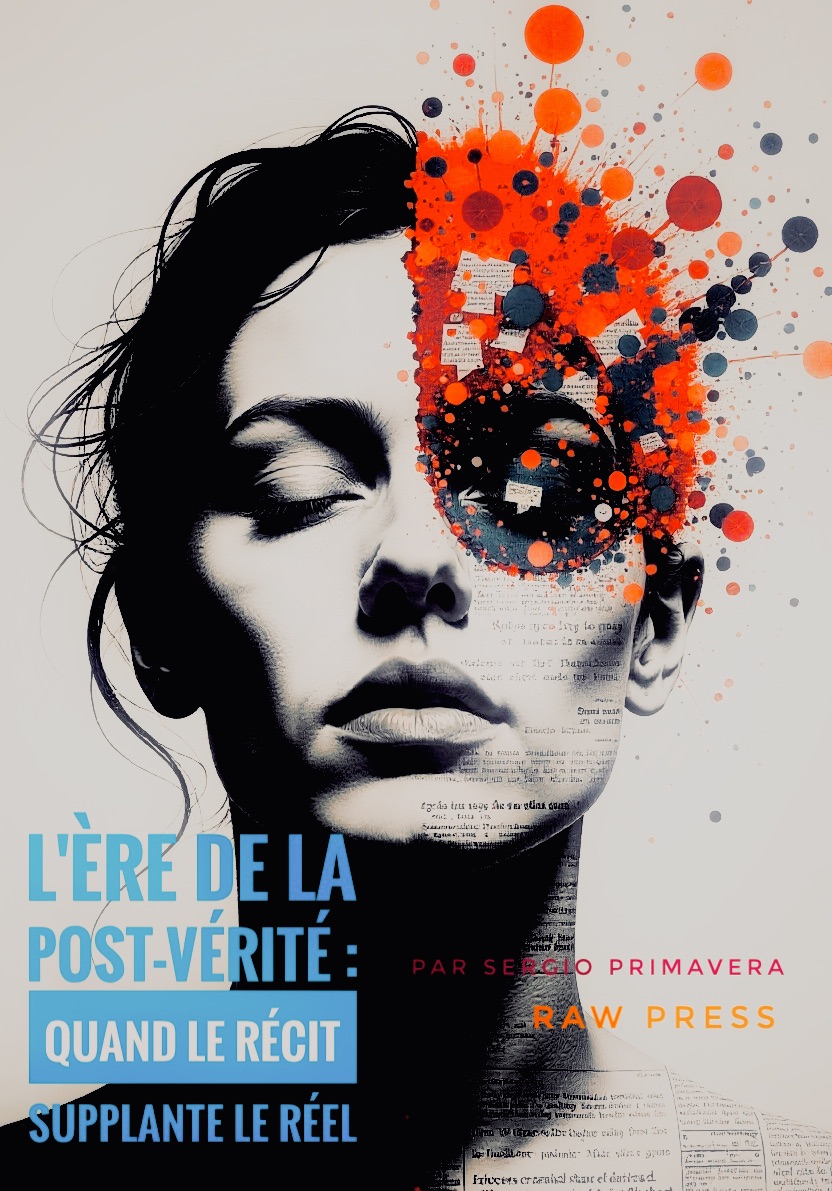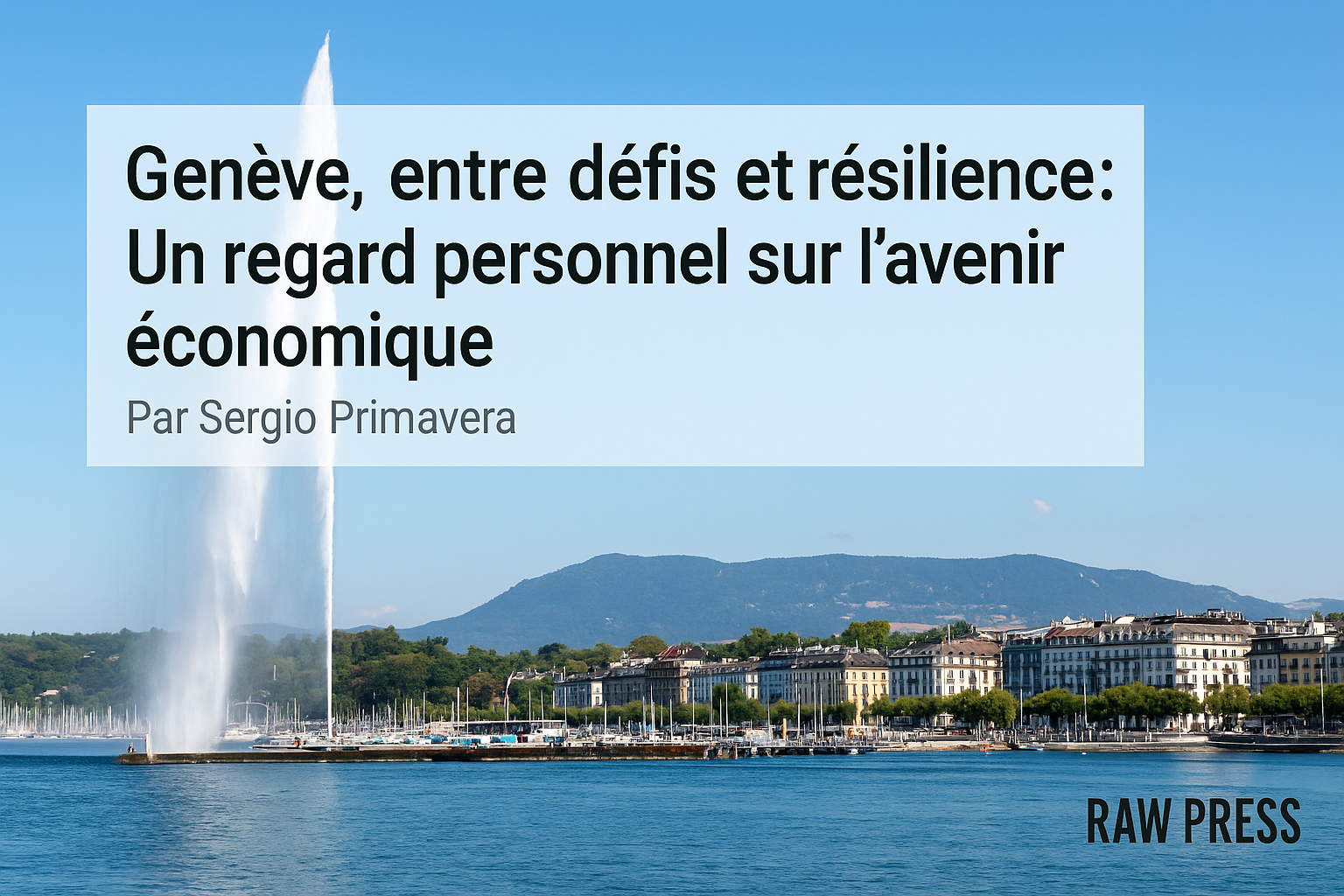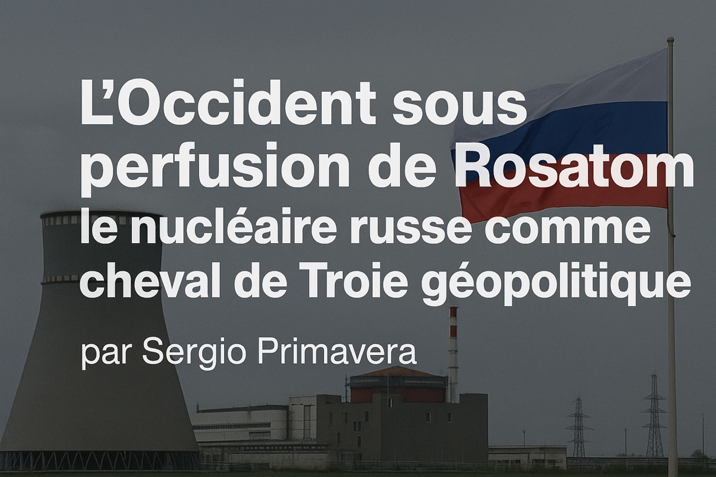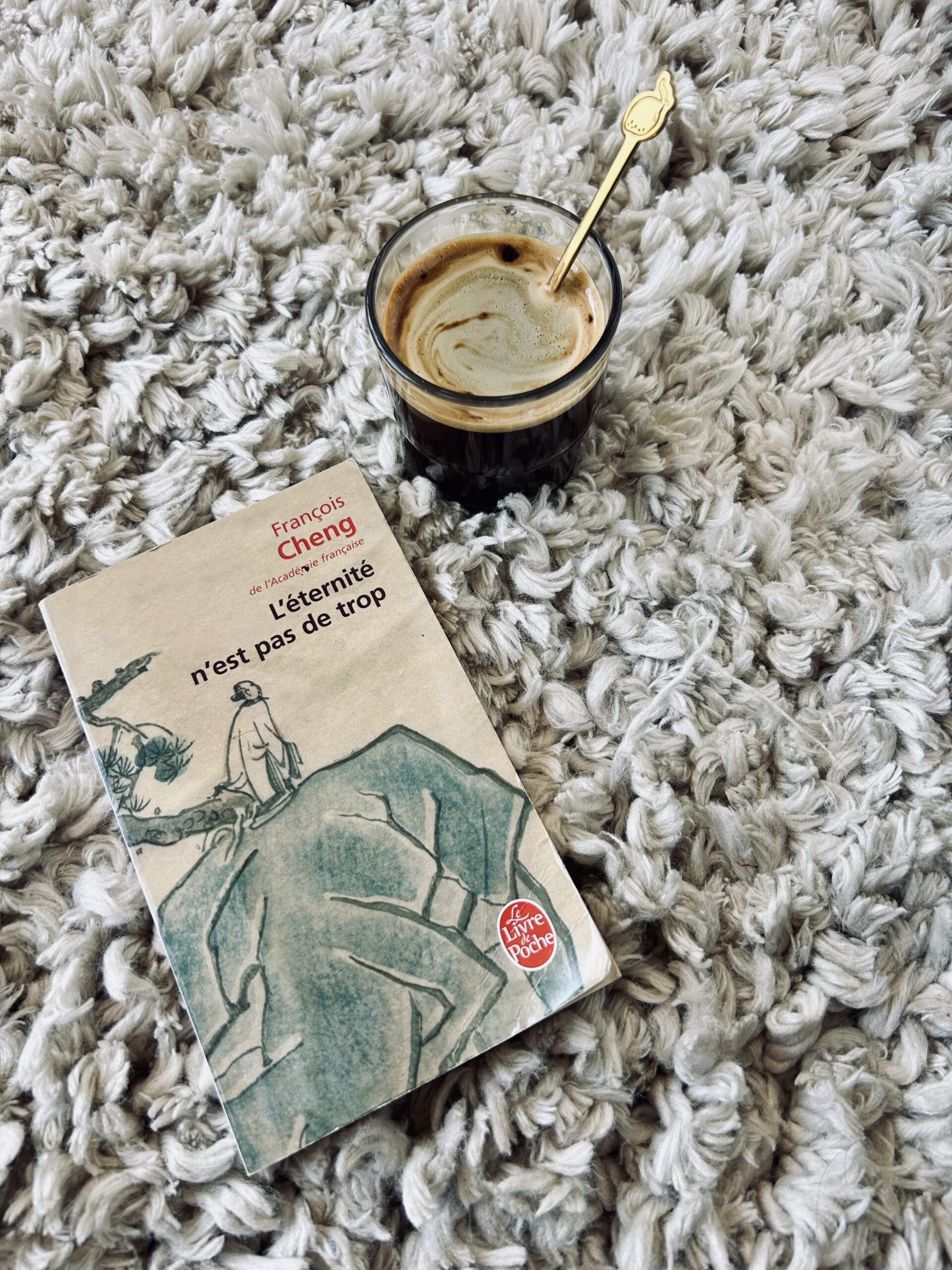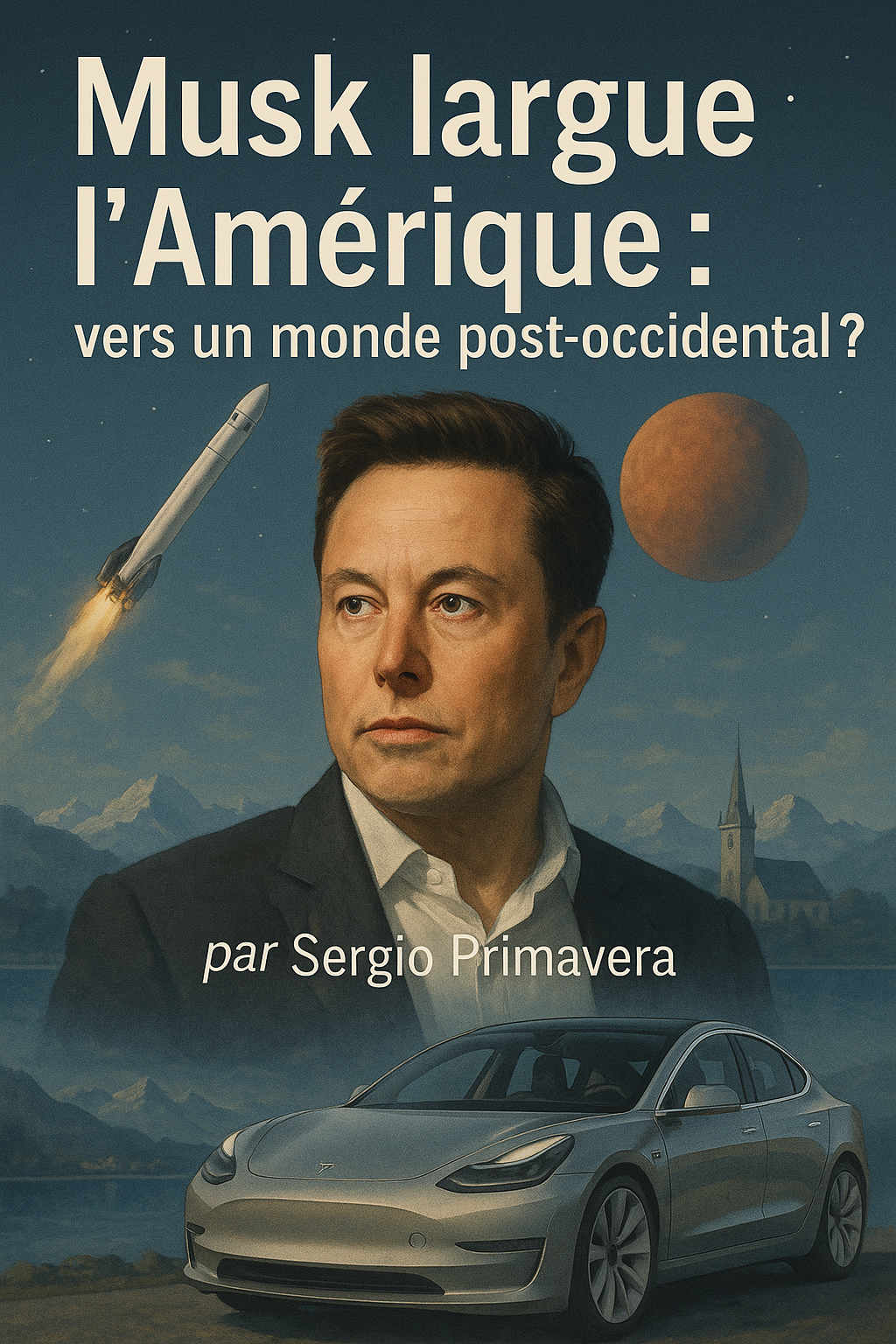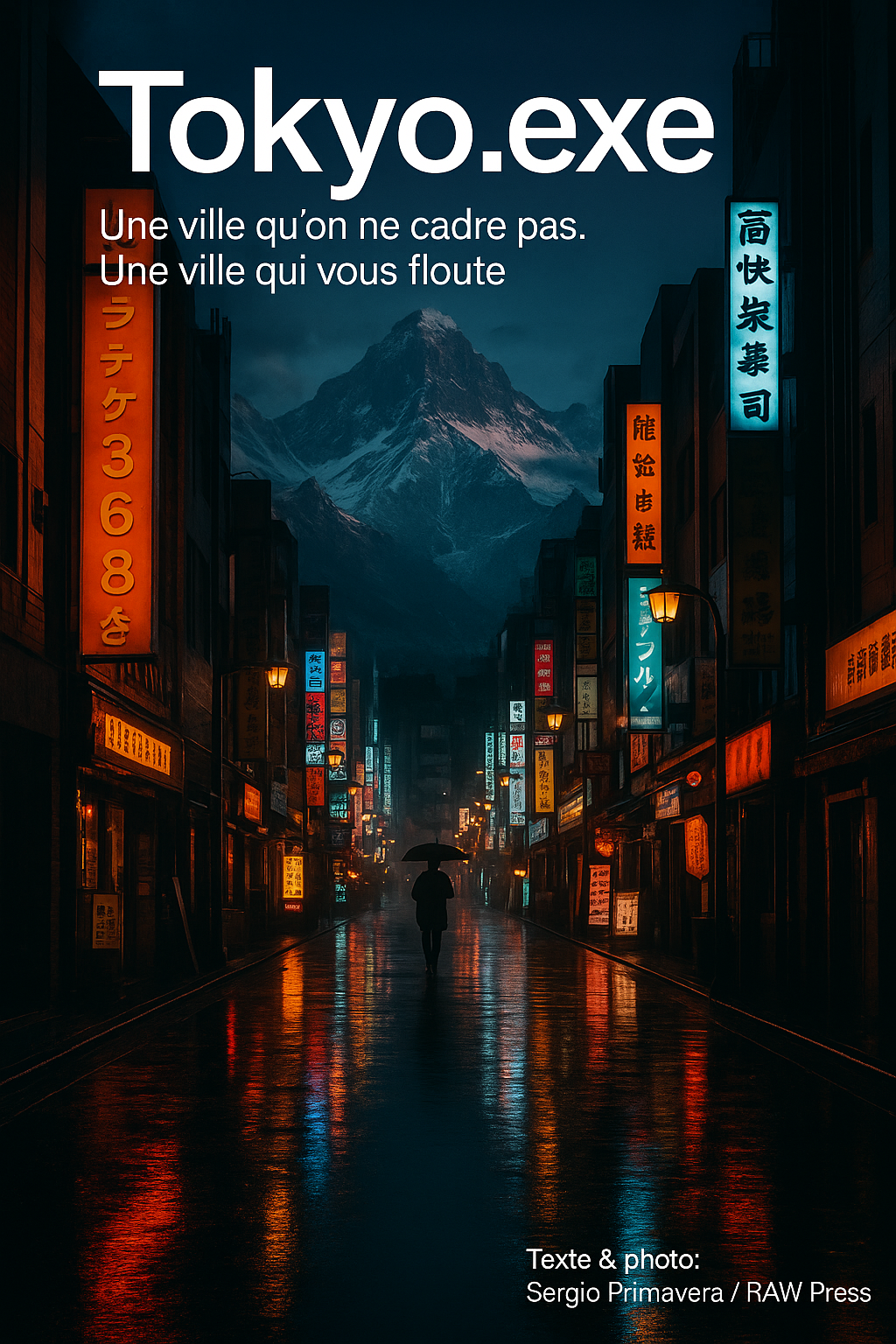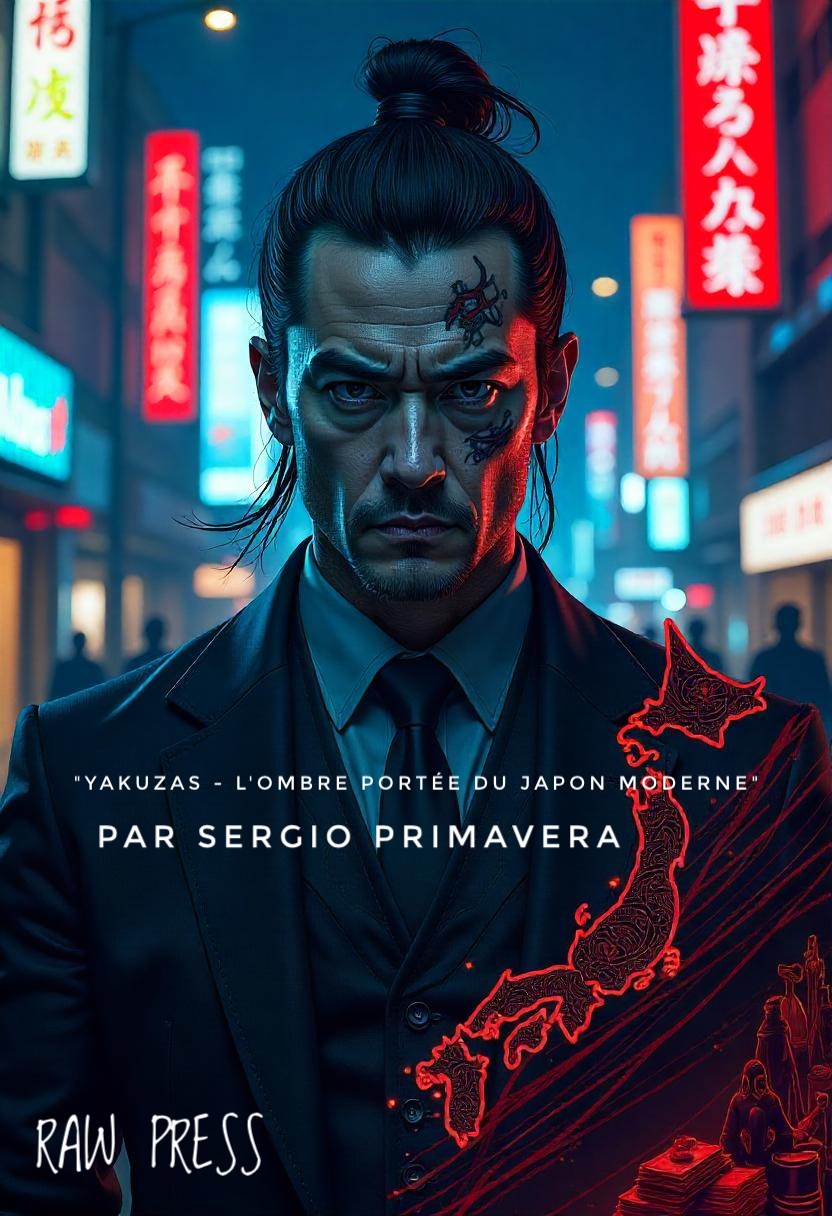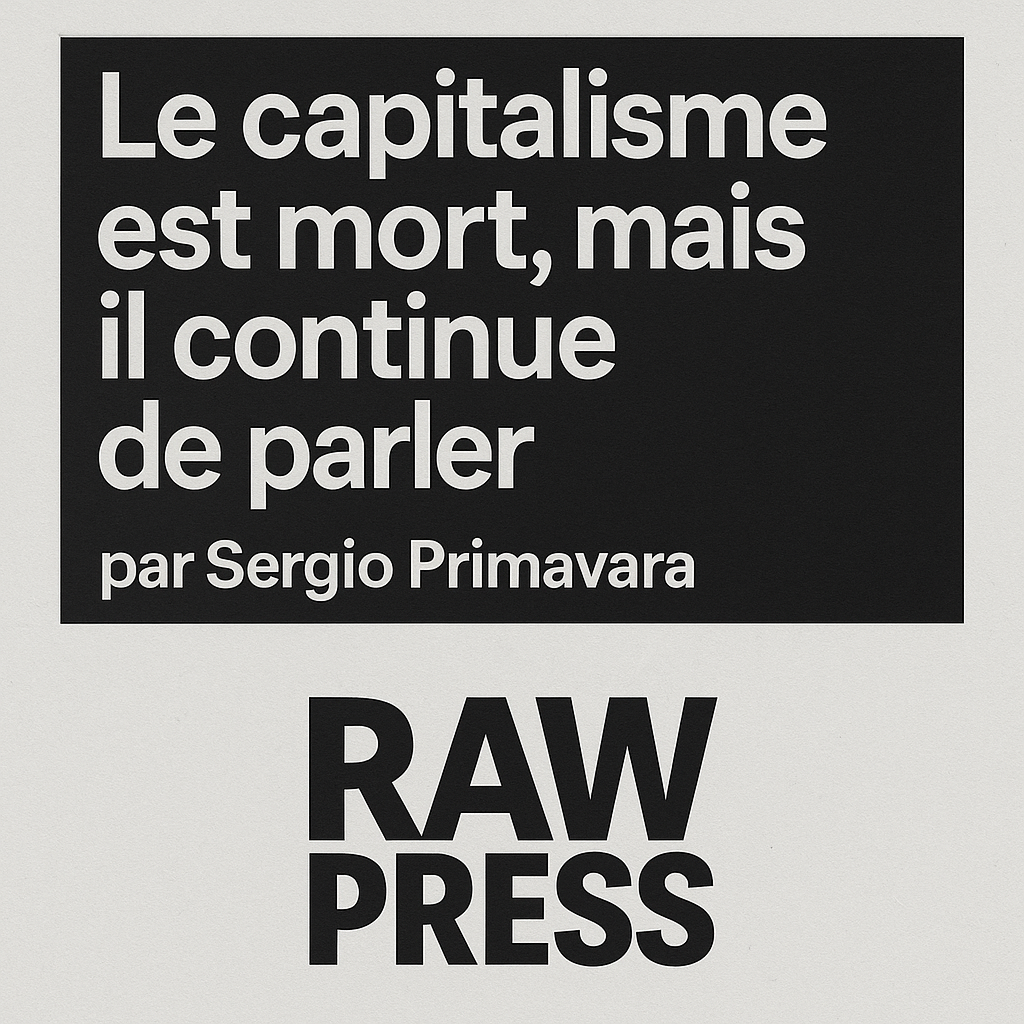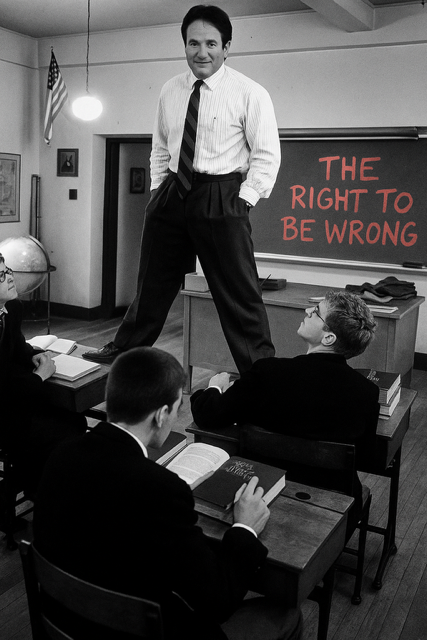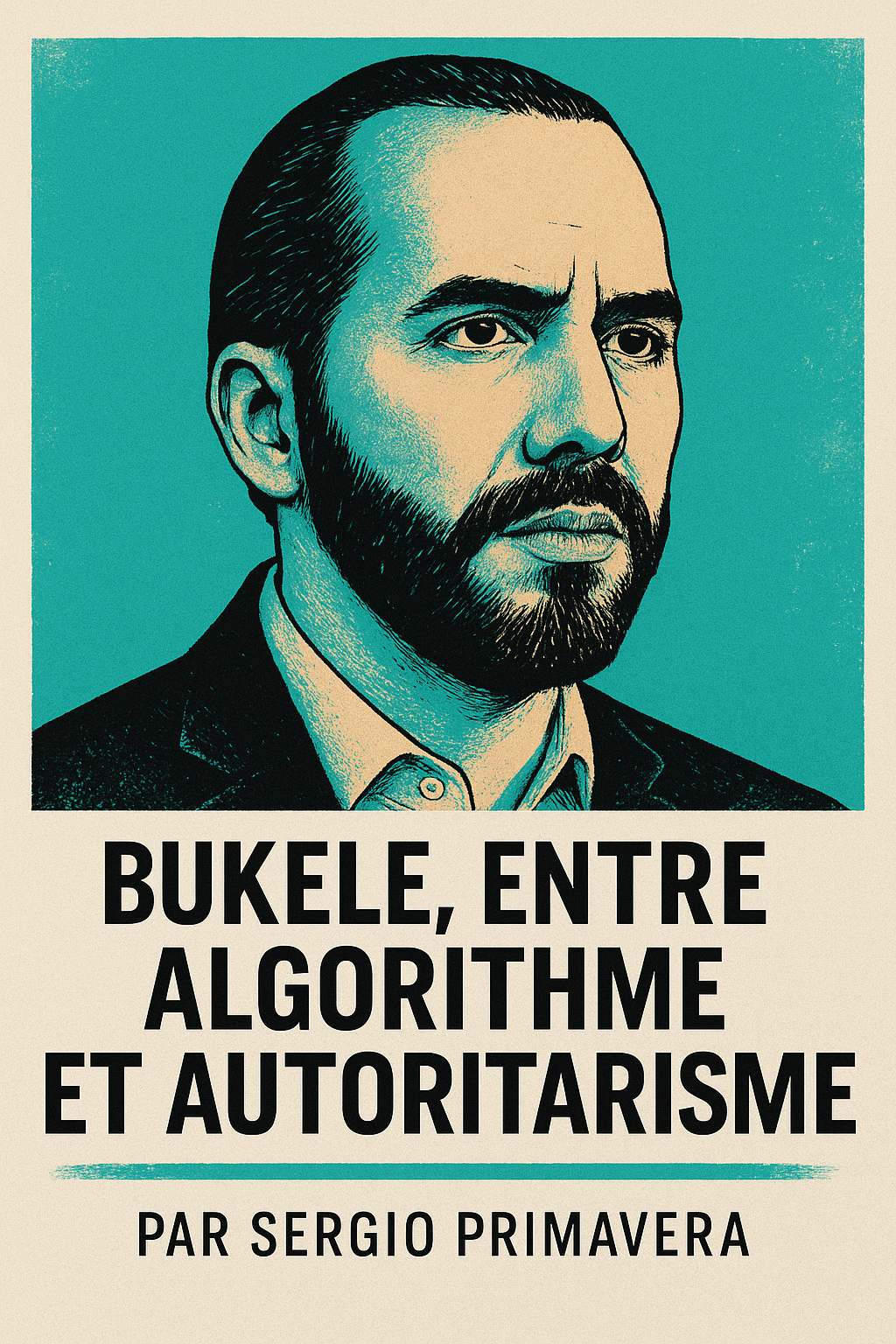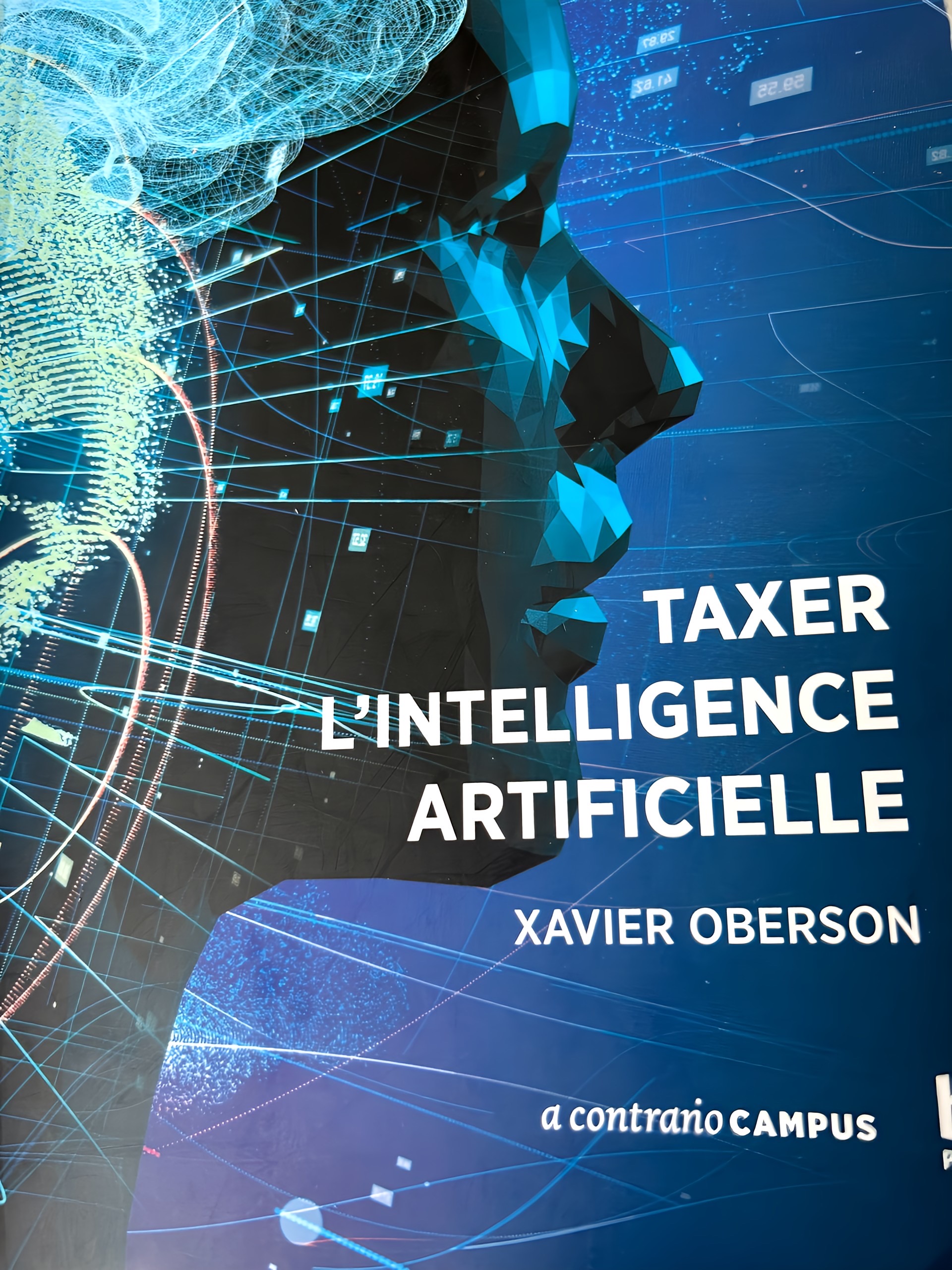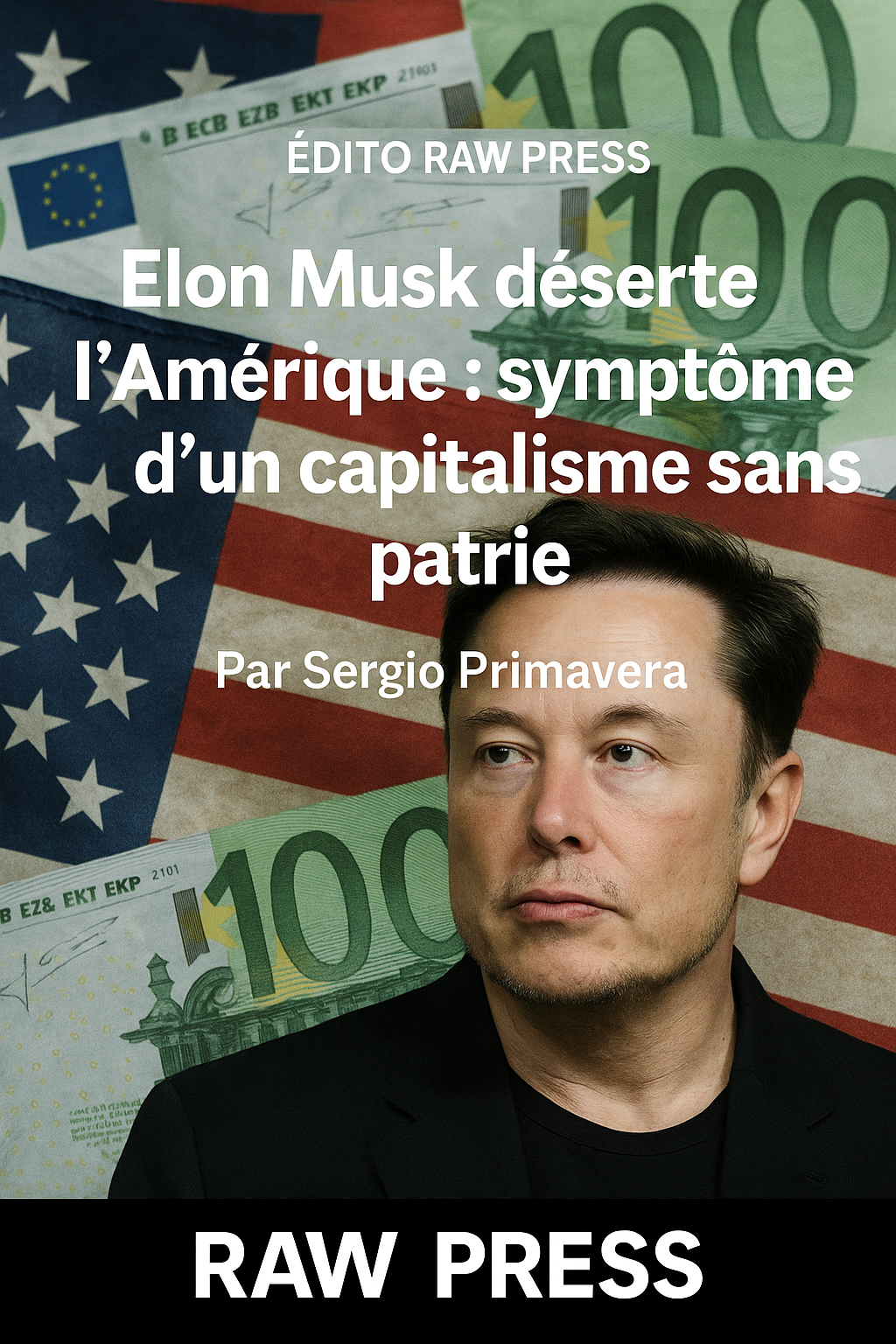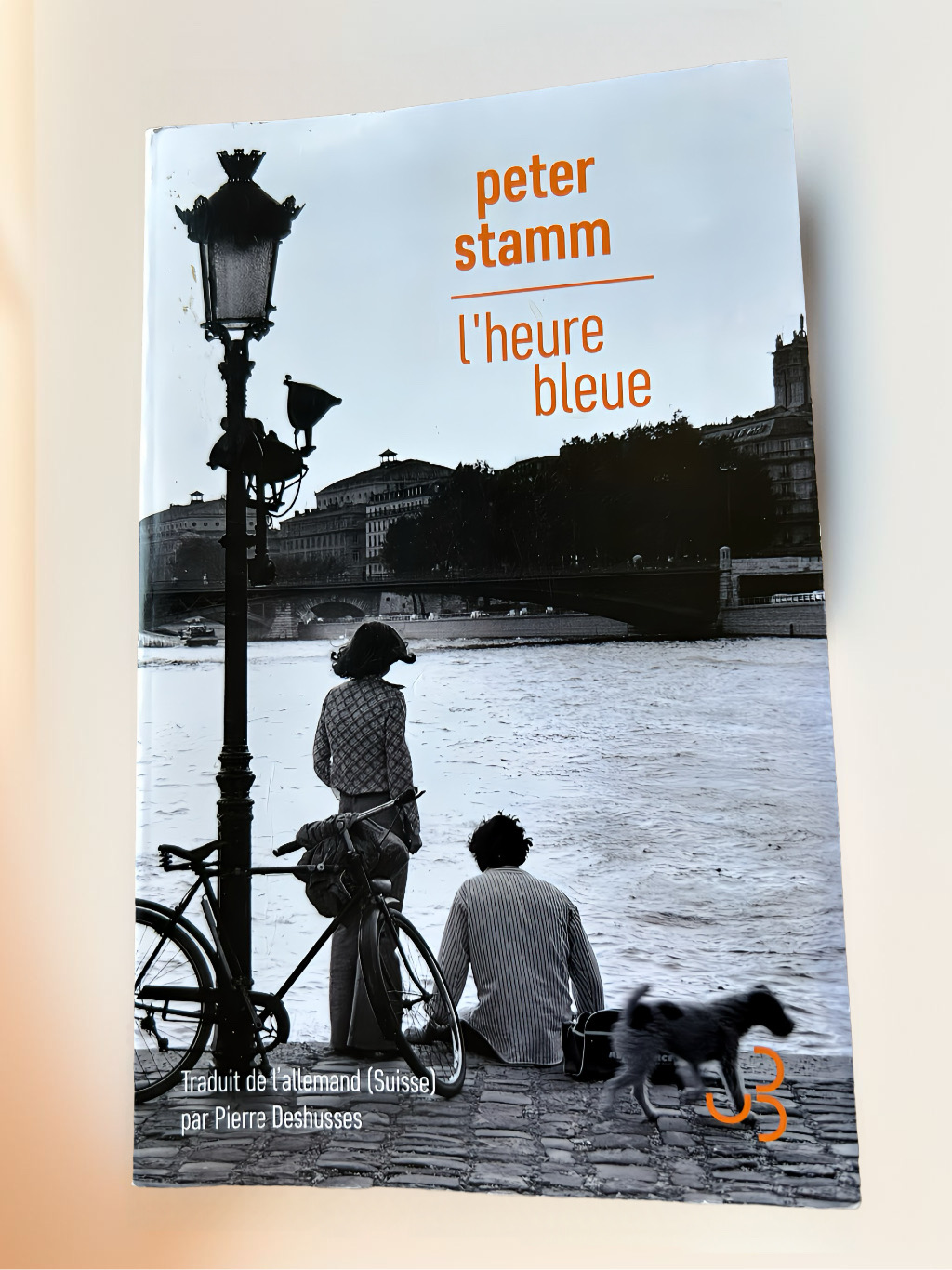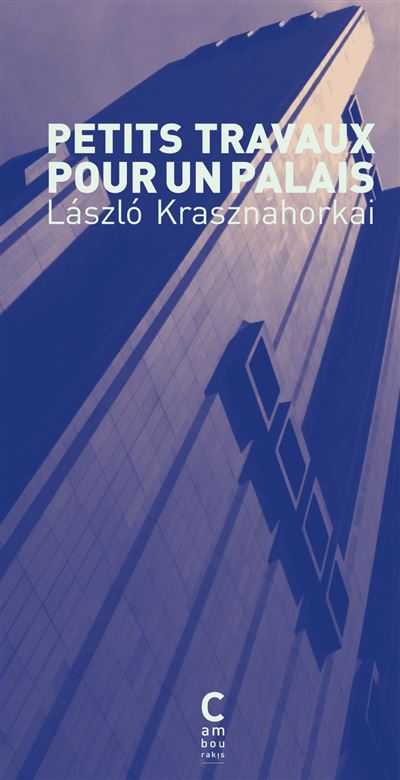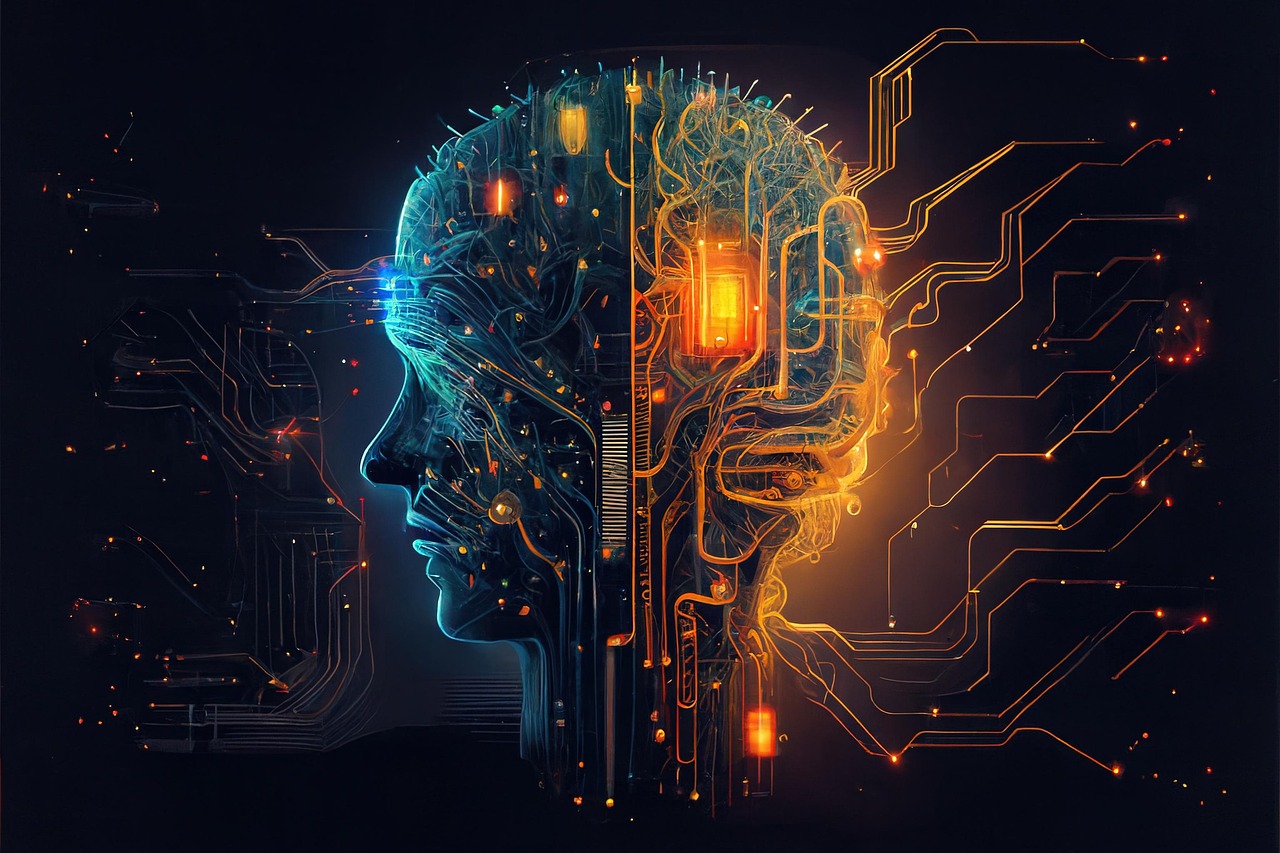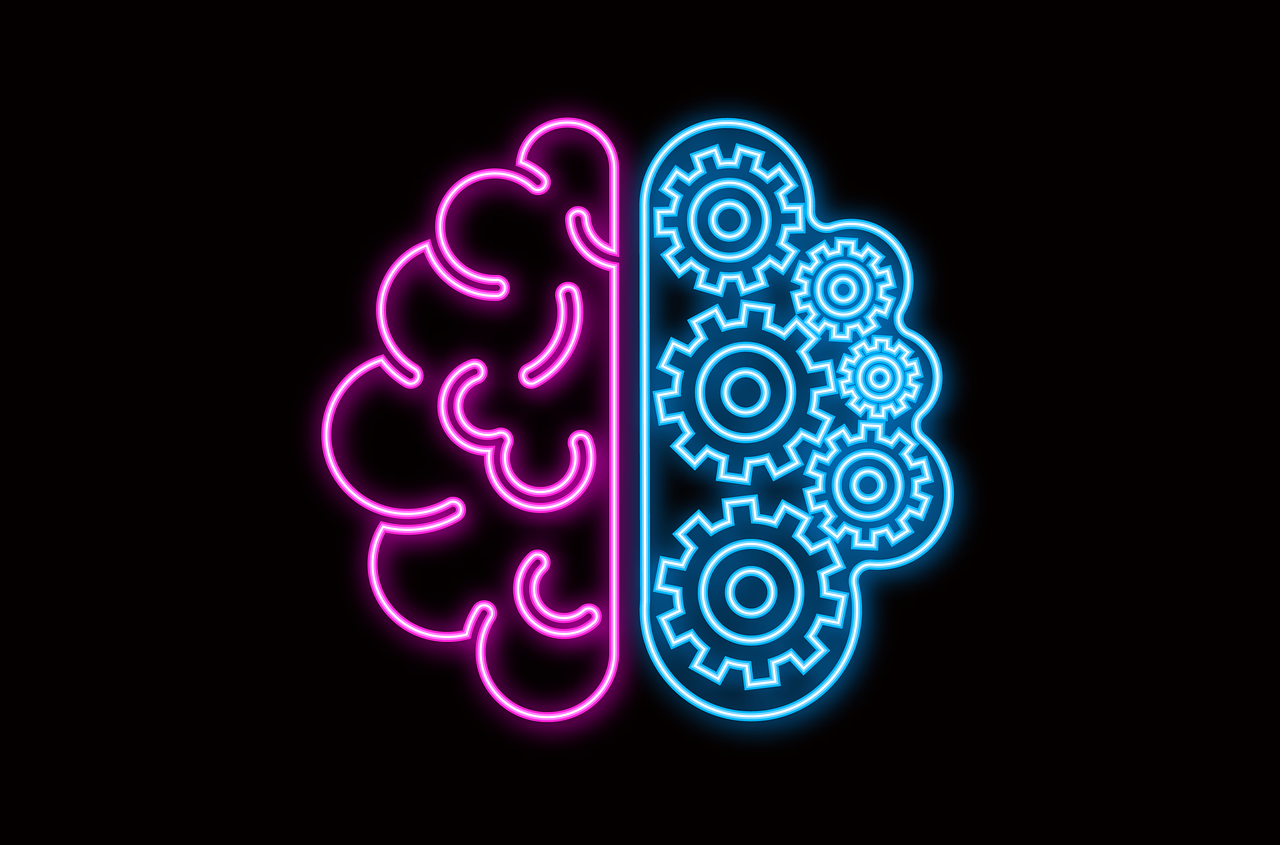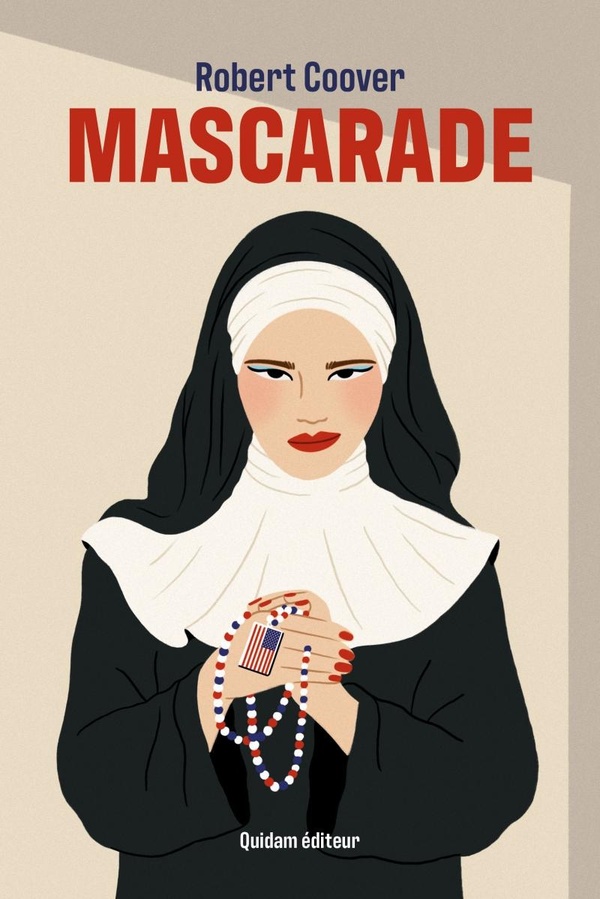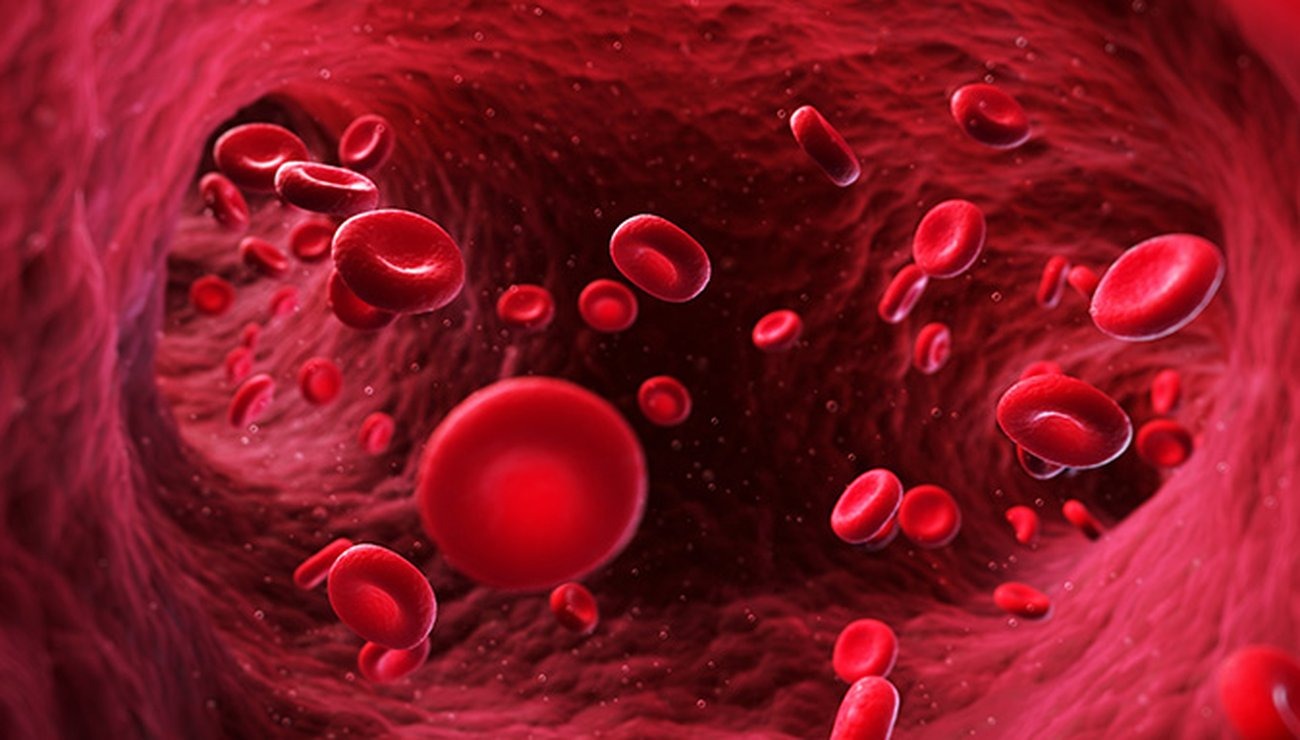Une nouvelle internationale réactionnaire à l’horizon
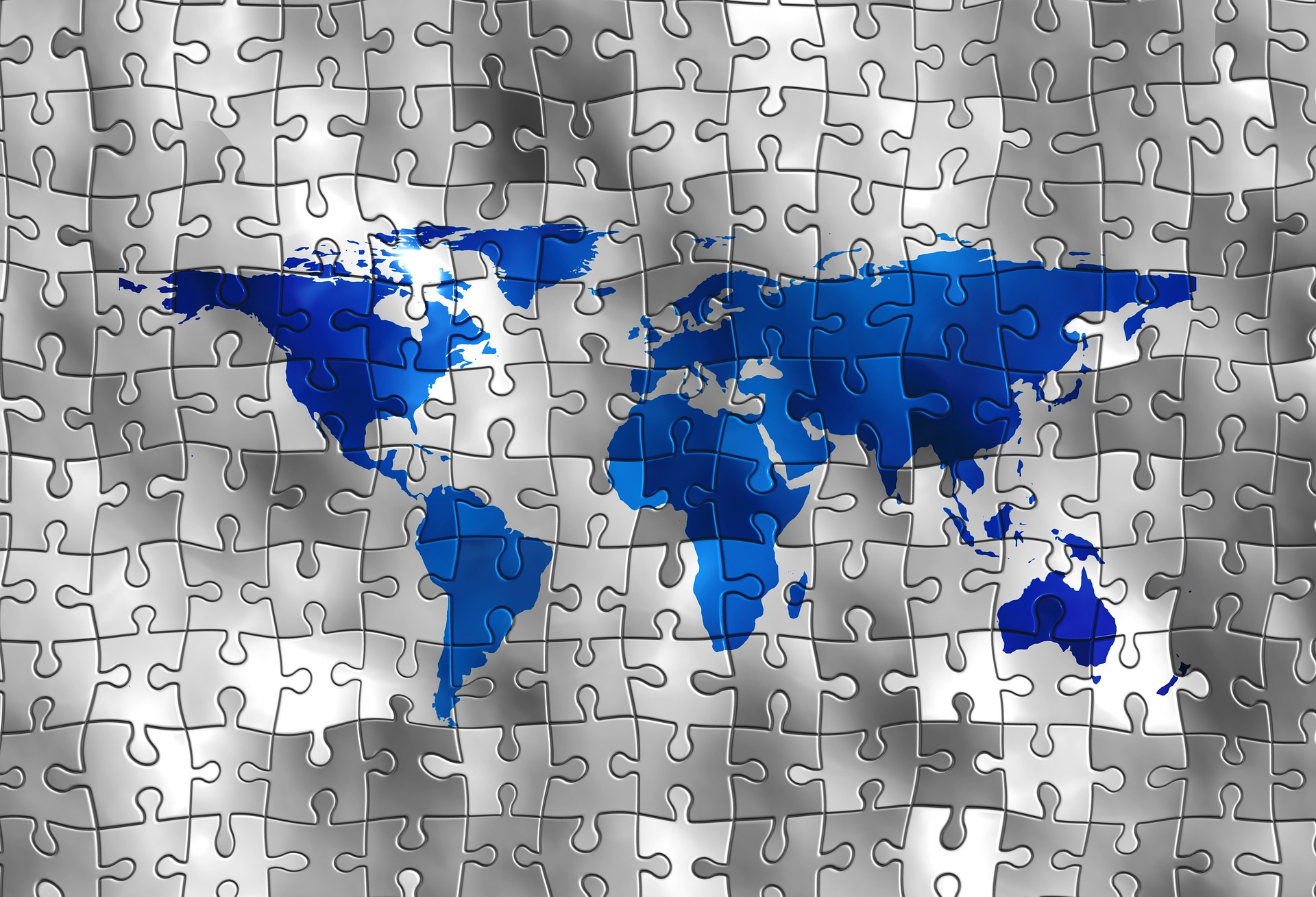
À l’aube de 2025, la réinstallation de Donald Trump à la Maison-Blanche marque bien plus qu’un simple retour au pouvoir d’un ancien président. Elle s’inscrit dans une lame de fond politique qui secoue les démocraties occidentales et leurs équilibres fragiles. Certains parlent d’une « nouvelle internationale réactionnaire » – une expression qui a certes du panache, mais qui sonne parfois creuse lorsqu’elle est maniée sans nuance. Alors, essayons de la déconstruire avec nos propres termes et de comprendre ce qu’elle signifie dans ce monde fracturé où nous évoluons.
Un écho de l’Histoire, un cri du présent
L’élection de Trump s’inscrit dans une série d’événements mondiaux où l’on voit des figures politiques et des mouvements idéologiques prônant un retour à des valeurs perçues comme « traditionnelles ». Ce conservatisme revigoré n’est pas anodin. De Bolsonaro au Brésil à Viktor Orbán en Hongrie, en passant par Giorgia Meloni en Italie, cette vague n’est ni une coïncidence, ni un simple phénomène local. Elle est l’expression d’un ras-le-bol global, une défiance contre les élites globalistes, un rejet des institutions perçues comme déconnectées des réalités populaires.
Mais ce qui frappe, c’est la coordination implicite de ces acteurs. Si l’on ne peut pas parler d’une véritable « internationale », dans le sens historique du terme, il est indéniable que ces figures s’inspirent les unes des autres, amplifient leurs discours par effet miroir et partagent des ennemis communs : les médias traditionnels, les institutions supranationales, les progressismes débridés.
Un monde qui se replie sur lui-même
Personnellement, ce n’est pas tant le contenu idéologique de ces mouvements qui m’interroge – car le retour de valeurs conservatrices est cyclique dans l’Histoire – mais bien la manière dont ils réinterprètent le monde globalisé.
Trump, par exemple, ne revient pas comme un simple « président ». Il est le symbole d’un État-nation qui s’affirme dans un système international fragmenté. L’Amérique, dans son narratif, ne s’excuse plus. Elle reprend ce qu’elle estime être son dû, quitte à sacrifier les alliances construites sur des décennies. Cette approche, loin d’être isolée, fait des émules. L’Europe, avec Meloni ou Orbán, suit une trajectoire similaire, réaffirmant la souveraineté nationale comme une réponse aux crises sociales, migratoires et énergétiques.
Cette posture entraîne des conséquences profondes. Le multilatéralisme, déjà vacillant, s’effondre peu à peu, remplacé par des accords bilatéraux, des alliances de circonstance. Le G20, l’ONU, l’OMC : toutes ces institutions qui portaient l’espoir d’un monde unifié semblent devenir des vestiges du XXe siècle.
Le prix du repli
À la fois témoin et analyste de notre époque, je ne peux sous-estimer les interrogations que soulève le coût de ce mouvement. Si ces figures politiques prospèrent, c’est parce qu’elles répondent à des angoisses bien réelles : l’insécurité économique, la perte d’identité culturelle dans un monde globalisé, la peur d’un avenir incertain. Mais en y répondant par le repli, ne risquons-nous pas de créer un monde encore plus fracturé, encore plus conflictuel ?
Regardons les États-Unis, aujourd’hui profondément divisés. Trump n’est pas seulement le président des « Forgotten Men and Women » (comme il aime les appeler) : il est aussi le catalyseur d’une polarisation sociale extrême. Si la dynamique actuelle persiste, ce qui menace nos démocraties, ce n’est pas tant le retour à un ordre conservateur qu’une désintégration des consensus sociaux sur lesquels elles reposent.
L’avenir en clair-obscur
Je ne suis pas un alarmiste. Il est possible que cette vague réactionnaire pousse, par contraste, à un renouveau des idées progressistes. Mais pour cela, il faut que ces dernières apprennent à répondre aux angoisses des citoyens plutôt que de les mépriser. Le mépris a été, à mon sens, l’une des plus grandes fautes des élites de ces dernières décennies. C’est ce qui a nourri Trump, Orbán et tous les autres.
Loin de rejeter d’emblée cette « internationale réactionnaire », je pense qu’il est crucial d’en comprendre les racines. Les changements qu’elle entraîne seront décisifs pour les décennies à venir. La question est de savoir si ce mouvement sera un simple retour cyclique aux valeurs traditionnelles ou s’il marquera une réécriture durable des règles du jeu politique mondial.
Je garde donc un œil ouvert et une plume affûtée, prêt à documenter ce qui, peut-être, est bien plus qu’une réaction : une révolution politique qui ne dit pas son nom.
Retrouvez-nous
sur vos réseaux