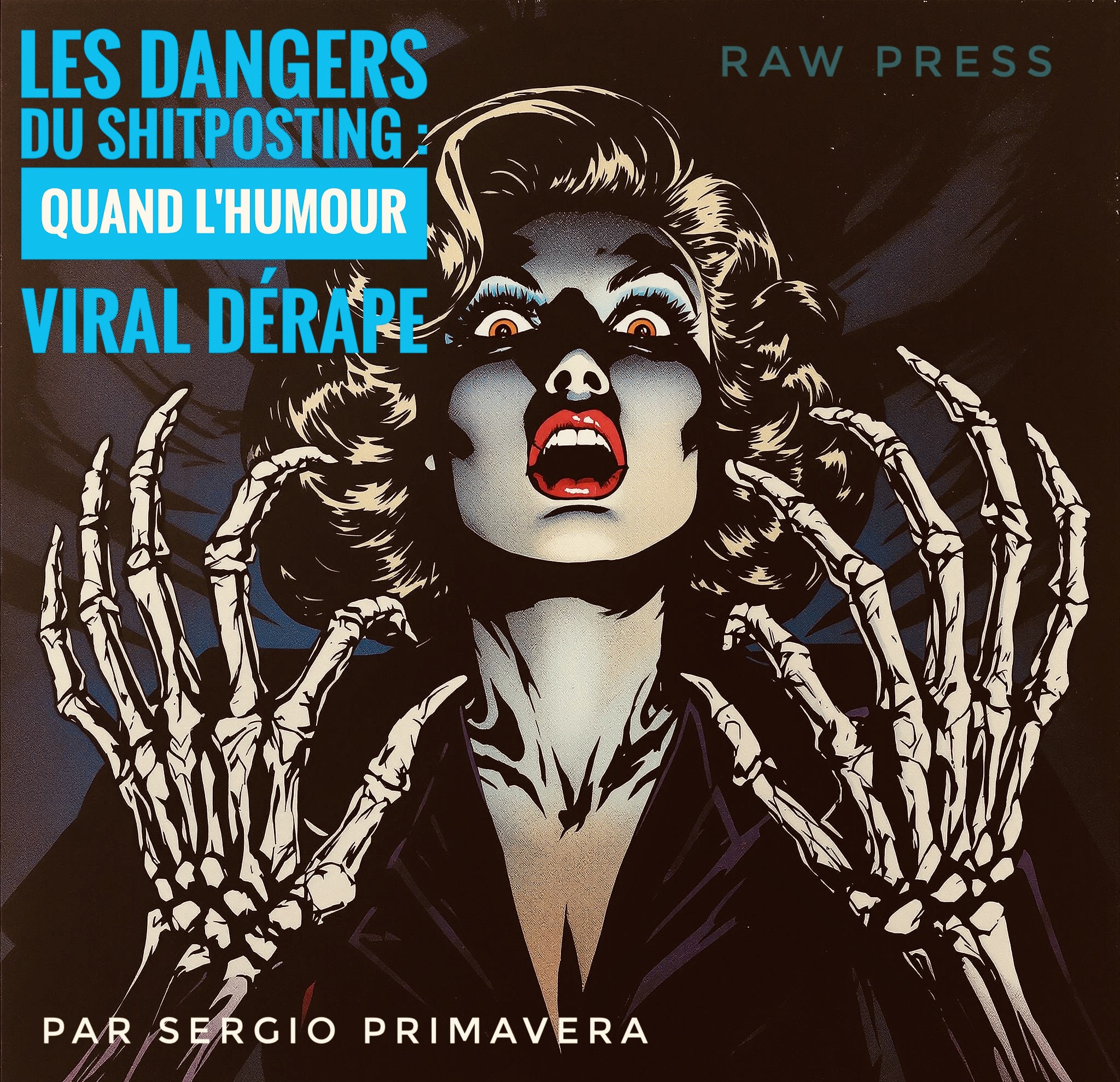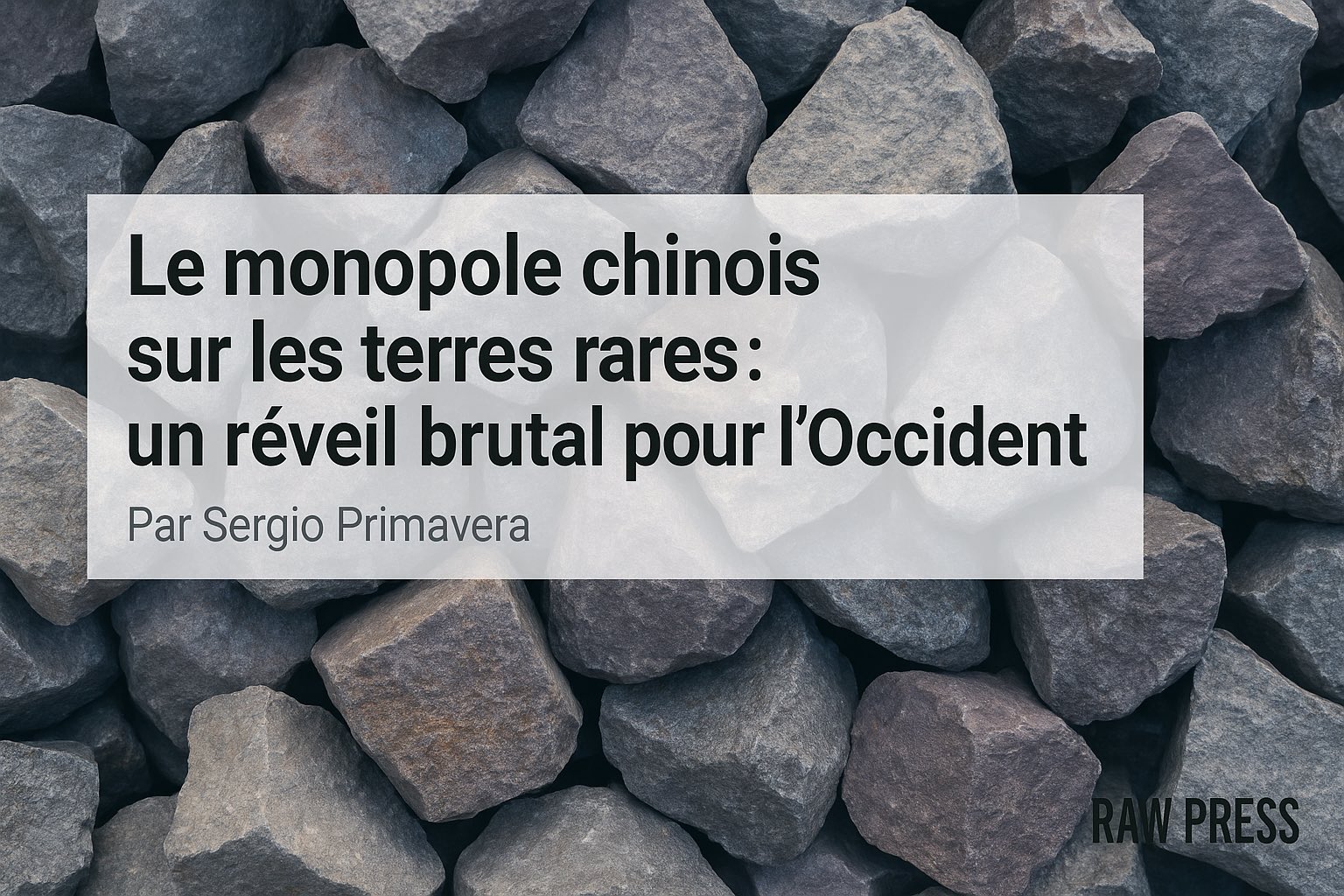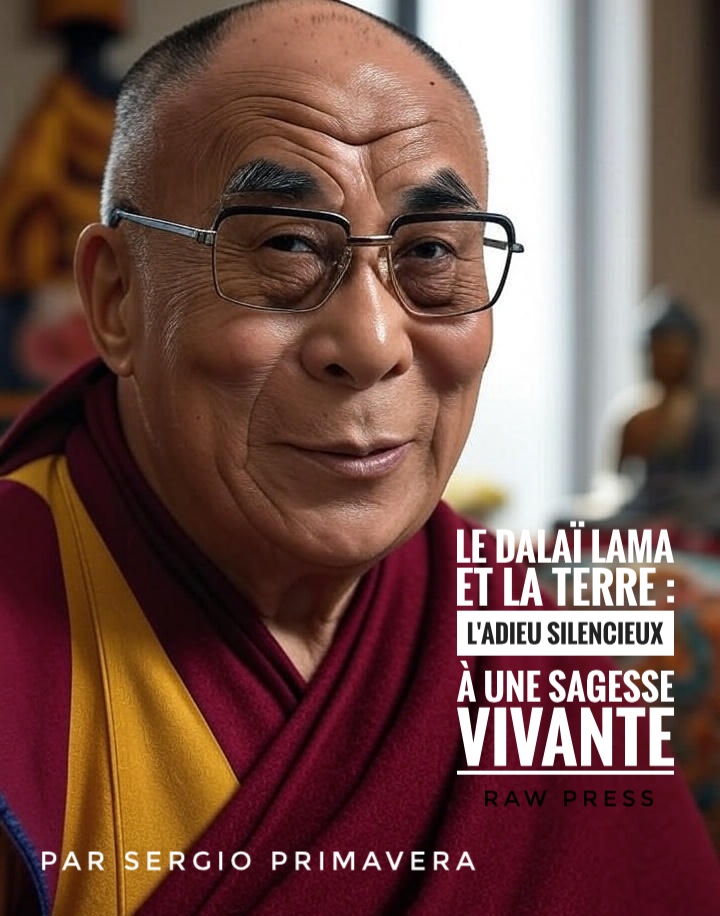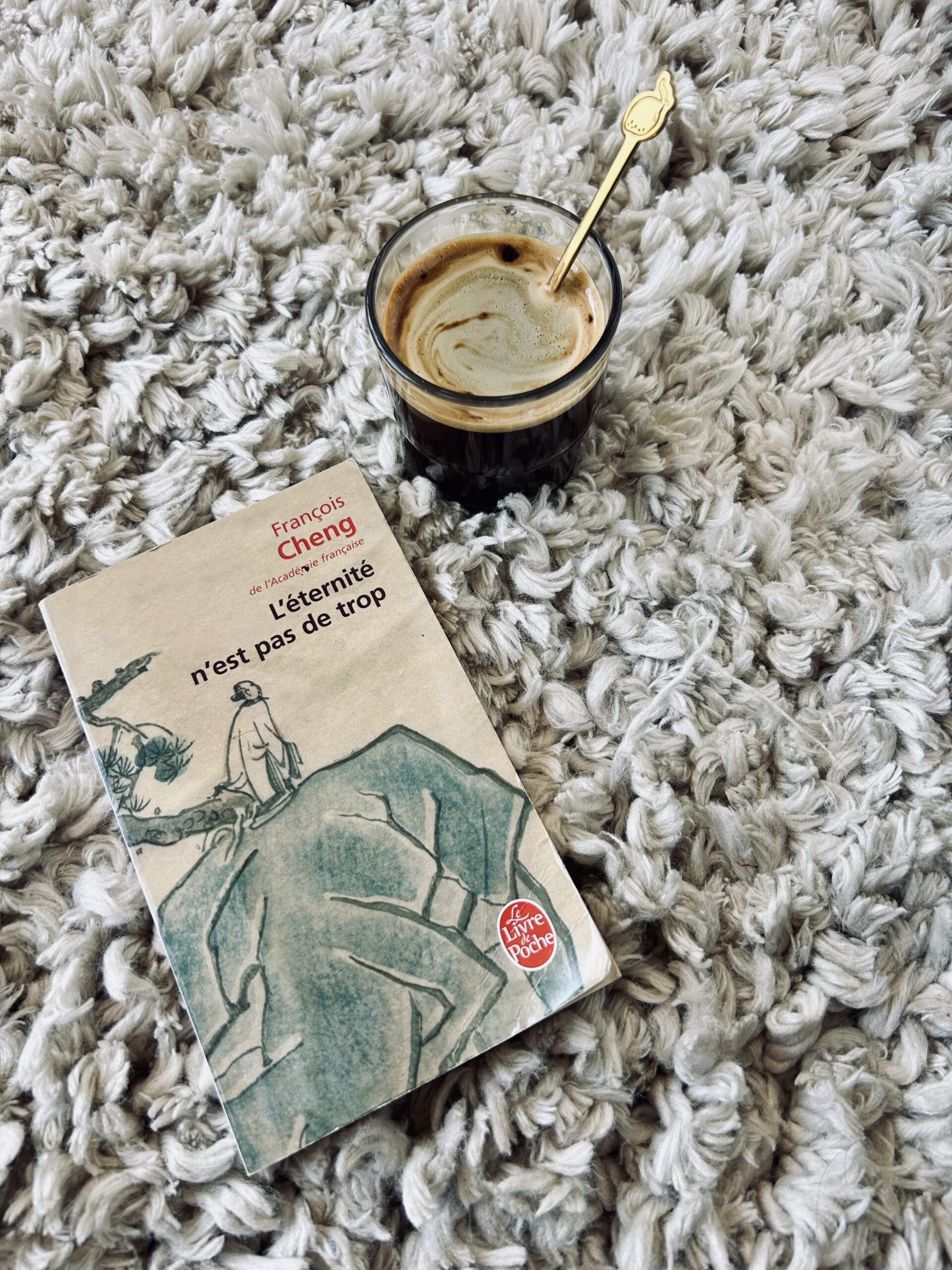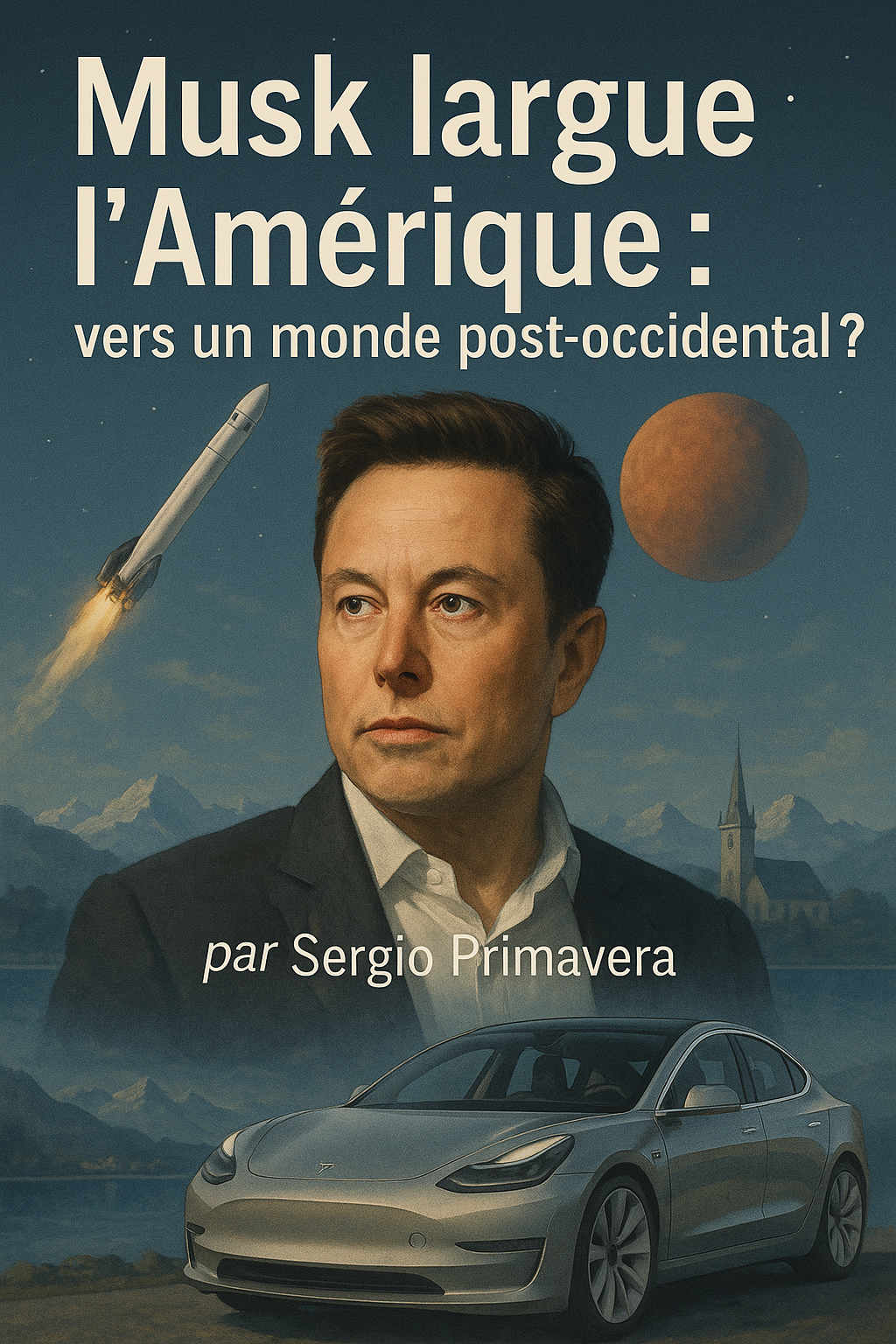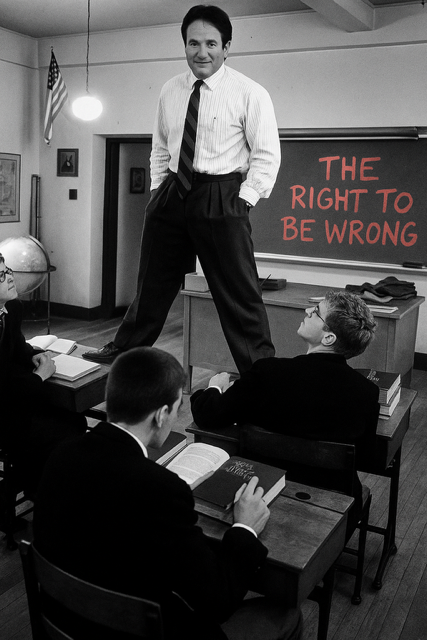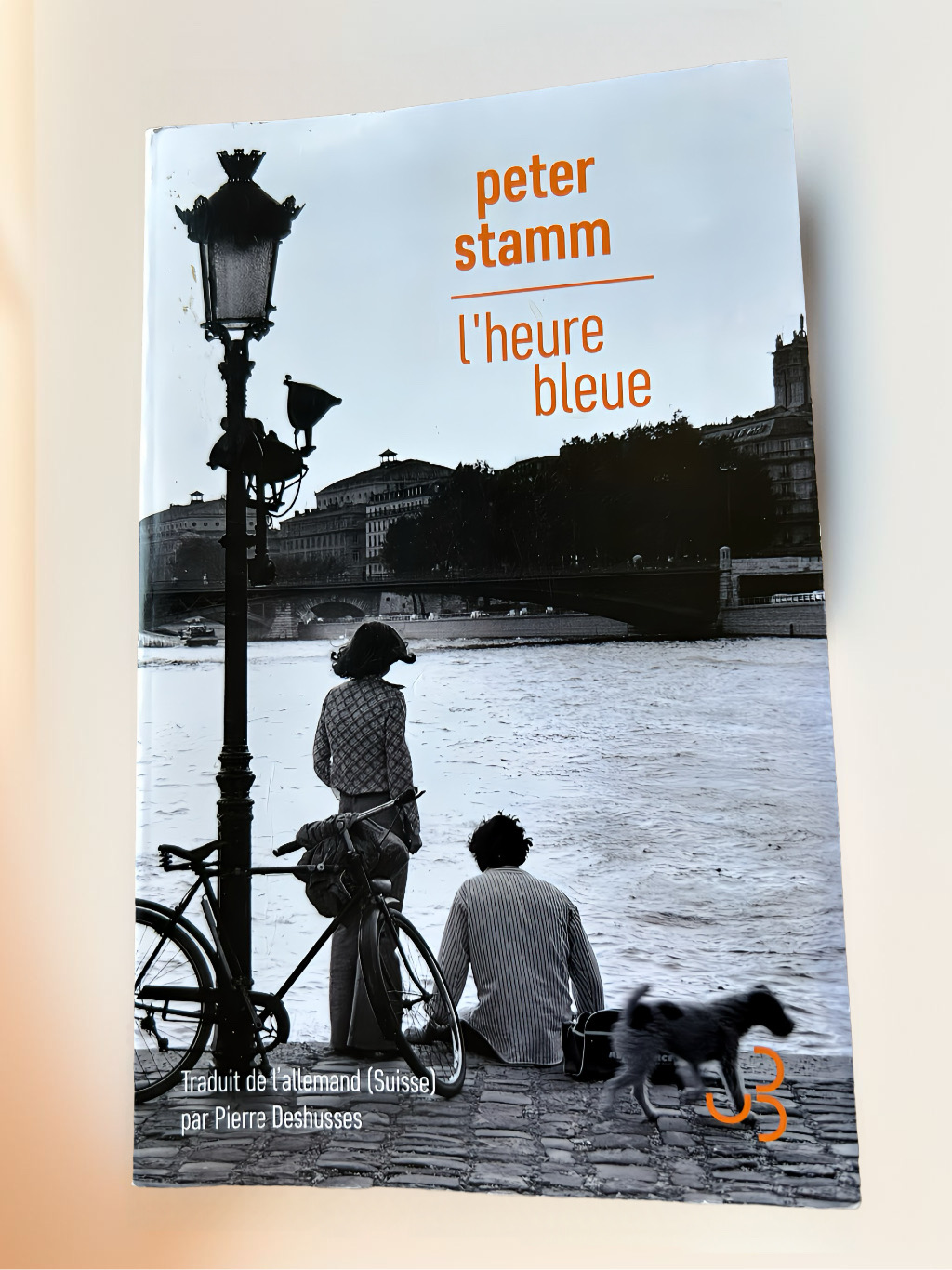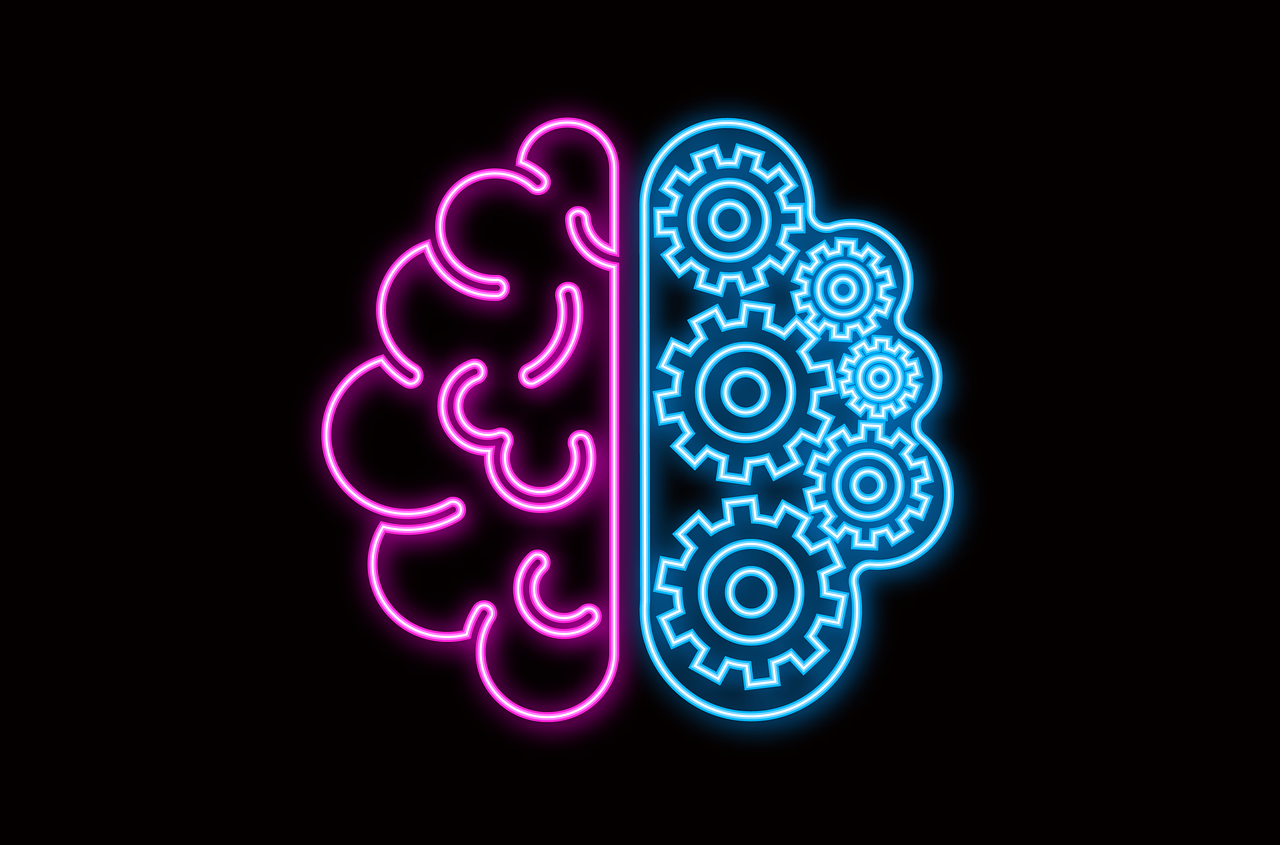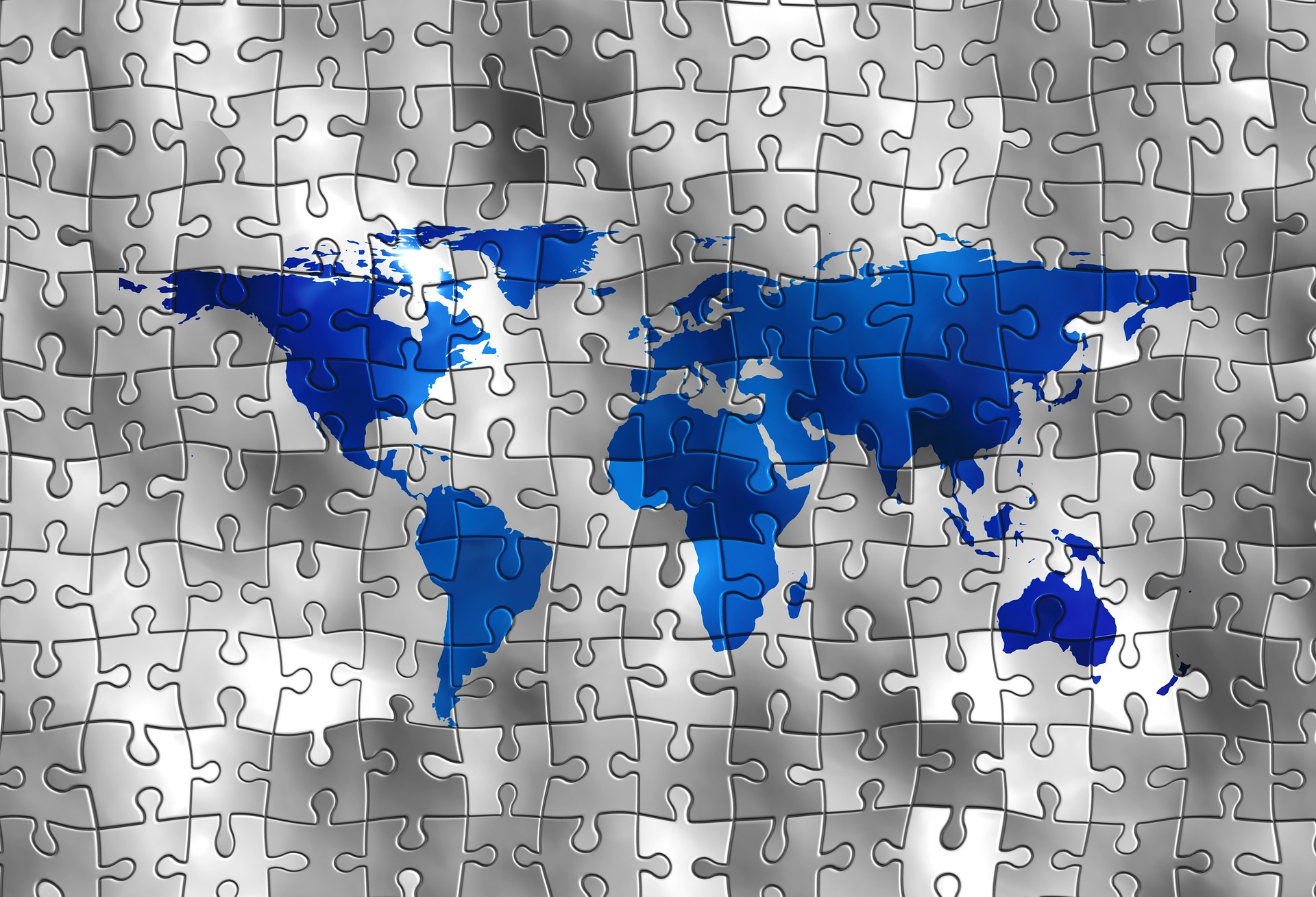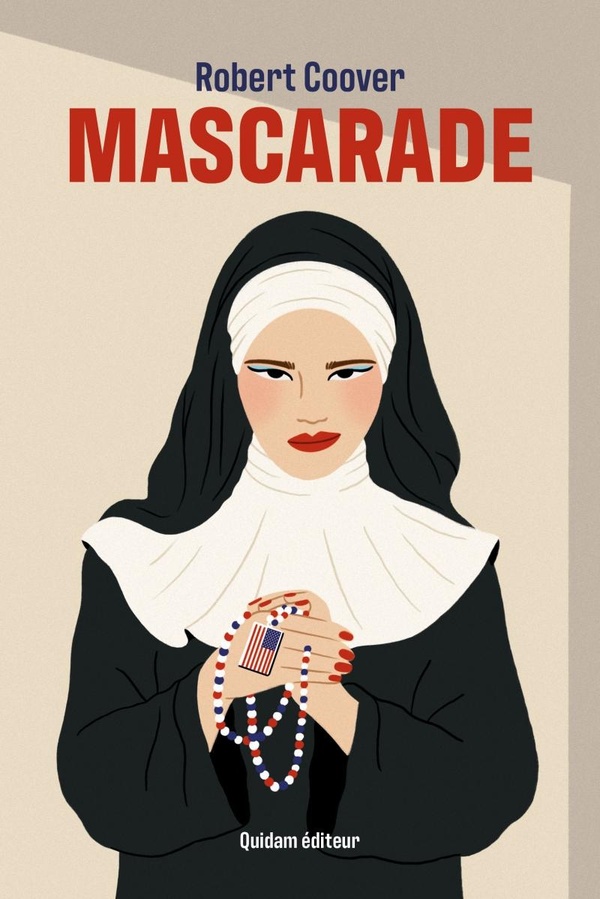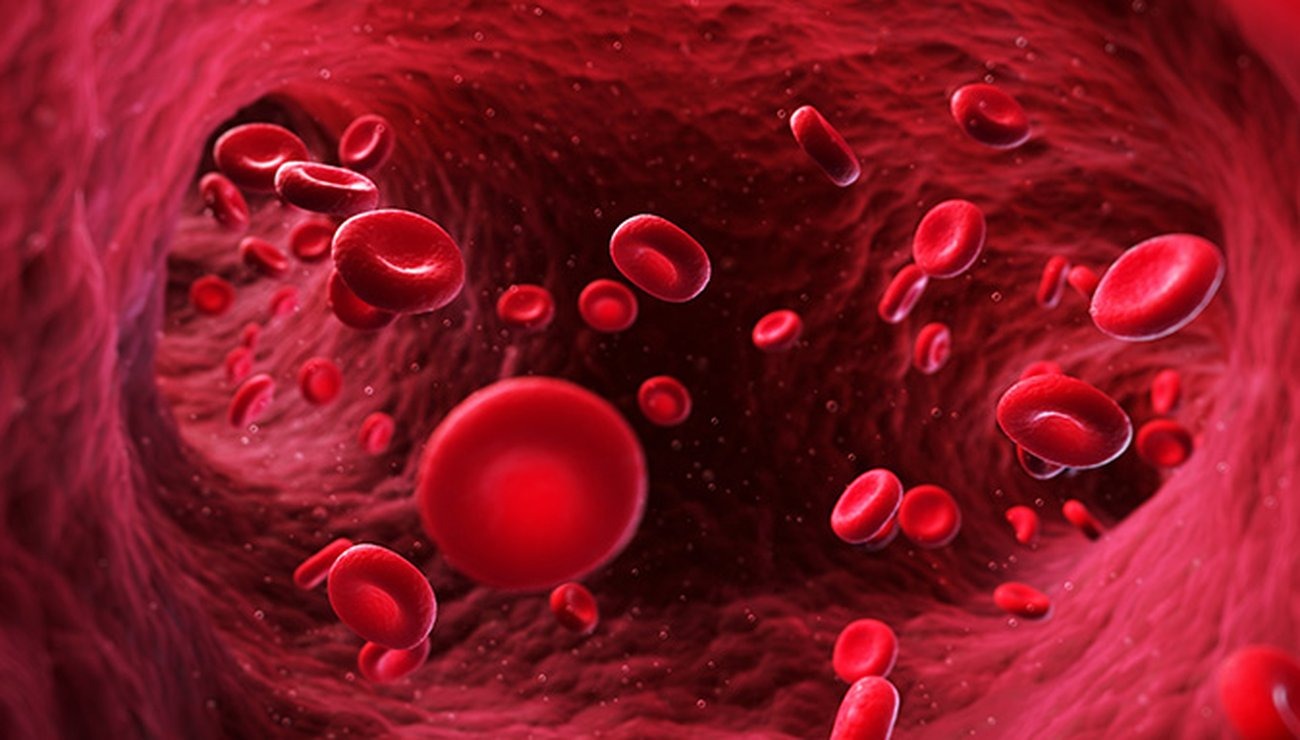L’intimité capturée : une rencontre avec Yigal Ozeri, maître du photoréalisme poétique

“ Il y a des artistes que l’on rencontre avant même de les connaître. Leurs œuvres vous happent, vous traversent, s’impriment en vous comme un souvenir ancien. C’est ainsi que j’ai découvert Yigal Ozeri. C’était il y a quinze ans, à la foire Scope Art. Une toile immense — trois femmes dansant nues dans un champ — m’a stoppée net. J’ai ressenti cette chose rare, presque physique : un mélange de douceur, de liberté, et de mystère. Derrière la surface lisse du réalisme, une faille s’ouvrait, poétique et vertigineuse” . C’est ainsi que l’épouse d’Ygal a décrit sa première rencontre à la fois avec l’art et la personne d’Ygal Ozeri.
Et il est vrai qu’il y a dans son art quelque chose de captivant. À première vue, je me demandais si l’attention de mon regard avait été saisie par la technique. L’interrogation : est-ce une photo ? Quel est le support de réalisation ? Ces beautés existent-elles ou sont-elles générées par IA ? Mais non, cela allait bien plus loin que cela. Yigal Ozeri met dans ses toiles de la douceur et de la poésie. Une fragilité féminine. Quelque chose qui transcende la simple technique hyperréaliste.
À Art Basel, c’est enfin l’homme derrière l’image que j’ai eu la chance d’interviewer. D’un calme étonnant, regard perçant mais sourire tranquille, il parle comme il peint : sans fioritures, mais avec précision, intuition et sincérité. “Je continuerai de peindre jusqu’au dernier jour”, me dit-il sans hésiter. “C’est la seule chose que j’essaie de faire. Donner un peu de beauté au monde. Voir un sourire sur le visage de quelqu’un devant une toile, c’est ça, mon but.” Son humilité désarme. Car derrière cette simplicité se cache un parcours immense.
Une trajectoire d’abstraction à l’intime
Yigal Ozeri commence sa carrière dans les années 2000 comme peintre abstrait. Il est rapidement reconnu, exposé, collectionné. Mais très vite, il ressent un besoin de changement. “Le photoréalisme m’a appelé. C’était une façon de me reconnecter à quelque chose de plus profond, de plus direct.” Il s’éloigne des formes pour revenir au visible, mais sans jamais céder au pur mimétisme. “Photographier, c’est le point de départ. Je prends des centaines de clichés, des vidéos aussi. Ensuite, je manipule l’image, je transforme, je compose… Ce que je peins, ce n’est pas la réalité, c’est l’émotion que je veux transmettre.”
Ses sujets ? Essentiellement des femmes. Dans la nature. En mouvement, souvent nues, mais jamais offertes au regard de manière vulgaire. “Je ne travaille pas avec des mannequins. Je cherche des personnes. Des âmes. Des êtres qui portent quelque chose, un éclat, une fragilité, un mystère.” Il me confie qu’il ne dirige presque jamais ses modèles. Il place simplement la caméra à bonne distance, et les laisse être. “Je veux qu’elles oublient l’appareil, qu’elles retrouvent leur liberté. C’est à ce moment-là que la magie opère.”
Une vision de la femme libre, forte, intuitive
On pourrait, de l’extérieur, critiquer l’abondance de nus dans son travail. Mais il suffit de l’écouter parler pour comprendre que chez Ozeri, la nudité n’est ni érotique ni décorative. Elle est politique, presque mystique. “Je ne peins pas de corps. Je peins des présences. Des êtres vivants dans un monde vivant.” Il refuse toute objectification. Pour lui, peindre une femme, c’est explorer sa relation à la nature, à elle-même, à la solitude. “Les femmes sont, pour moi, les êtres les plus forts au monde. Elles ont une sensibilité immense. Elles sont capables d’intimité avec elles-mêmes, avec leur environnement. Les hommes, souvent, en sont coupés.”
Dans ses œuvres, on les voit marcher seules sur des plages, s’allonger dans l’herbe, danser au milieu des arbres, cheveux au vent. Rien n’est figé, tout est mouvement, souffle, respiration. “Il y a toujours un combat”, ajoute-t-il. “Femme contre nature. Femme dans la nature. Femme avec la nature. Et souvent, c’est la femme qui gagne.” Une manière aussi, peut-être, pour lui de conjurer ses propres peurs. “J’étais terrifié par la nature quand j’étais jeune. Y aller seul, c’était impensable. Peindre ces scènes m’a aidé à affronter cette phobie. À apprivoiser le sauvage.”
Des séries emblématiques : de la solitude urbaine à la liberté sauvage
Si l’on connaît surtout Yigal Ozeri pour ses grandes toiles féminines bucoliques, son œuvre ne se résume pas à cela. Il a aussi consacré plusieurs séries à des scènes de vie urbaine — cafés, métros, rues américaines. Dans sa série Subway, il capte la tension suspendue entre des inconnus plongés dans leurs pensées. “J’aime peindre l’attente. Le silence. Ce qui se joue sans mot.” Ce sont des tableaux vibrants, où l’on devine les battements de cœur derrière les visages. “C’est un autre type d’intimité. Celle que l’on ressent quand on partage un lieu avec quelqu’un sans se connaître. On devient témoin, sans le vouloir, de la vie des autres.”
La série Americana reflète une autre facette de son regard. Là encore, il ne s’agit pas de chroniquer l’Amérique mais de l’évoquer à travers des fragments, des moments d’énergie. “Je ne fais pas de politique. Mais je peins un pays. Et ce pays, c’est aussi une idée : celle de la liberté.” Des jeunes femmes assises sur le capot d’une voiture, un coucher de soleil, un mouvement de cheveux dans le vent. Autant de détails qui forment une vision à la fois nostalgique et vivante d’un rêve américain devenu intime.
Une peinture de l’émotion
Ce qui frappe, chez Ozeri, c’est cette capacité à convoquer l’émotion sans jamais l’imposer. Chaque tableau est une expérience ouverte. “Tout dépend du jour, de l’heure, de la personne. Une même toile peut rendre quelqu’un joyeux, un autre mélancolique. Comme un paysage. Il ne change pas, mais nous, oui.” Il insiste : “Ce que je cherche, ce n’est pas à choquer, ni à impressionner. C’est à faire ressentir. Si un tableau provoque une émotion, alors il est réussi.”
Il évoque la notion d’énergie, si difficile à définir, et pourtant si centrale. “Il y a une énergie dans chaque peinture. Quelque chose qui passe, qu’on ne maîtrise pas. L’artiste choisit où mettre la lumière, quels détails sublimer, et cela crée un effet. C’est subtil, mais essentiel.” Et de conclure : “Je veux que mon art soit absorbable. Que l’on puisse y disparaître. Comme dans un poème.”
La peinture comme acte poétique
Justement, la poésie. Elle n’est jamais loin dans ses propos, ni dans ses tableaux. “Pour moi, être peintre, c’est un peu comme être poète. Mais la poésie, c’est l’art le plus difficile. Parce qu’elle dit tout en très peu de mots. Elle évoque plutôt qu’elle ne montre. Un vrai poète, en deux vers, peut contenir le monde entier.” Il admire cette capacité à suggérer, à laisser de l’espace. Son propre travail cherche cela : une densité qui n’écrase pas, un silence qui parle.
Lorsqu’il peint, il pense souvent en termes poétiques. Il parle d’intimité, de modestie, de beauté discrète. “Je n’aime pas ce qui est criard. Il y a des artistes qui font du bruit. Moi, j’essaie de faire de la place.” Pour lui, l’art est un lieu de retrait. Un refuge contre le vacarme. Une invitation à regarder plus lentement, à sentir plus profondément.
Une quête : l’intimité
Si un mot devait résumer son œuvre, ce serait celui-là. Intimité. Pas au sens romantique, ni sexuel. Mais au sens existentiel. “C’est ce que je poursuis depuis toujours. Cette sensation de proximité avec l’autre, avec soi-même, avec le monde.” Dans un monde saturé d’images, où tout est instantané, il propose l’inverse : du temps, du silence, de l’attention.
Art Basel a été, pour lui, le début de cette rencontre entre les styles, les cultures, les visions. Il y expose chaque année, sans jamais se répéter. “L’art évolue. Moi aussi. Mais ce que je cherche reste le même. Une forme de vérité douce. Un miroir de l’âme.”
Retrouvez-nous
sur vos réseaux