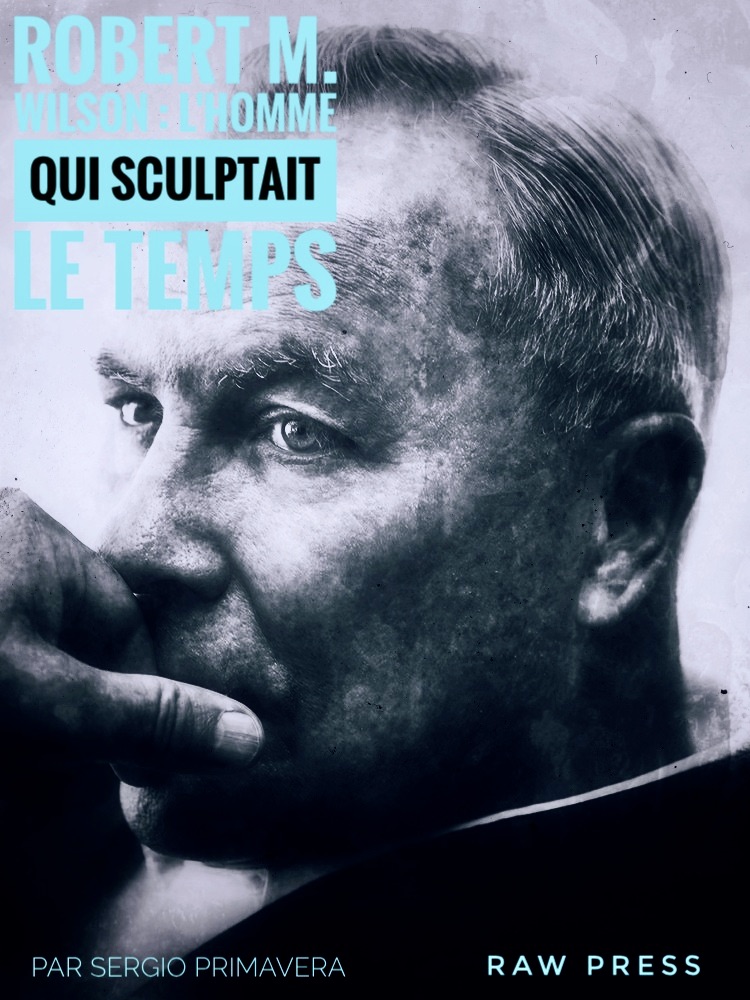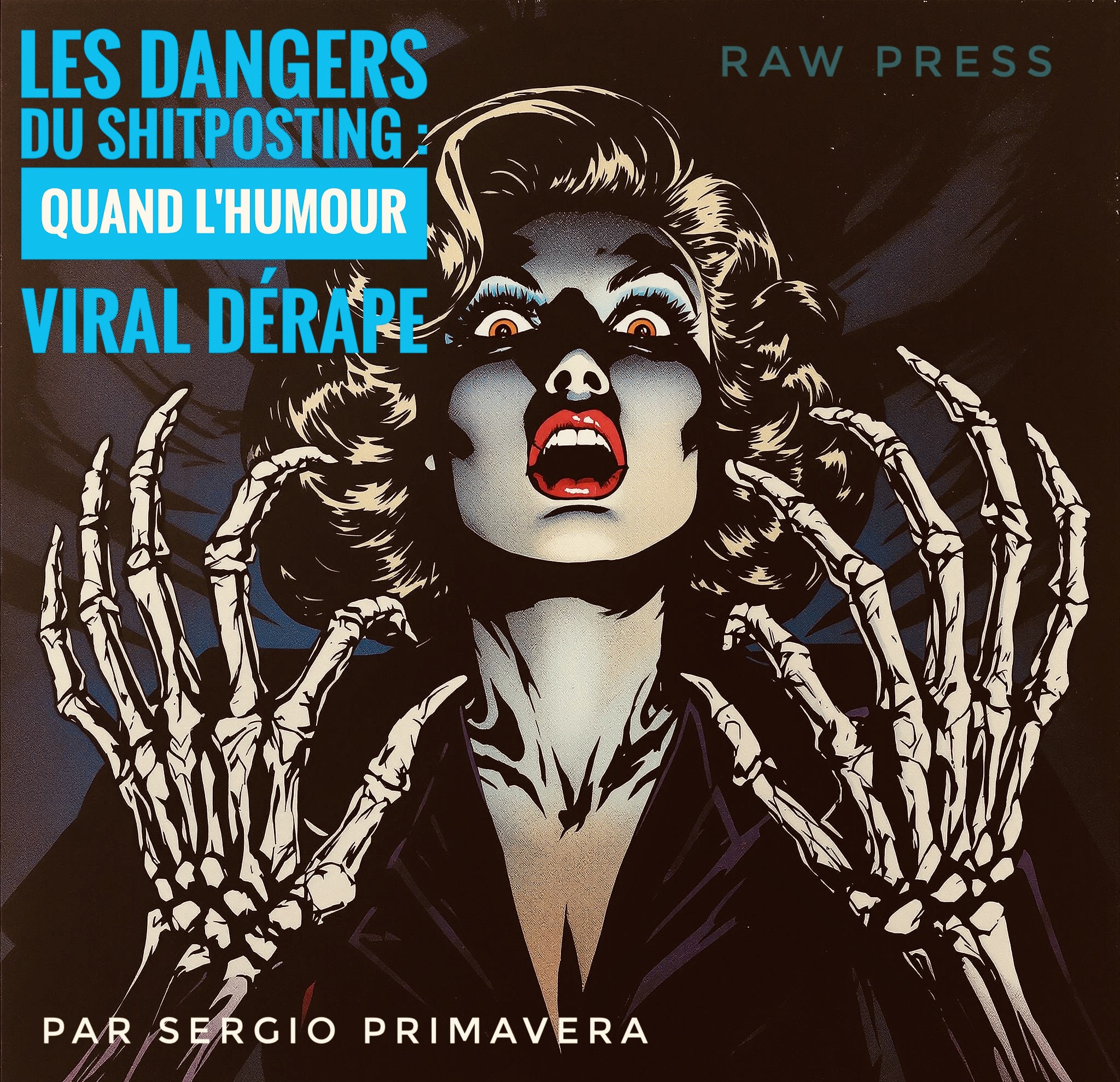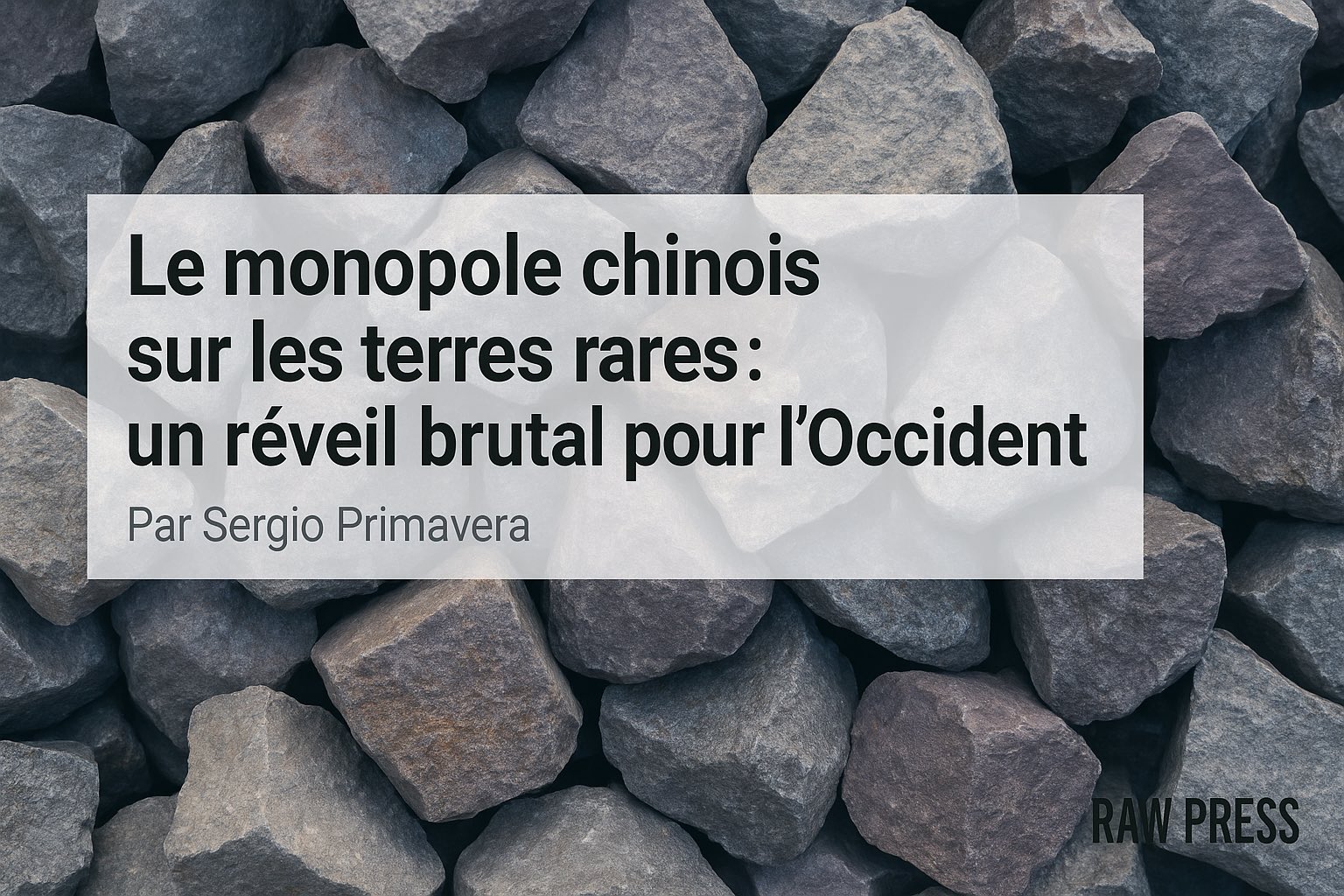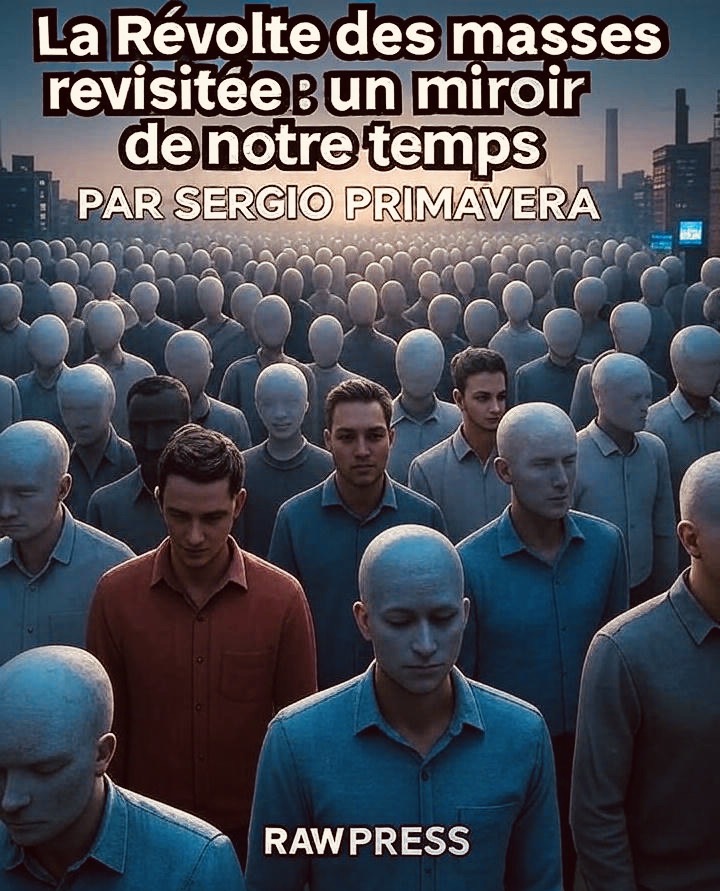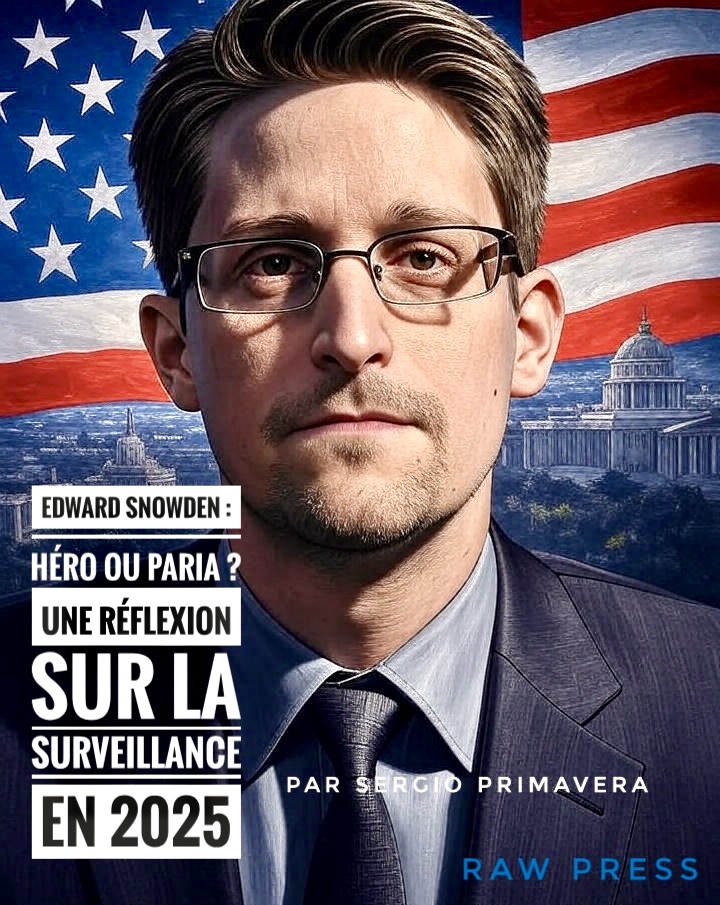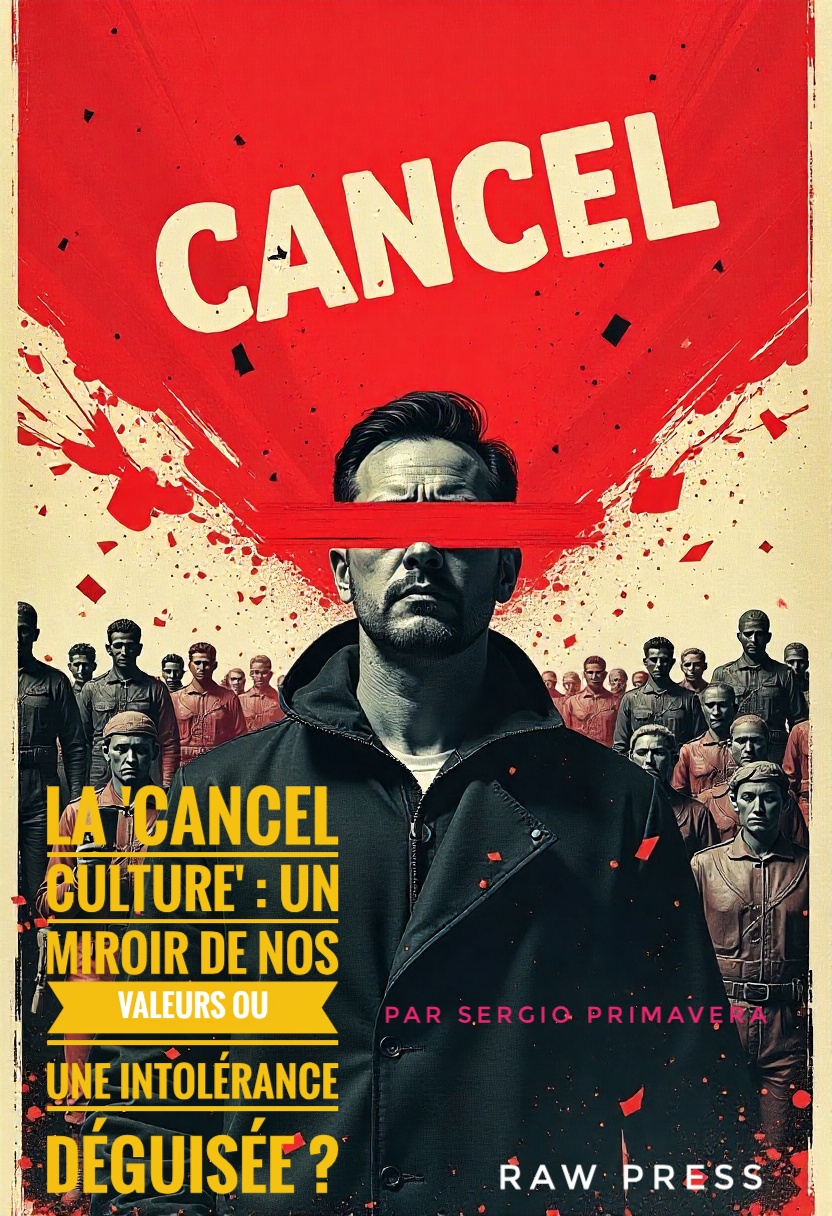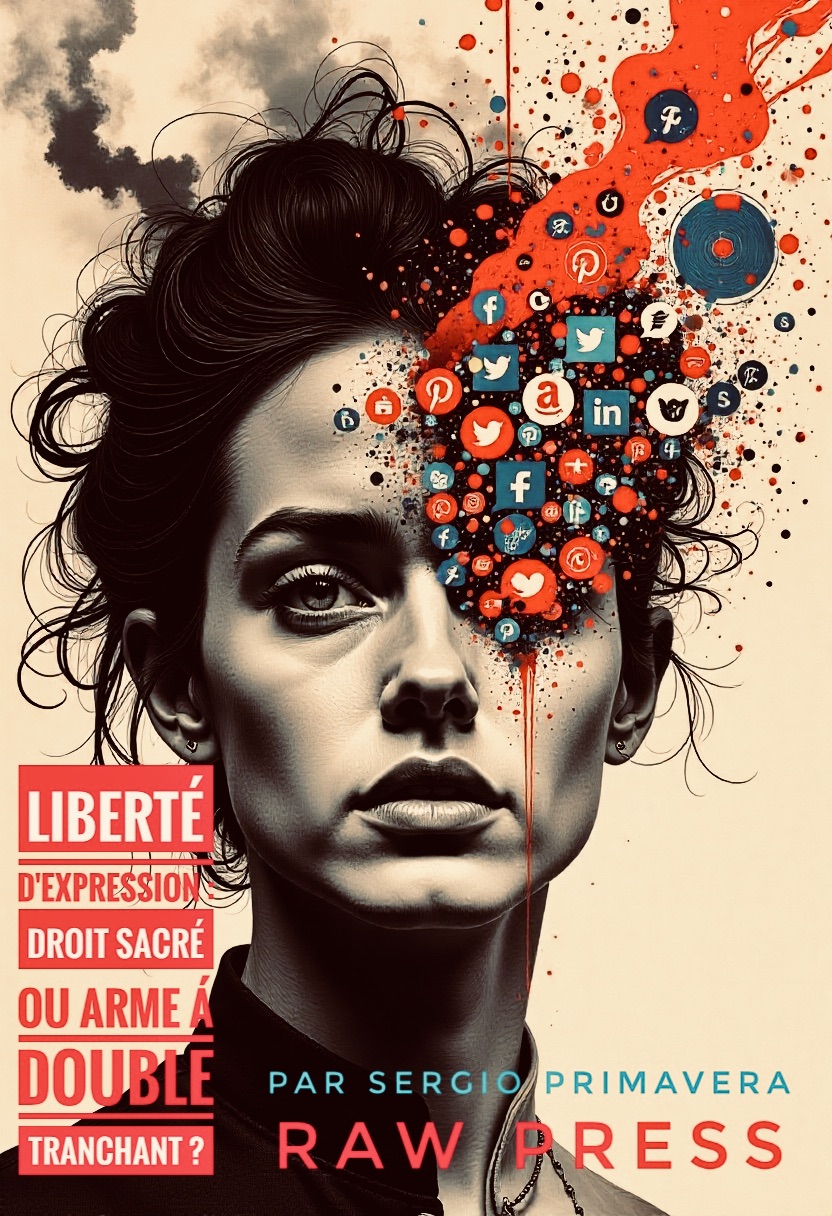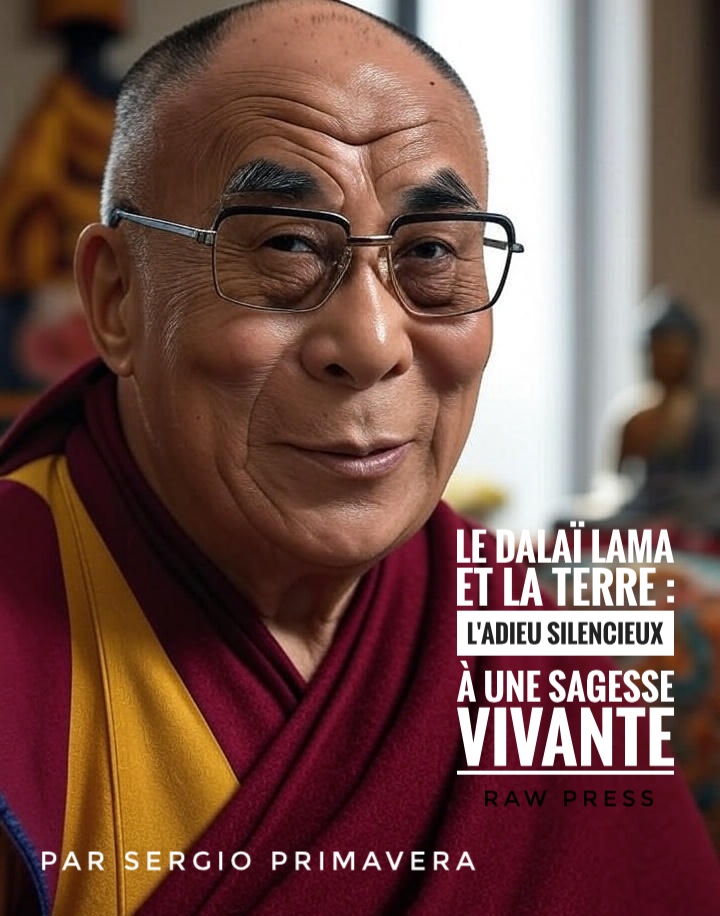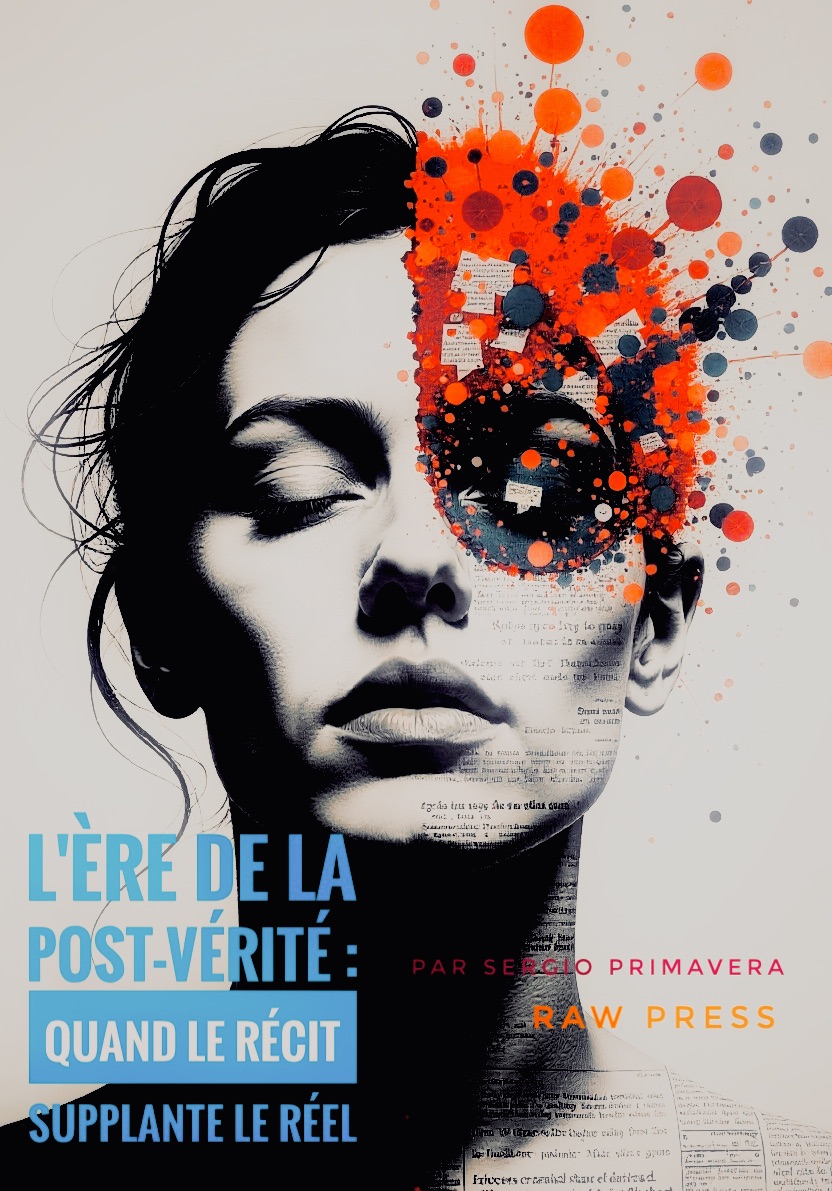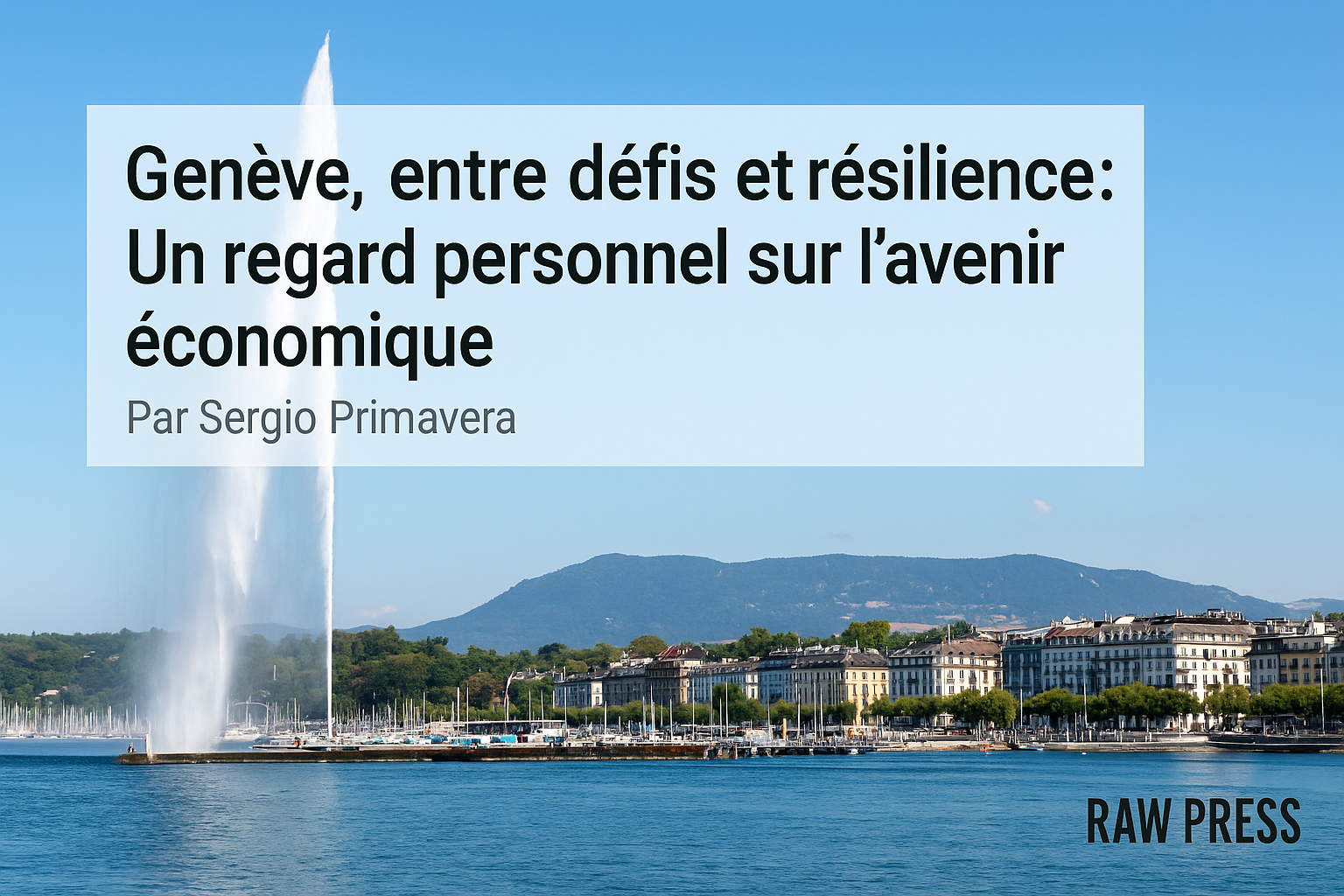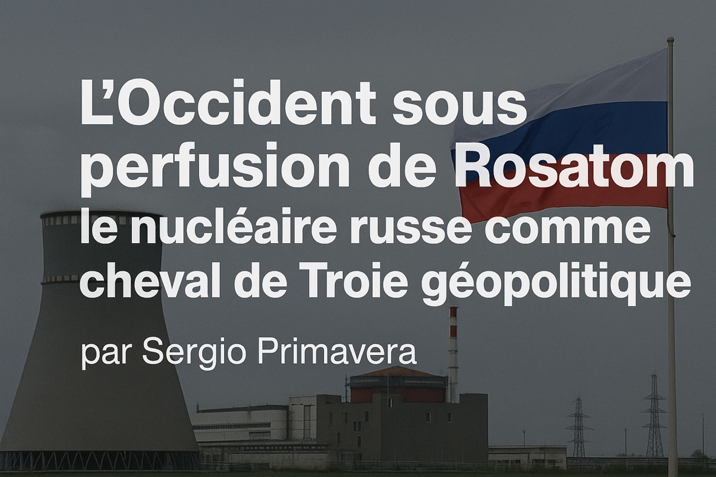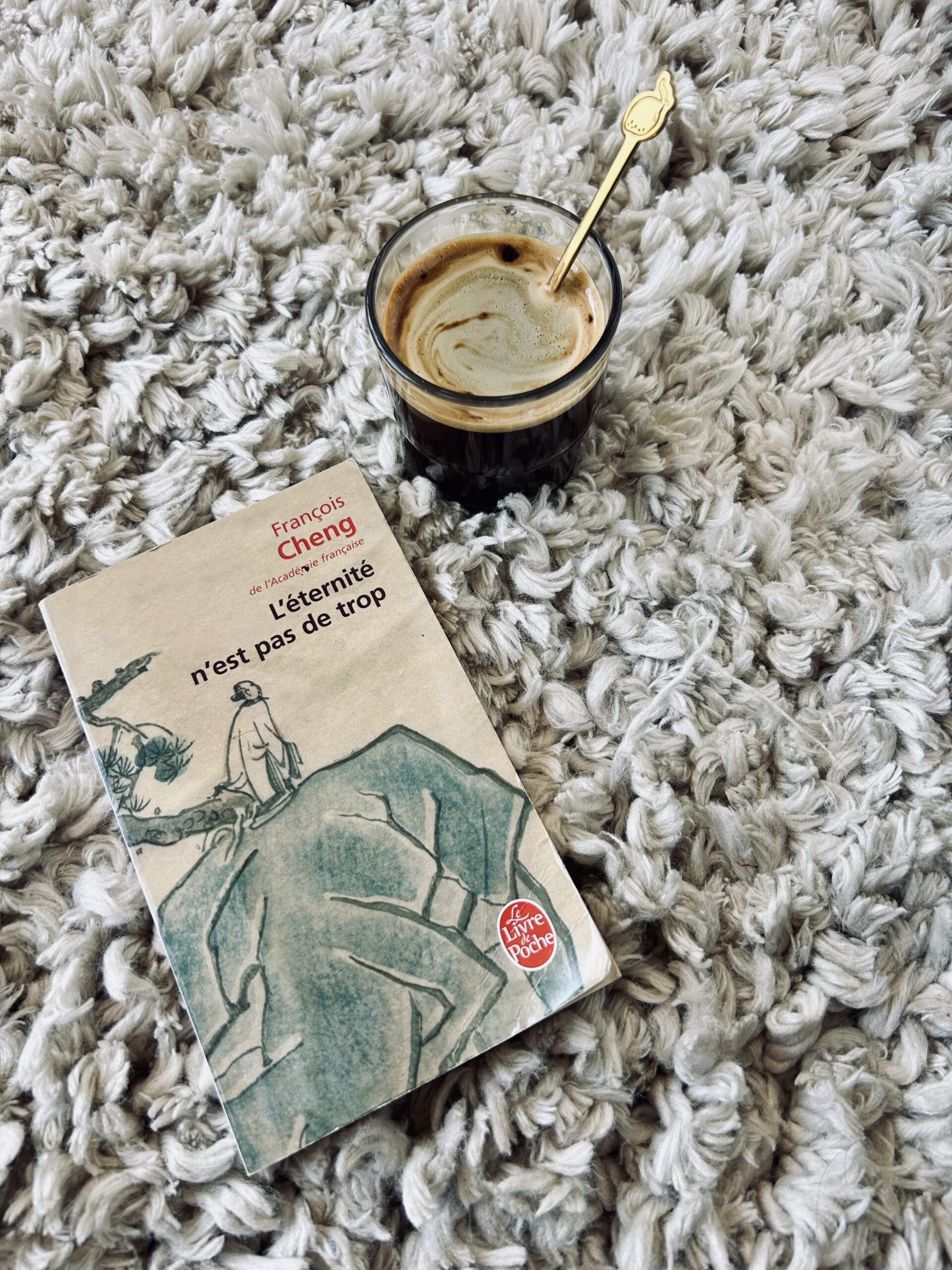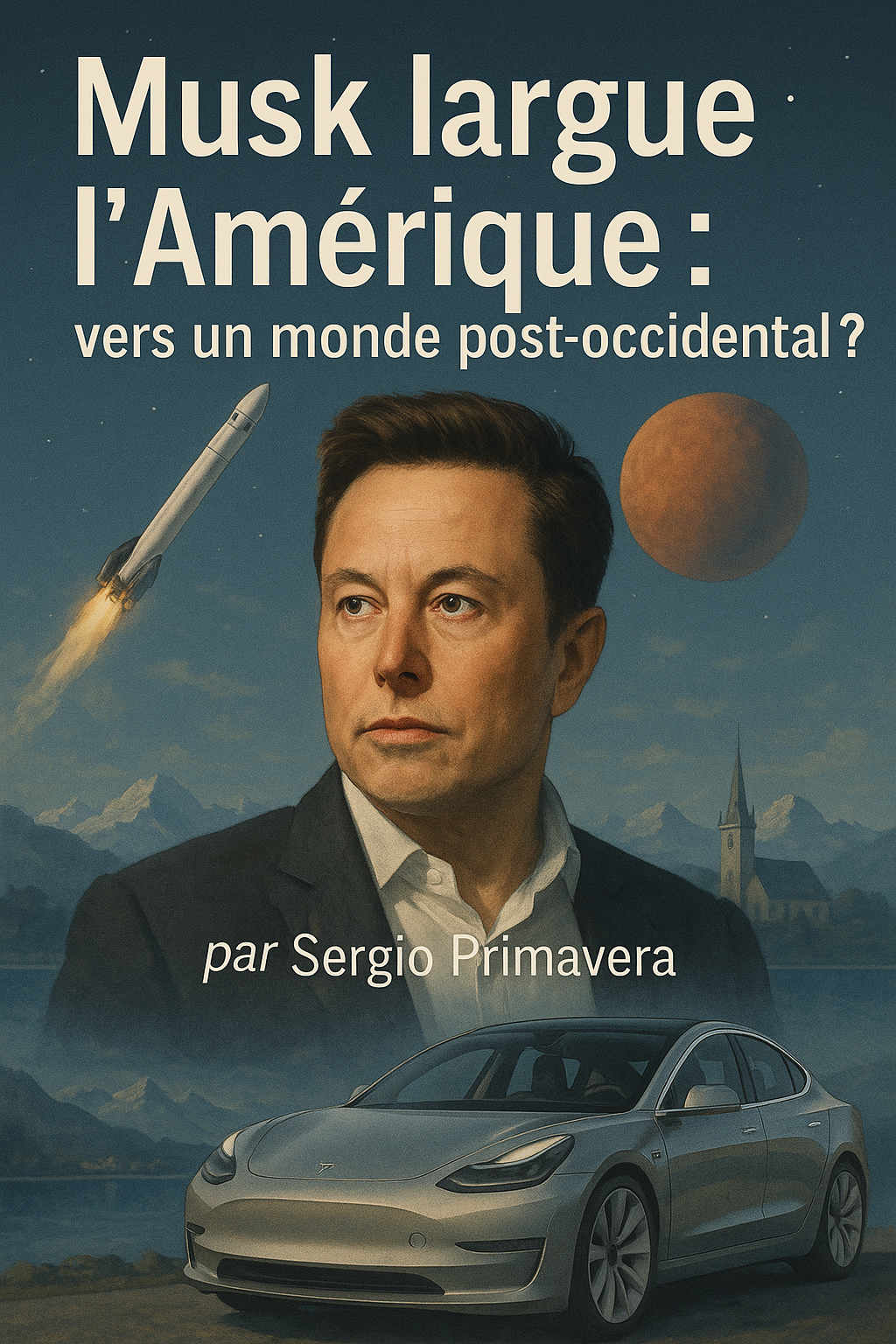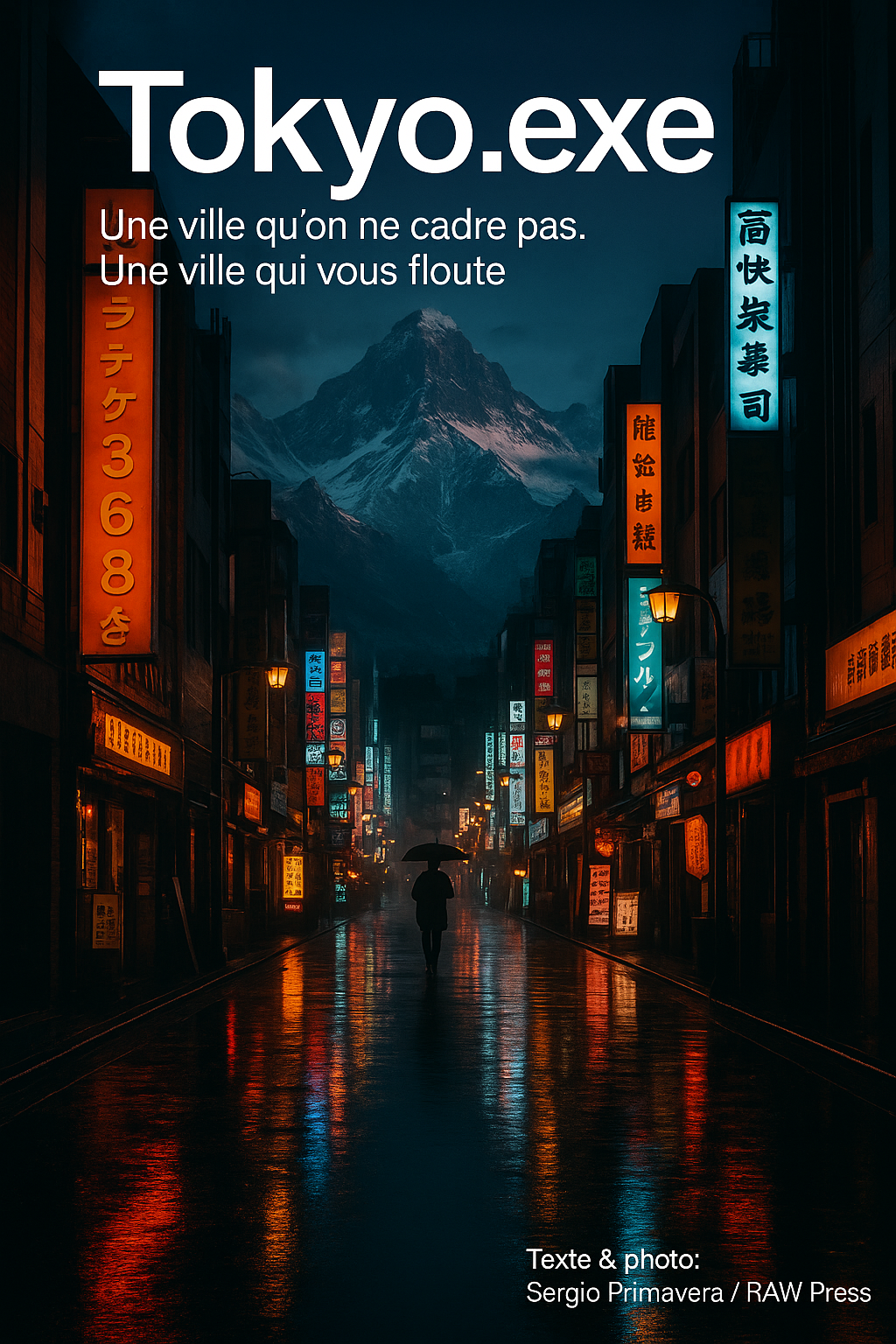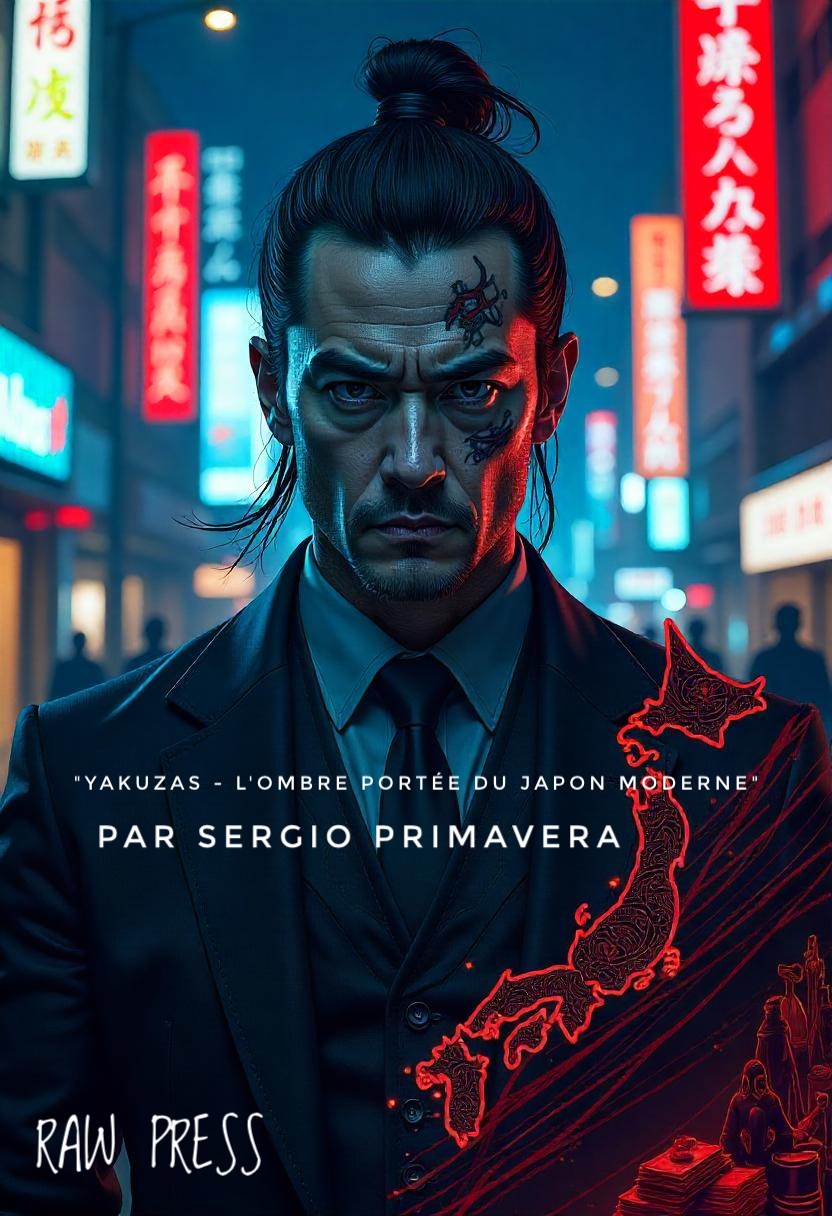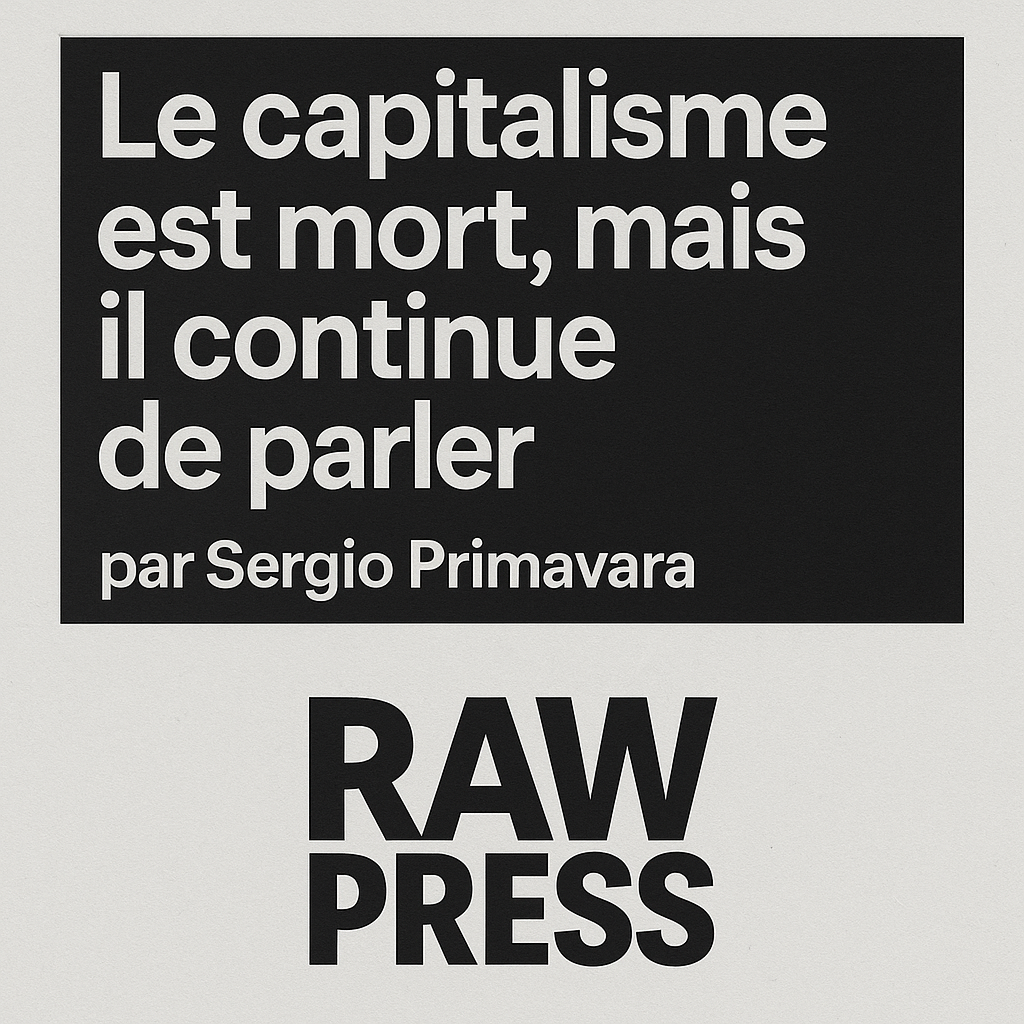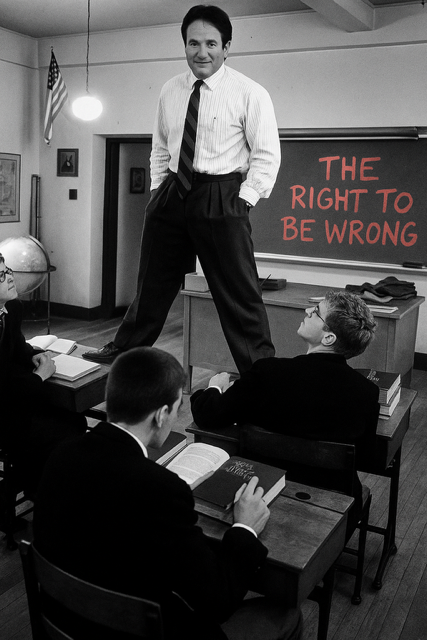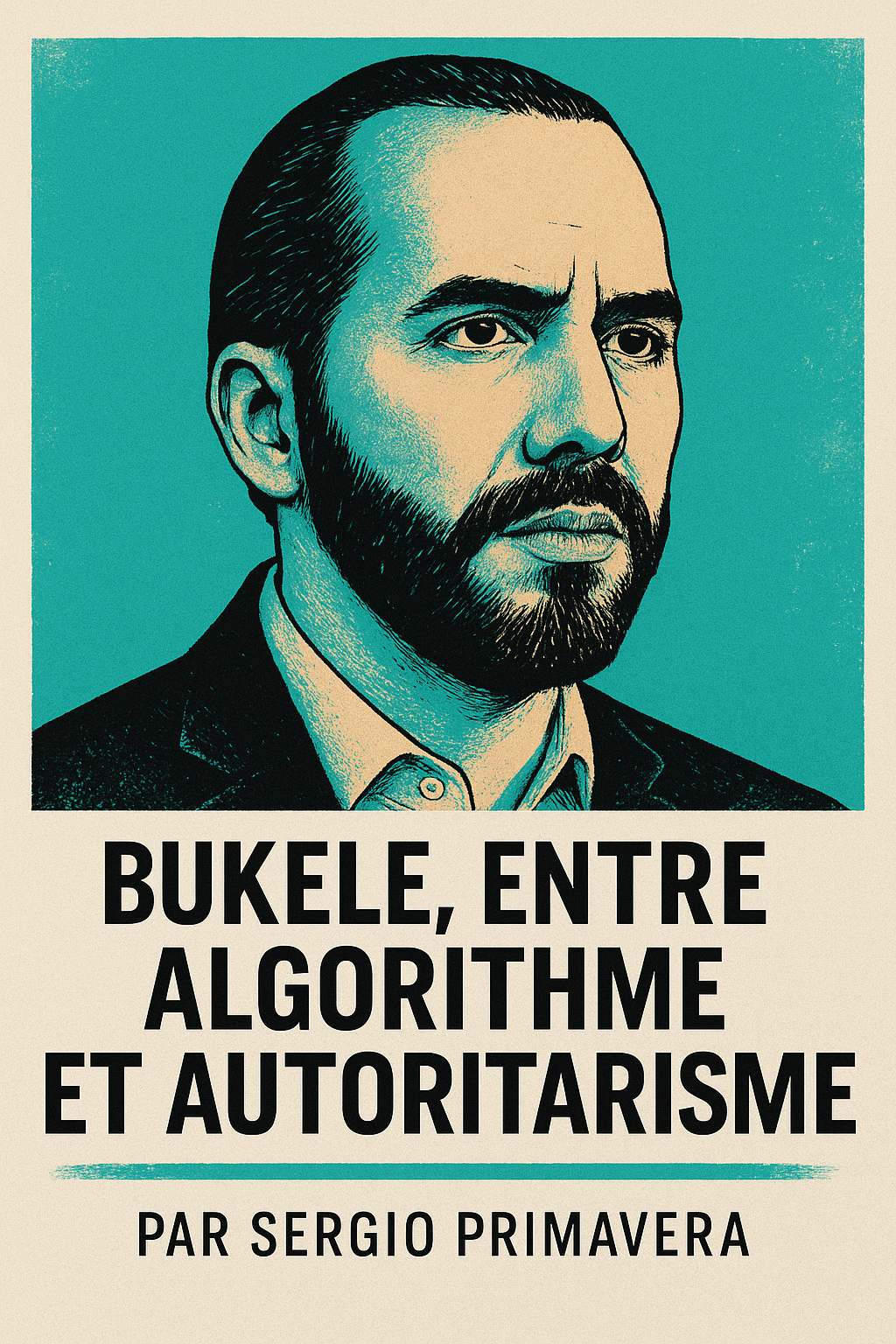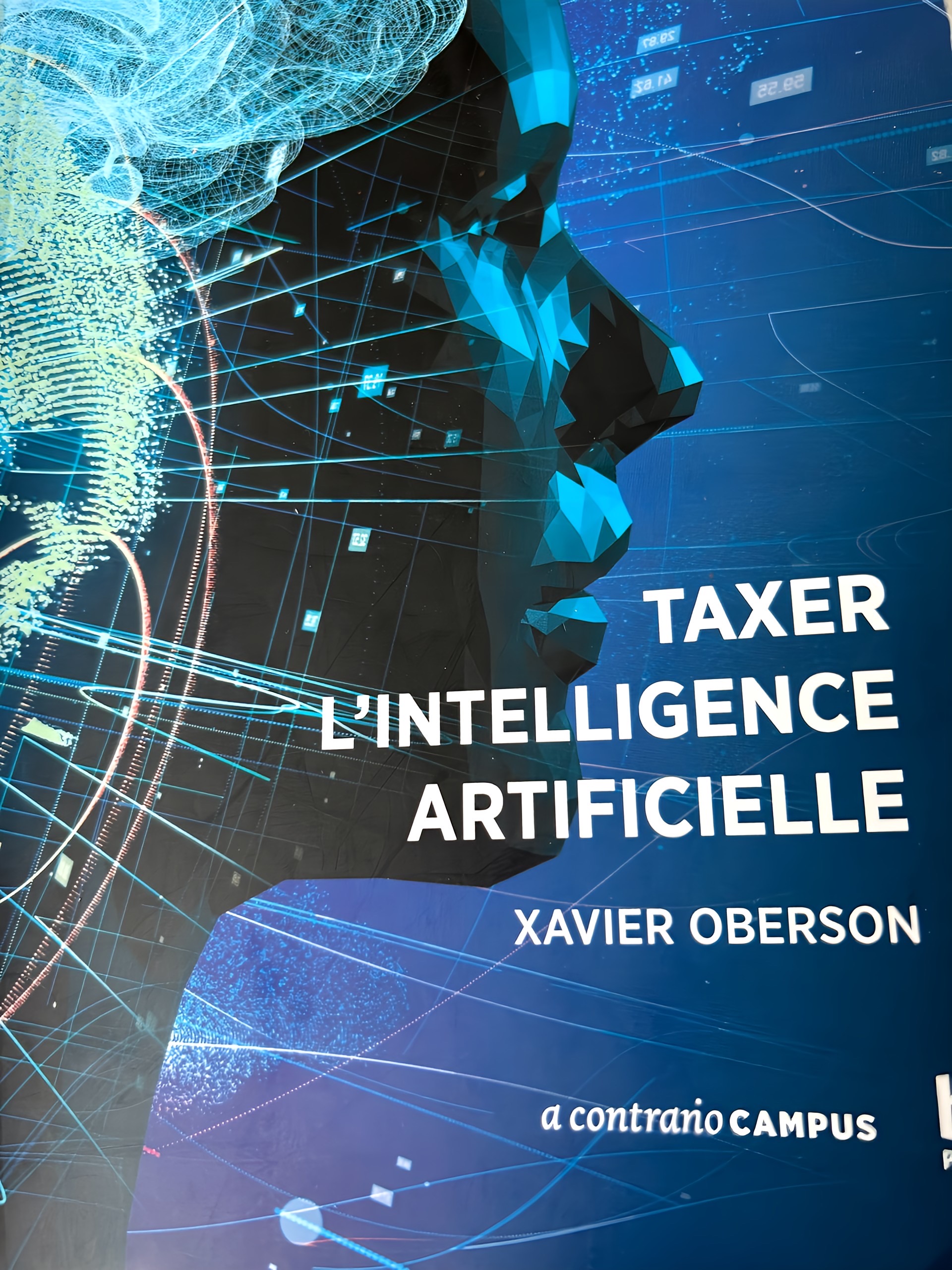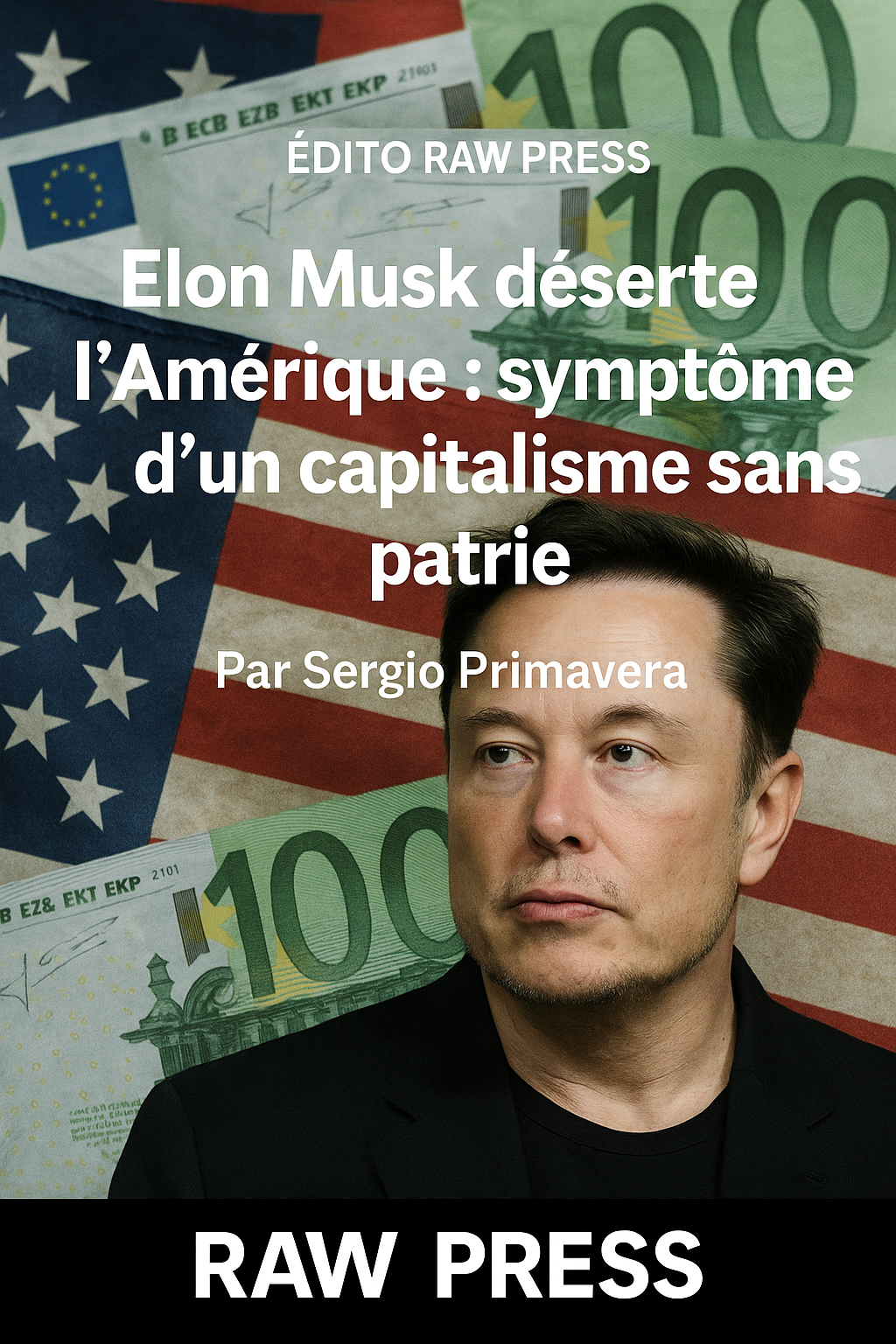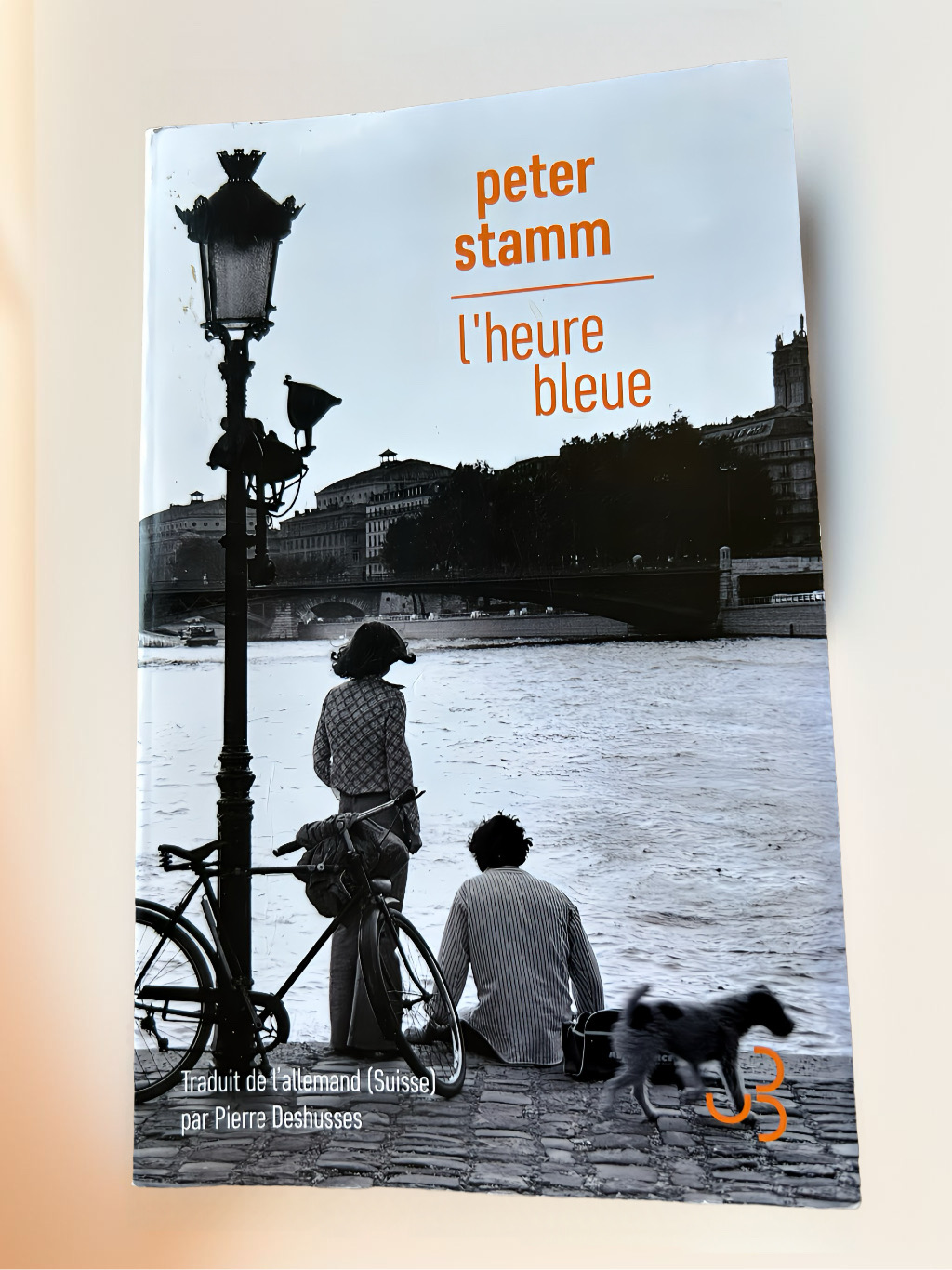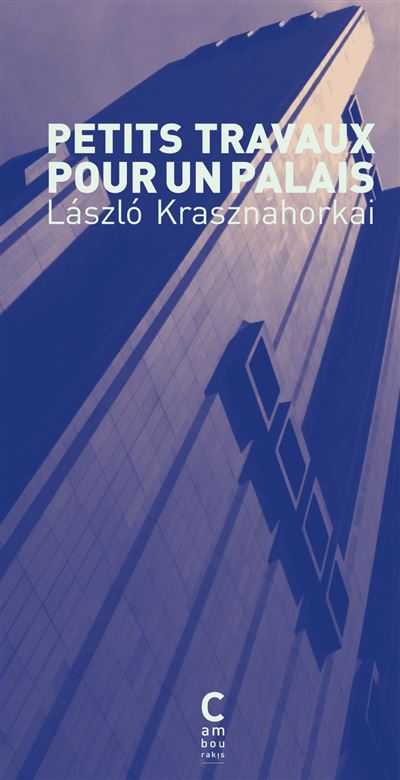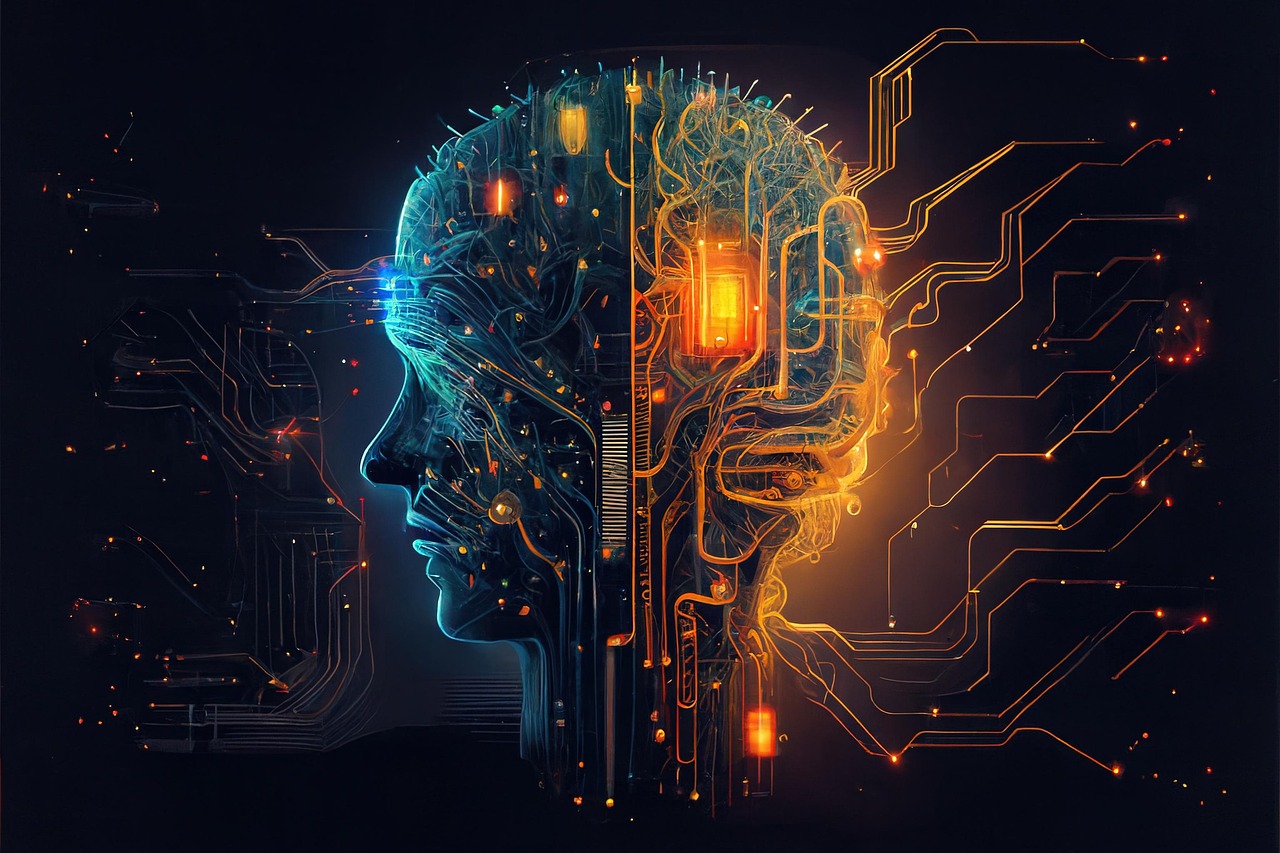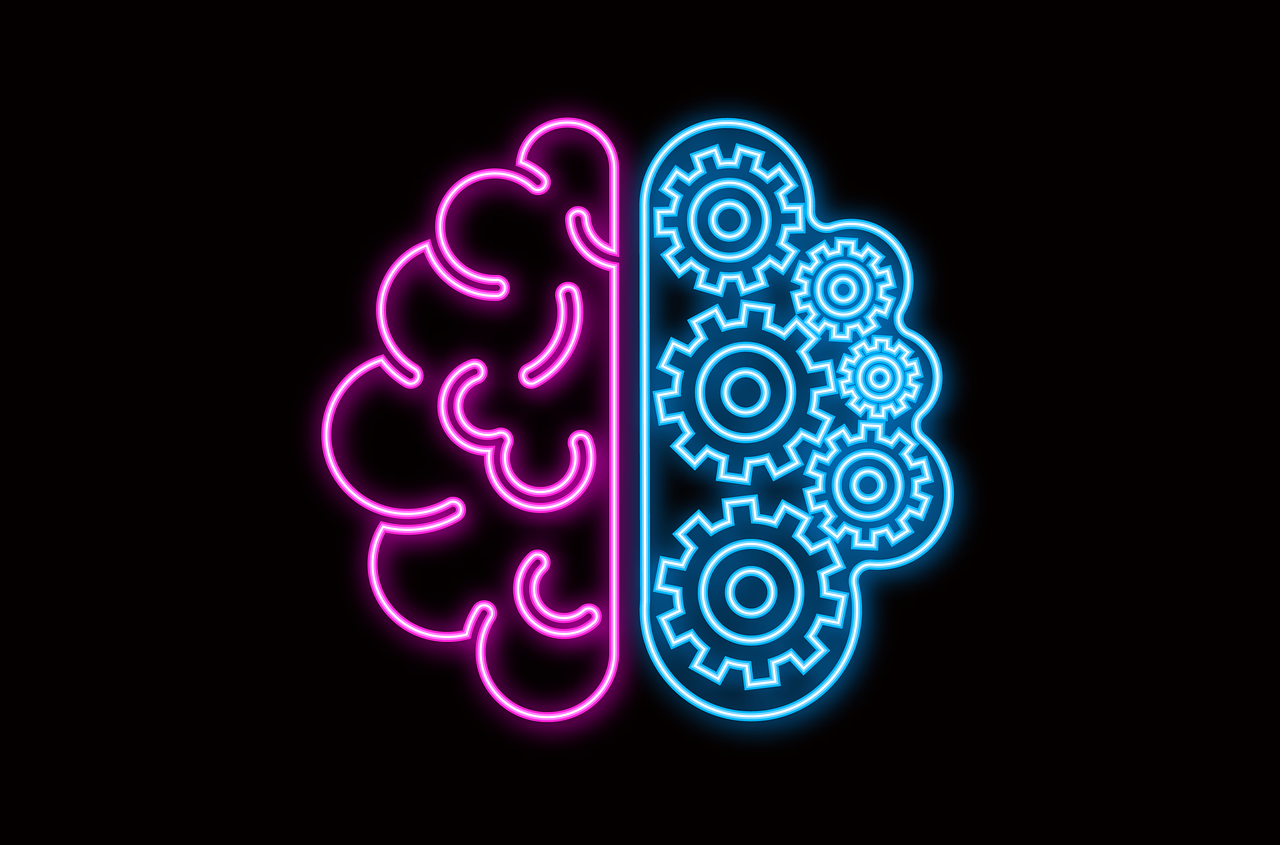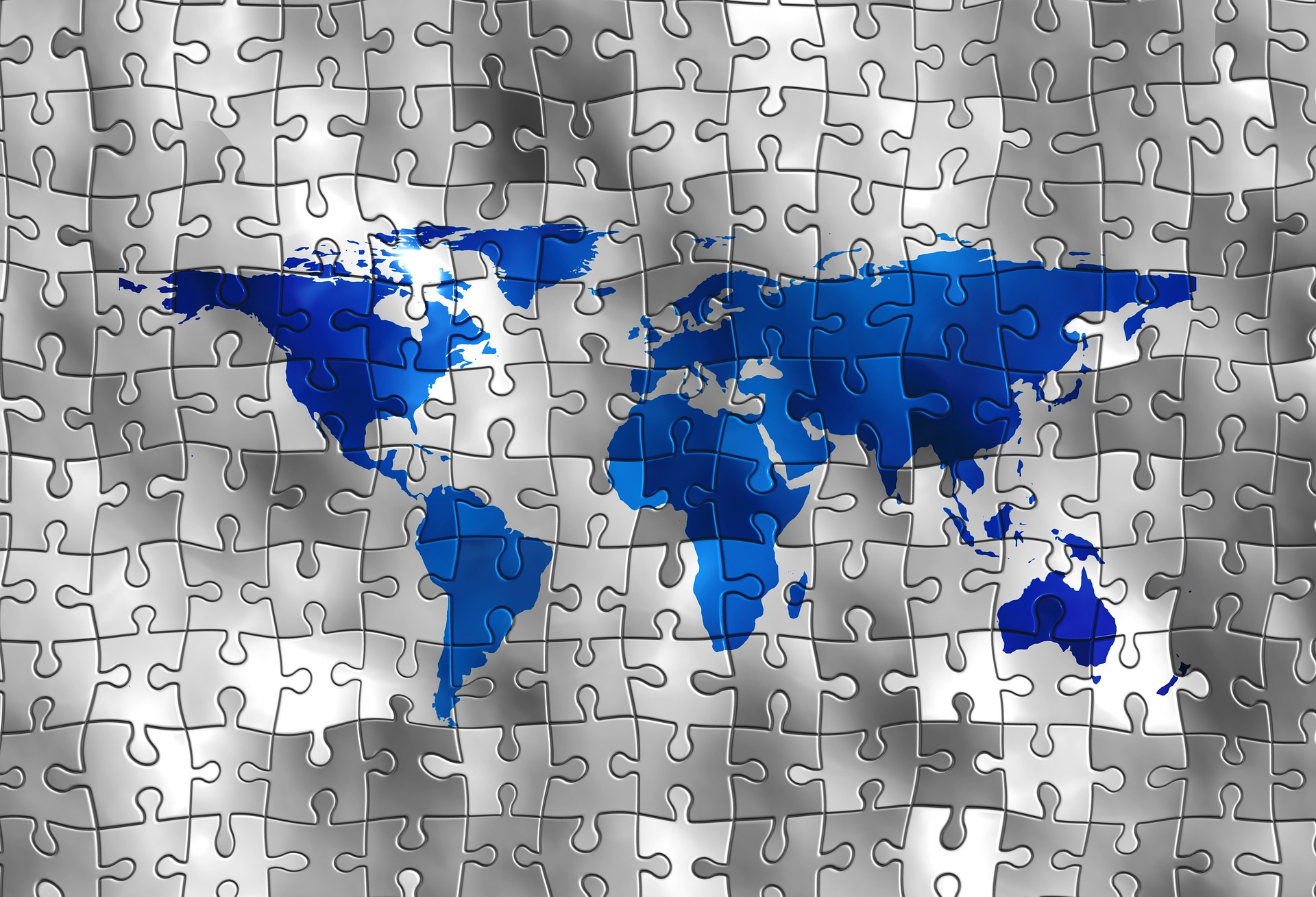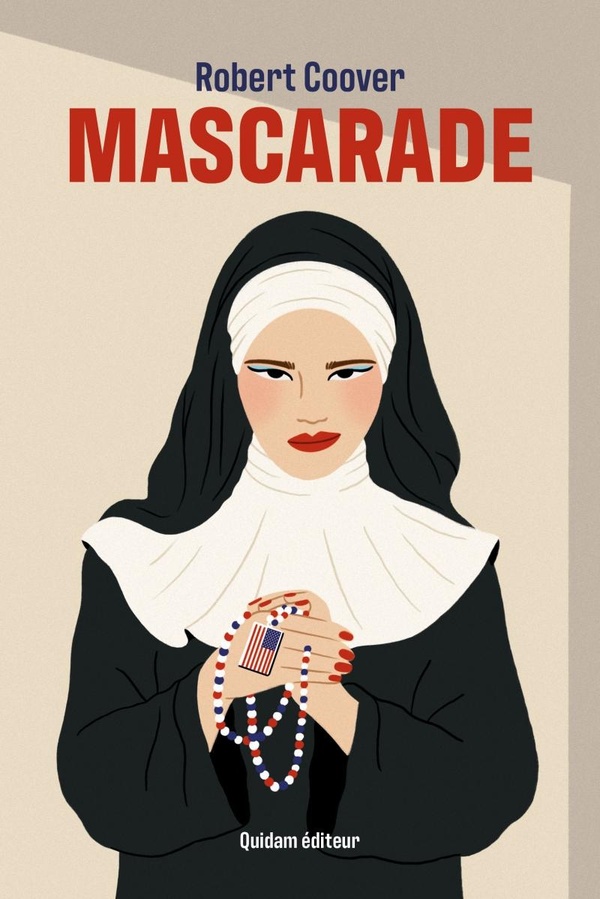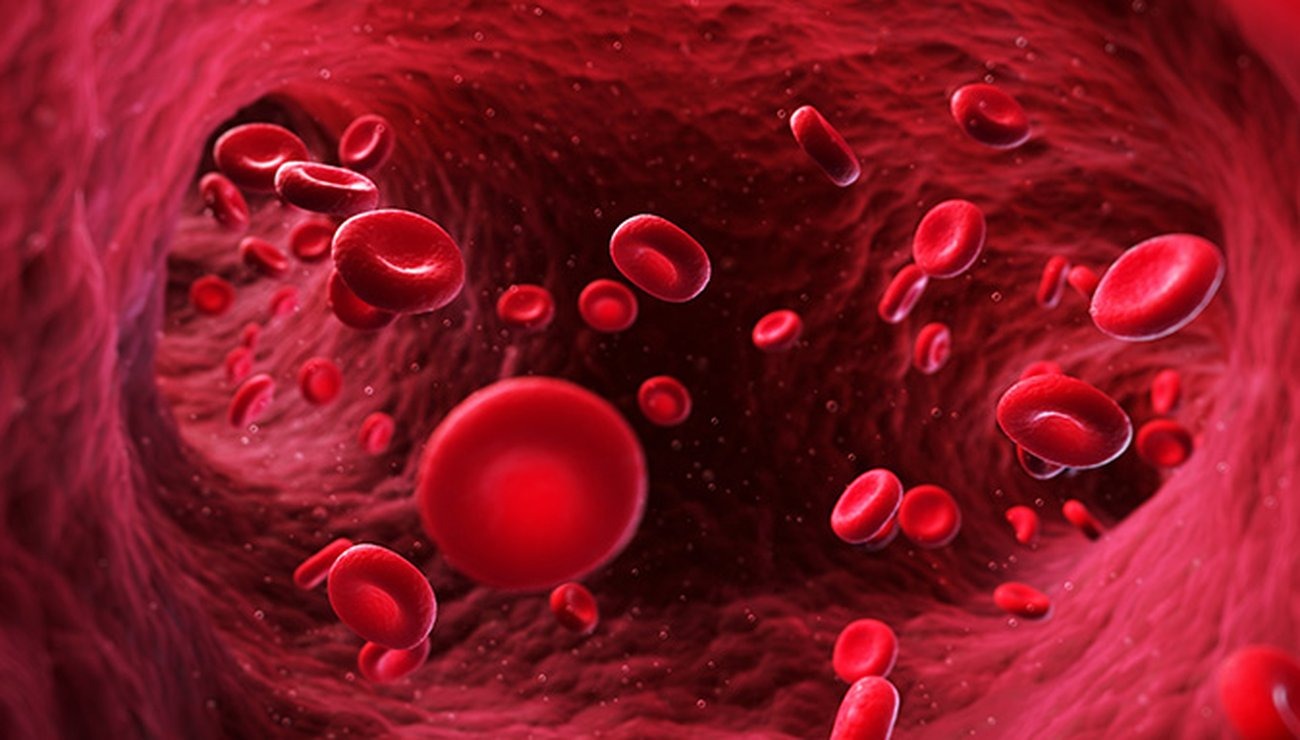Une société à la croisée des chemins – L’IA, le progrès et les laissés-pour-compte

Notre société a déjà opéré un tri impitoyable. Les emplois des moins instruits, des moins intellectuels, des moins « performants » ont été progressivement effacés. Les « petites mains », autrefois indispensables, sont aujourd’hui reléguées aux marges : chômage, précarité, assistanat social. Ces personnes peinent à accéder à un logement décent, à une alimentation saine, à la culture ou même à des loisirs simples. Elles sont les invisibles, les oubliés d’un système qui valorise la productivité à tout prix.
Et pourtant, que lit-on sur les réseaux sociaux, dans les commentaires, dans les forums ? Des phrases assassines : « Ils n’ont qu’à », « Il suffit de », « Quand on veut, on peut ». Des mots qui trahissent une indifférence glaçante, un mépris social assumé. Mais soyons lucides : ces personnes existent. Elles sont là, parmi nous, et leur exclusion n’est pas sans conséquences. C’est un problème de santé publique, un gouffre économique, et surtout une faille morale qui menace l’équilibre de notre société.
Une société qui sacrifie les moins performants sur l’autel de la rentabilité tout en épuisant les plus capables est une société sans âme. Elle est antipathique, inhumaine, et, osons le dire, haïssable. Tôt ou tard, cette fracture sociale risque de provoquer un soulèvement populaire. Pour l’instant, l’individualisme exacerbé des dernières décennies a servi de tampon, mais jusqu’à quand ?
Alors, faut-il rejeter en bloc les avancées technologiques, comme l’intelligence artificielle ? Non. Comme toute invention humaine, l’IA n’est ni bonne ni mauvaise en soi. Tout dépend de l’usage qu’on en fait. Et c’est là que le bât blesse : l’humanité a une fâcheuse tendance à détourner ses propres outils pour servir des intérêts égoïstes. L’IA pourrait pourtant être un formidable levier de progrès, à condition qu’elle soit mise au service de tous, et non pas utilisée pour enrichir une poignée de privilégiés déjà suréquipés.
Imaginez un instant une société où la technologie ne creuserait pas les inégalités, mais les comblerait. Une société où chacun aurait sa place, où les plus vulnérables ne seraient pas méprisés, où les plus talentueux ne seraient pas broyés par la pression de la performance. Une société relativement égalitaire, où l’IA servirait à améliorer la recherche, la médecine, l’éducation, plutôt qu’à enrichir les actionnaires de quelques géants technologiques.
Bien sûr, certains crieront au communisme. Mais il ne s’agit pas de niveler les revenus ou d’imposer une uniformité absurde. Il s’agit simplement de construire un monde plus juste, plus humain, où la solidarité ne serait pas un vain mot. Un monde où « avoir » ne signifierait pas « écraser l’autre », mais « contribuer au bien commun ».
Les biens matériels ne sont pas un problème en soi. Ce qui pose problème, ce sont les disparités abyssales entre ceux qui ont trop et ceux qui n’ont pas assez. L’IA peut être une opportunité historique de rééquilibrer les choses, à condition que nous ayons le courage de repenser nos priorités.
Alors, oui, l’IA pour aider, pour soigner, pour éduquer, pour innover : c’est une chance. Mais l’IA pour creuser de nouveaux fossés, pour exclure encore plus, pour renforcer les privilèges de quelques-uns : c’est une impasse.
Nous sommes tous dans le même bateau, et ce bateau prend l’eau. Il est temps de comprendre que notre destin est lié, et que la technologie doit être un outil de progrès collectif, et non un instrument d’exclusion.
Parce qu’une société qui abandonne les siens est une société qui se condamne elle-même.
Retrouvez-nous
sur vos réseaux